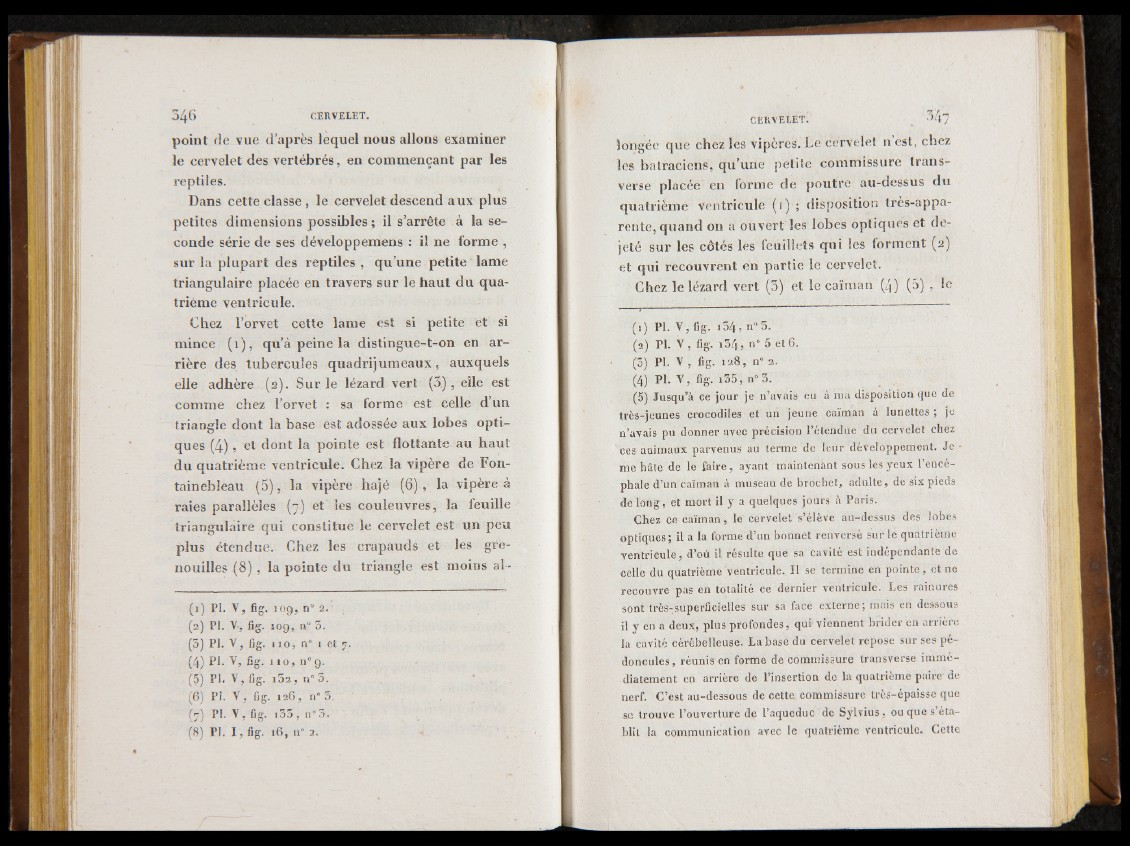
point de vue d’après lequel nous allons examiner
le cervelet des vertébrés, en commençant par les
reptiles.
Dans cette classe , le cervelet descend aux plus
petites dimensions possibles; il s’arrête à la seconde
série de ses développemens : il ne forme ,
sur la plupart des reptiles , qu’une petite lame
triangulaire placée en travers sur le haut du quatrième
ventricule.
Chez l’orvet cette lame est si petite et si
mince (1), qu’à peine la distingue-t-on en arrière
des tubercules quadrijumeaux , auxquels
elle adhère (2). Sur le lézard vert (3.), elle est
comme chez l’orvet : sa forme est celle d’un
triangle dont la base est adossée aux lobes optiques
(4), et dont la pointe est flottante au haut
du quatrième ventricule. Chez la vipère de Fontainebleau
(5), la vipère hajé (6), la vipère à
raies parallèles (7) et les couleuvres, la feuille
triangulaire qui constitue le cervelet est un peu
plus étendue. Chez les crapauds et les grenouilles
(8), la pointe du triangle est moins al-
(1) PI. V, fig. 109, n° 2.'
(2) PI. Y-, fig. 109, n° 3.
(3) PI. V, fig. 110, n° 1 et 7.
(4) PI. V, fig. 110, n° 9.
(5) PI. V, fig. i 32 , n° 3.
(6) PI. V, fig. 126, n* 3.
(7) PI. Y, fig. i 33, n°5.
(8) PI. I ,fig . 16, n” 2.
longée que chez les vipères. Le cervelet n’est, chez
les batraciens, qu’une petite commissure transverse
placée en forme de poutre au-dessus du
quatrième ventricule (1) ; disposition très-apparente,
quand on a ouvert les lobes optiques et de-
jeté sur les côtés les feuillets qui les forment (2)
et qui recouvrent eii partie le cervelet.
Chez le lézard vert (3) et le caïman (4) (5) , le
(>) PI. V, fig. 134? n° 5.
(2) PI. Y , fig. i 34, n° 5 et 6.
(5) PI. Y , fig. 128, n° 2.
(4) PL V, fig. i 35, n° 3.
(5) Jusqu’à ce jour je n’avais eu à ma disposition que de
très-jeunes crocodiles et un jeune caïman à lunettes ; je
n’avais pu donner avec précision l’étendue du cervelet chez
ces animaux parvenus au terme de leur développement. Je •
me hâte de le faire, ayant maintenant sous les yeux l’encéphale
d’un caïman à museau de brochet, adulte, de six pieds
de long, et mort il y a quelques jours à Paris.
Chez ce caïman, le'cervelet s’élève au-dessus des lobes
optiques; il a la forme d’un bonnet renversé sur le quatrième
ventricule, d’où il résulte que sa cavité est indépendante de
celle du quatrième ventricule. Il se termine en pointe, et ne
recouvre pas en totalité ce dernier ventricule. Les rainures
sont très-superficielles sur sa face externe; mais en dessous
il y en a deux, plus profondes, qui-viennent brider en arrière
la cavité cérébelleuse. La base du cervelet repose sur ses pédoncules,
réunis en forme de commissure transverse immédiatement
en arrière de l’insertion de la quatrième paire de
nerf. C’est au-dessous de cette, commissure très-épaisse que
se trouve l’ouverture de l’aqueduc de Sylvius, ou que s’établit
la communication avec le quatrième ventricule. Cette