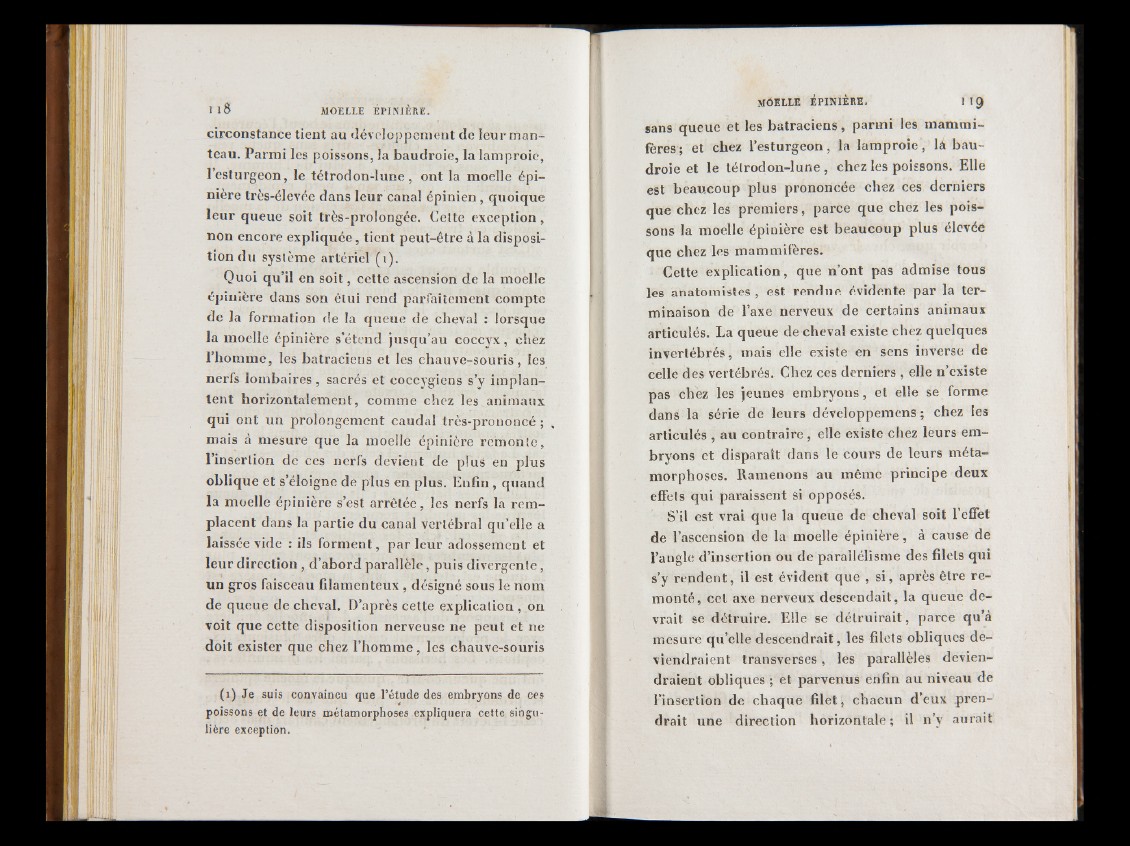
circonstance tient au développement de leur manteau.
Parmi les poissons, la baudroie, la lamproie,
l’esturgeon, le tétrodon-lune, ont la moelle épinière
très-élevée dans leur canal épinien, quoique
leur queue soit très-prolongée. Celte exception,
non encore expliquée, tient peut-être à la disposition
du système artériel (i).
Quoi qu’il en soit, cette ascension de là moelle
épinière dans son étui rend parfaitement compte
de la formation rie la queue de cheval : lorsque
la moelle épinière s’étend jusqu’au coccyx, chez
l’homme, les batraciens et les chauve-souris, les
nerfs lombaires, sacrés et coccygiens s’y implantent
horizontalement, comme chez les animaux
qui ont un prolongement caudal très-prononcé ;
mais à mesure que la moelle épinière remonte,
l’insertion de ces nerfs devient de plus en plus
oblique et s’éloigne de plus en plus. Enfin, quand
la moelle épinière s’est arrêtée, les nerfs la remplacent
dans la partie du canal vertébral qu’elle a
laissée vide : ils forment, par leur adossement et
leur direction, d’abord parallèle, puis divergente,
un gros faisceau filamenteux , désigné sous le nom
de queue de cheval. D’après cette explication , on
voit que cette disposition nerveuse ne peut et ne
doit exister que chez l’homme, les chauve-souris
(1) Je suis convaincu que l’étude des embryons de ces
poissons et de leurs métamorphoses expliquera cette singulière
exception.
sans queue et les batraciens, parmi les mammifères
; et chez l’esturgeon, la lamproie, là baudroie
et le tétrodon-lune , chez les poissons. Elle
est beaucoup plus prononcée chez ces derniers
que chez les premiers, parce que chez les poissons
la moelle épinière est beaucoup plus élevéé
que chez les mammifères.
Cette explication, que n’ont pas admise tous
les anatomistes , est rendue évidente par la terminaison
de l’axe nerveux de certains animaux
articulés. La queue de cheval existe chez quelques
invertébrés, mais elle existe en sens inverse de
celle des vertébrés. Chez ces derniers , elle n’existe
pas chez les jeunes embryons, et elle se forme
dans la série de leurs développemens ; chez les
articulés , au contraire , elle existe chez leurs embryons
et disparaît dans le cours de leurs métamorphoses.
Ramenons au même principe deux
effets qui paraissent si opposés.
S’il est vrai que la queue de cheval soit l’effet
de l’ascension de la moelle épinière, à cause de
i’angîe d’insertion ou de parallélisme des filets qui
s’y rendent, il est évident que , si, après être remonté,
cet axe nerveux descendait, la queue devrait
se détruire. Elle se détruirait , parce qu’à
mesure qu’elle descendrait, les filets obliques deviendraient
transverses, les parallèles deviendraient
obliques ; et parvenus enfin au niveau de
l’insertion de chaque filet, chacun d’eux prendrait
une direction horizontale ; il n’v aurait