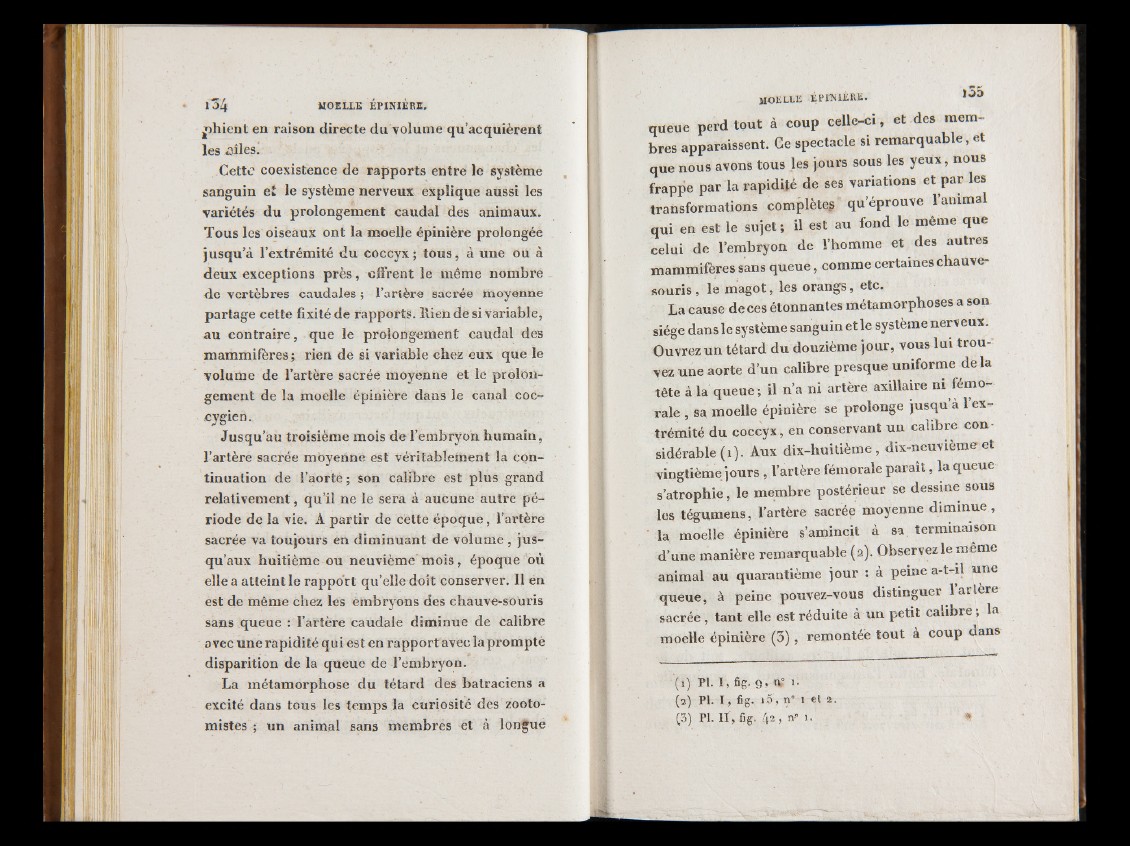
fihient en raison directe du volume qu’acquièrent
les aîles^
Cette coexistence de rapports entre le système
sanguin et le système nerveux explique aussi les
variétés du prolongement caudal dés animaux.
Tous les oiseaux ont la moelle épinière prolongée
jusqu’à l’extrémité du coccyx; tous, à une ou à
deux exceptions p rè s, offrent le même nombre
de vertèbres caudales ; l’artère sacrée moyenne
partage cette fixité de rapports. Itien de si variable,
au contraire, que le prolongement caudal des
mammifères; rien de si Variable chez eux que le
volume de l’artère sacrée moyenne et le prolongement
de la moelle épinière dans le canal coc-
cygien.
Jusqu’au troisième mois de l'embryon humain,
l’artère sacrée moyenne est véritablement la continuation
de l’aorté ;■ son calibre est plus grand
relativement , qu’il ne le sera à aucune autre période
de la vie. À partir de cette époque, l’artère
sacrée va toujours en diminuant de volume , jusqu’aux
huitième ou neuvième mois, époque où
elle a atteint le rapport qu’elle doit conserver. 11 én
est de même chez les embryons des chauve-souris
sans queue : l’artère caudale diminue de calibre
a vec une rapidité qui est en rapport avec lapromptè
disparition de la queue de l’embryon.
La métamorphose du têtard des batraciens a
excité dans tous les temps la curiosité des zooto-
mistes ; un animal sans membres et à longue
queue perd tout à coup celle-ci, et des membres
apparaissent. Ce spectacle si remarquable, et
que nous avons tous les jours sous les yeux, nous
frappe par la rapidité de ses variations et par les
transformations complète^ qu’éprouve l’animal
qui en est le sujet; il est au fond le même que
celui de l’embryon de l’homme et des autres
mammifères sans queue, comme certaines chauve-
souris, le magot, les orangs, etc.
La cause deces étonnantes métamorphoses a son
siège dans le système sanguin et le système nerveux.
Ouvrez un têtard du douzième jour, vous lui trouvez
une aorte d’un calibre presque uniforme de la
tête à la queue ; il n’a ni artère axillaire ni fémorale
, sa moelle épinière se prolonge jusqu’à l’extrémité
du coccyx, en conservant un calibre considérable
( i ). Aux dix-huitième, dix-neuvième et
vingtième jo u rs, l’artère fémorale paraît, la queue
s’atrophie, le membre postérieur se dessine sous
les tégumens, l’artère sacrée moyenne diminue ,
la moelle épinière s’amincit à s a terminaison
d’une manière remarquable (2). Observez le même
animal au quarantième jour ; à peine a-t-il une
queue, à peine pouvez-vous distinguer l’arlère
sacrée , tant elle est réduite à un petit calibre, la
moelle épinière (3), remontée tout à coup dans
(1) PI. % fig. 9, «v° Jj
(2) PI. I , fig. i 5 , n” 1 et 2 .