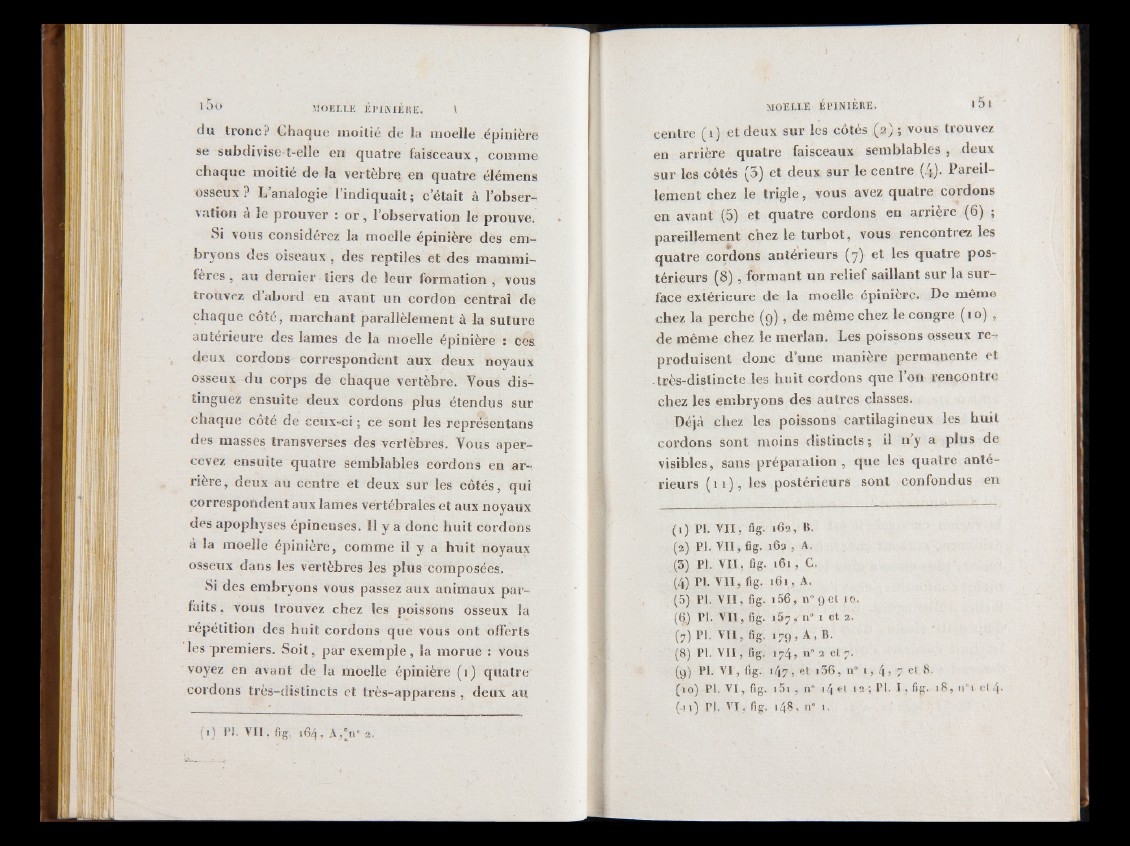
du tronc? Chaque moitié de la moelle épinière
se subdivise-t-elle en quatre faisceaux, comme
chaque moitié de la vertèbre en quatre élémens
osseux ? L’analogie l’indiquait ; c’était à l’observation
à le prouver : o r , l’observation le prouve.
Si vous considérez la moelle épinière des embryons
des oiseaux, des reptiles et des mammifères
, au dernier tiers de leur formation , vous
trouvez d abord en avant un cordon centrai de
chaque côté, marchant parallèlement à la suture
antérieure des lames de la moelle épinière : ces
deux cordons correspondent aux deux noyaux
osseux du corps de chaque vertèbre. Vous distinguez
ensuite deux cordons plus étendus sur
chaque côté de ceux-ci ; ce sont les représentans
des masses transverses des vertèbres. Vous apercevez
ensuite quatre semblables cordons en arrière,
deux au centre et deux sur les côtés, qui
correspondent aux lames vertébrales et aux noyaux
des apophyses épineuses. Il y a donc huit cordons
à la moelle épinière, comme il y a huit noyaux
osseux dans les vertèbres les plus composées.
Si des embryons vous passez aux animaux parfaits
, vous trouvez chez les poissons osseux la
répétition des huit cordons que vous ont offerts
les premiers. Soit, par exemple, la morue : vous
voyez en avant de la moelle épinière (1) quatre
cordons très-distincts et très-apparens, deux au
centre (1) et deux sur les côtés (2) ; vous trouvez
en arrière quatre faisceaux semblables , deux
sur les côtés (3) et deux sur le centre (4)- Pareillement
chez le trigle, vous avez quatre cordons
en avant (5) et quatre cordons en arriéré (6) ;
pareillement chez le turbot, vous rencontrez les
quatre cordons antérieurs (7) et les quatre postérieurs
(8), formant un relief saillant sur la surface
extérieure de la moelle épinière. De même
chez la perche (9), de même chez le congre (10) ,
de même chez le merlan. Les poissons osseux reproduisent
donc d’une manière permanente et
très-distincte les huit cordons que l’on rencontre
chez les embryons des autres classes.
Déjà chez les poissons cartilagineux les huit
cordons sont moins distincts ; il n’y a plus de
visibles, sans préparation , que les quatre antérieurs
(11), les postérieurs sont confondus en
(1) PI. VII, fig. 162, B.
(2) PI. VII, fig. 163 , A.
(3) PI. VII, fig. 161, C.
(4) PI. VII, fig. 161, A.
(5) PI. VII, fig. i 56, n° 9 et 10.
(£j.) PI. VII, fig. îS?, n° 1 et 2.
(7) PI. VII, fig. 17g, A, B.
(8) PI. VII, fig. 174, n° 2 et 7.
(g) PI. VI , fig. 147 j et i 36, n° 1, 4 ? 7 et fi-
(10) PI. VI, fig. i 5t , n" 14 et 12 ; PI. I , fig. 18, n°i et
(41) PI. VI, fig. 148, n° 1.