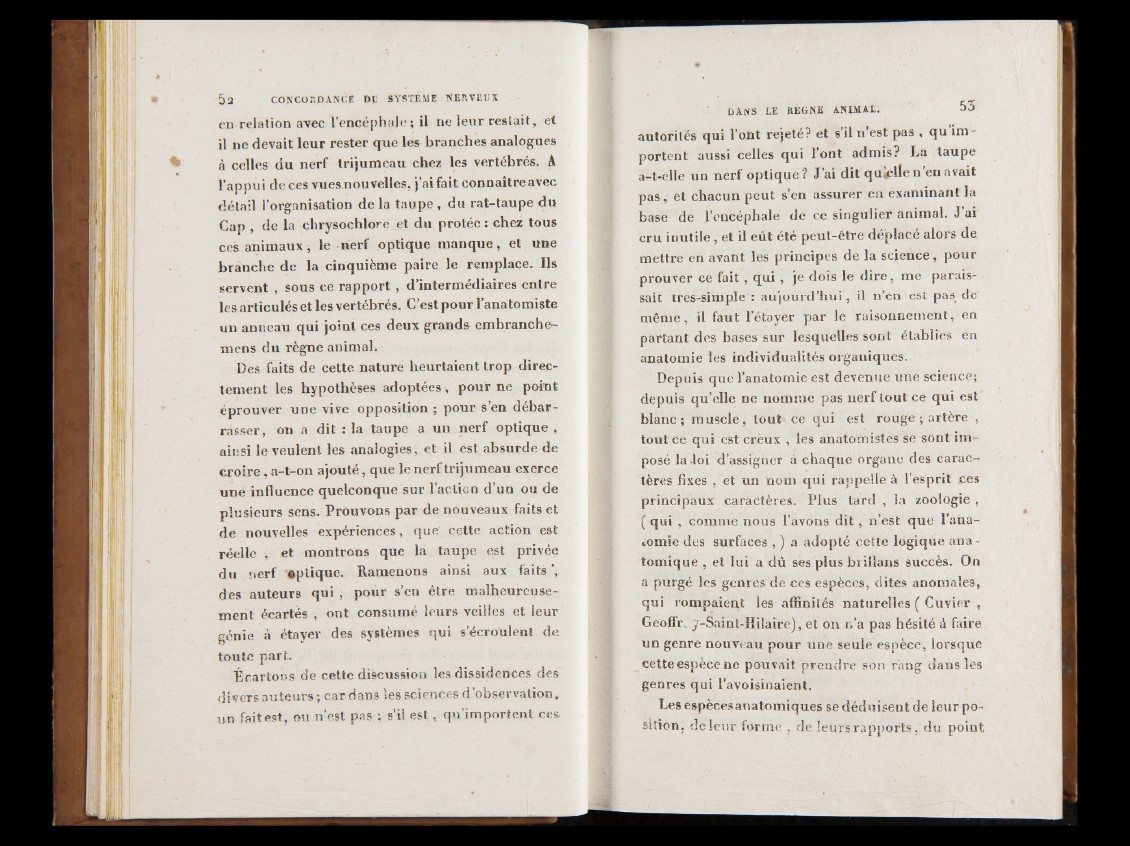
en relation avec l'encéphale; il ne leur restait, et
il ne devait leur rester que les branches analogues
à celles du nerf trijumeau chez les vertébrés. ^
l’appui de ces vues.nouvelles, j ai fait connaitreavec
détail l'organisation de la taupe , du rat-taupe du
Cap , de la chrysochlore et du protée : chez tous
ces animaux, le nerf optique manque, et une
branche de la cinquième paire le remplace, Ils
servent , sous ce rapport , d’intermédiaires entre
les articulés et les vertébrés. C’est pour l’anatomiste
un anneau qui joint ces deux grands embranche-
mens du règne animal.
Des faits de cette nature heurtaient trop directement
les hypothèses adoptées, pour ne point
éprouver une vive opposition ; pour s’en débarrasser,
on a dit : la taupe a un nerf optique,
ainsi le veulent les analogies, et il est absurde de
c roire, a-t-on ajouté, que le nerf trijumeau exerce
uné influence quelconque sur l’action d’un ou de
plusieurs sens. Prouvons par de nouveaux faits et
de nouvelles expériences, que cette action est
réelle , et montrons que la taupe est privée
du nerf #ptique. Ramenons ainsi aux faits ',
des auteurs qui , pour s’en être malheureusement
écartés , ont consumé leurs veilles et leur
génie à étayer des systèmes qui s’écroulent de
toute part.
Écartons de cette discussion les dissidences des
divers auteurs ; car dans les sciences d ’observation,
un fait est, ou n’est pas ; s’il est., qu’importent ces
autorités qui l’oht rejeté? et s’il n’est pas , qu importent
aussi celles qui 1 ont admis? La taupe
a-t-elle un nerf optique ? J ’ai dit quîelle n ’en avait
pas, et chacun peut s’en assurer en examinant la
base de l’encéphale de ce singulier animal. J ai
cru inutile, et il eût été peut-être déplace alors de.
mettre en avant les principes de la science, pour
prouver ce fait , q u i, je dois le dire, me paraissait
tres-simple : aujourd’hu i, il n’en est pas de
même, il fâut l’étayer par le raisonnement, en
partant des bases sur lesquelles sont établies en
anatomie les individualités organiques.
Depuis que l’anatomie est devenue une science;
depuis qu’elle ne nomme pas nerf tout ce qui est
blanc; muscle, tout ce qui est rouge ; artère ,
tout ce qui est cr.èux , les anatomistes se sont imposé
la -loi d’assigner à chaque organe des caractères
fixes , et un nom qui rappelle à l’esprit .ces
principaux caractères. Plus tard , la zoologie ,
( qui , comme nous l’avons d i t , n’est que l’aha-
tomie des surfaces , ) a adopté cette logique ana tomique
, et lui a dû ses plus brillans succès. On
a purgé les genres de ces espèces, dites anomales,
qui rompaient les affinités naturelles ( Cuvier ,
Geofftv y-Saint-Hilaire), et on n’a pas hésité à faire
un genre nouveau pour une seule espèce, lorsque
cette espèce ne pouvait prendre son rang dans les
genres qui l’avoisinaient.
Les espècesanatomiques se déduisent de leur position,
de leur forme , de leurs rapports, du point