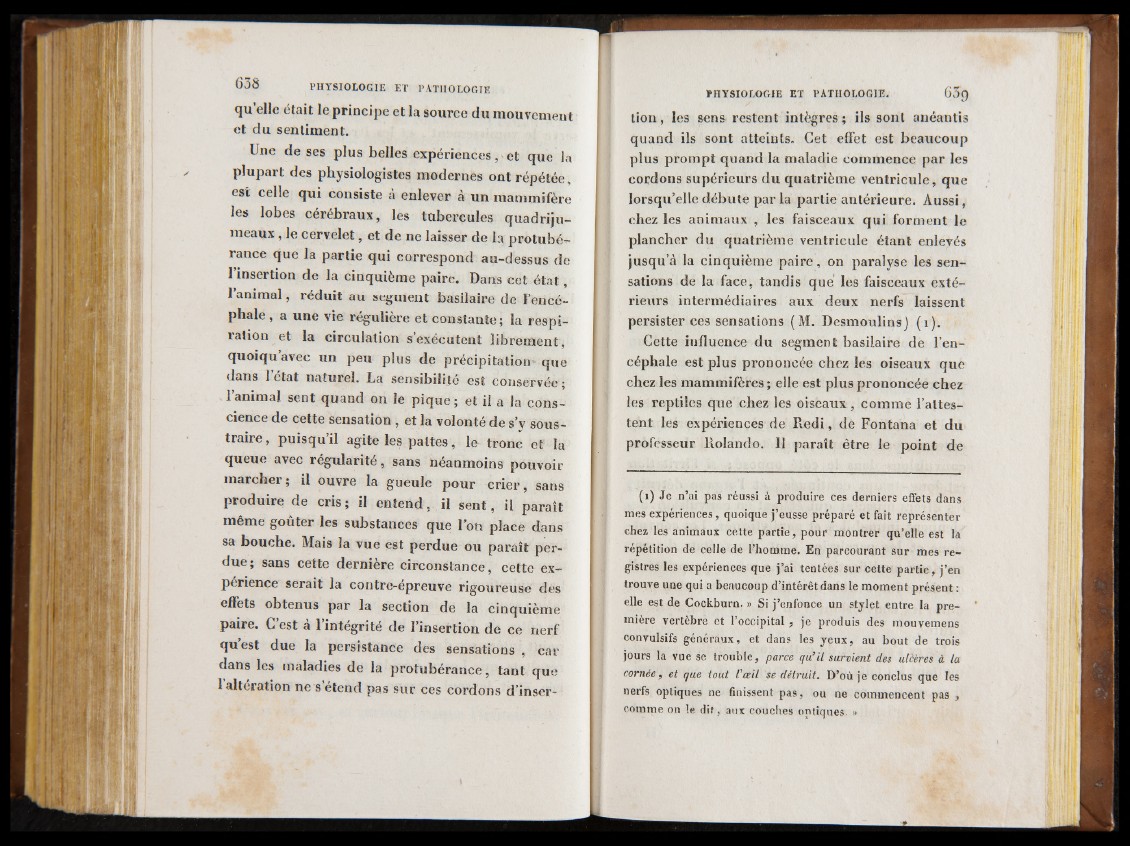
quelle était le principe et la source du mouvement
et du sentiment.
Une de ses plus belles expériences, * et que la
plupart des physiologistes modernes ont répétée,
est celle qui consiste à enlever à un mammifère
les lobes cérébraux, les tûbercules quadrijumeaux
, le cervelet, et de ne laisser de la protubérance
que la partie qui correspond au-dessus de
1 insertion de la cinquième paire. Dans cet état,
1 animal, réduit au segment basilaire de l’encéphale
, a une vie régulière et constante; la respiration
et la circulation s exécutent librement,
quoiqu avec un peu plus de précipitation que
dans 1 état naturel. La sensibilité est conservée ;
l’animal sent quand on le pique; et il a la conscience
de cette sensation , et la volonté de s’v soustraire,
puisquil agite les pattes, le trône et la
queue avec régularité, sans néanmoins pouvoir
marcher; il ouvre la gueule pour crier, sans
produire de cris; il entend, il sent, il paraît
même goûter les substances que l’on place dans
sa bouche. Mais la vue est perdue ou paraît perdue;
sans cette dernière circonstance, cette expérience
serait la contre-épreuve rigoureuse des
effets obtenus par la section de la cinquième
paire. C est à l’intégrité de l’insertion de ce nerf
qu est due la persistance des sensations , car
dans les maladies de la protubérance, tant que
1 altération ne s etend pas sur ces cordons d’insertion,
les sens restent intègres; ils sont anéantis
quand ils sont atteints. Cet effet est beaucoup
plus prompt quand la maladie commence par les
cordons supérieurs du quatrième ventricule, que
lorsqu’elle débute par la partie antérieure. Aussi,
chez les animaux , les faisceaux qui forment le
plancher du quatrième ventricule étant enlevés
jusqu’à la cinquième paire, on paralyse les sensations
de la face, tandis que les faisceaux extérieurs
intermédiaires aux deux nerfs laissent
persister ces sensations (M. Desmoulins) (1).
Cette influence du segment basilaire de l’encéphale
est plus prononcée chez les oiseaux que
chez les mammifères; elle est plus prononcée chez
les reptiles que chez les oiseaux, comme l’attestent
les expériences de Redi, de Fontana et du
professeur Rolando. 11 paraît être le point de
(1) Je n’ai pas réussi à produire ces derniers effets dans
mes expériences, quoique j’eusse préparé et fait représenter
chez les animaux cette partie, pour montrer qu’elle est la
répétition de celle de l’homme. En parcourant sur mes registres
les expériences que j’ai tentées sur celte partie, j’en
trouve une qui a beaucoup d’intérêt dans le moment présent :
elle est de Cockburn. » Si j’enfonce un stylet entre la première
vertèbre et l’occipital, je produis des mouvemens
convulsifs généraux, et dans les yeux, au bout de trois
jours la vue se trouble, parce qu’il survient des ulcères à lu
cornée, et que tout l'oeil se détruit. D’où je conclus que les
nerfs optiques ne finissent pas, ou ne commencent pas ,
comme on le dit, aux couches optiques »