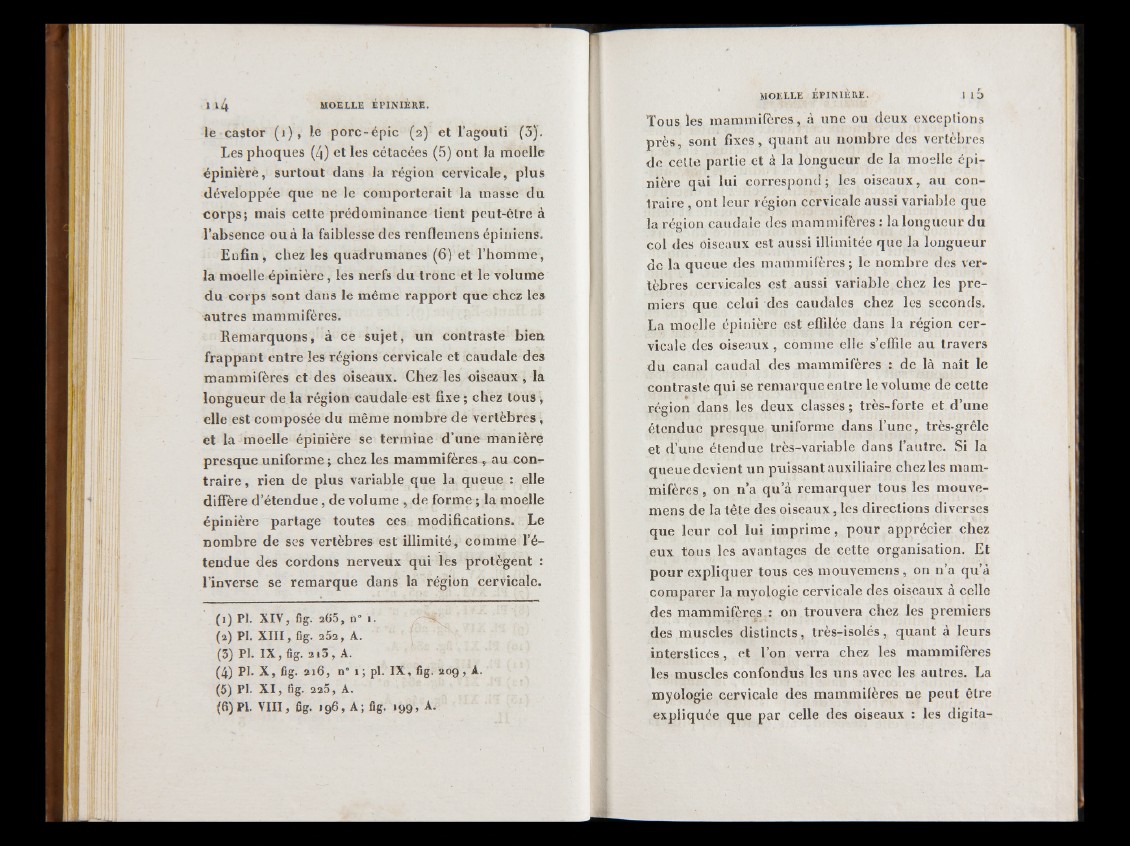
le castor ( i ) , le porc-épic (2) et l’agouti (3).
Les phoques (4) et les cétacées (5) ont la moelle
épinière, surtout dans la région cervicale, plus
développée que ne le comporterait la masse du
corps; mais celte prédominance lient peut-être à
l’absence ou à la faiblesse des renflemens épiniens.
Enfin, chez les quadrumanes (6) et l’homme,
la moelle épinière, les nerfs du tronc et le volume
du corps sont dans le même rapport que chez les
autres mammifères.
Remarquons, à ce sujet, un contraste bien
frappant entre les régions cervicale et caudale des
mammifères et des oiseaux. Chez les oiseaux, la
longueur de la région caudale est fixe ; chez tous,
elle est composée du même nombre de vertèbres,
et la moelle épinière se termine d’une maniéré
presque uniforme ; chez les mammifères , au contraire
, rien de plus variable que la queue elle
diffère d’étendue, de volume , de forme ; la moelle
épinière partage toutes ces modifications. Le
nombre de ses vertèbres est illimité, comme l’étendue
des cordons nerveux qui les protègent :
l’inverse se remarque dans la région cervicale.
(1) PL XIV, fig. 265, n° 1.
(2) PL XIII, fig. 252, A.
(3) PL IX, fig. 2 i3 , A.
(4) PL X, fig. 216, n* 1; pi. IX, fig. 209, A.
(5) PL X I , fig. 225, A.
Tous les mammifères, à une ou deux exceptions
près, sont fixes, quant au nombre des vertèbres
de celle partie et à la longueur de la moelle épinière
qui lui correspond ; les oiseaux, au contra
ire , ont leur région cervicale aussi variable que
la région caudale des mammifères : la longueur du
col des oiseaux est aussi illimitée que la longueur
de la queue des mammifères; le nombre des vertèbres
cervicales est aussi variable chez les premiers
que celui des caudales chez les seconds.
La moelle épinière est effilée dans la région cervicale
des oiseaux, comme elle s’effile au travers
du canal caudal des mammifères : de là naît le
contrasté qui se remarque entre le volume de cette
région dans les deux classes ; très-forte et d’une
étendue presque uniforme dans l’une, très-grêle
et d’une étendue très-variable dans l’autre. Si la
queue devient un puissant auxiliaire chez les mammifères
, on n’a q u a remarquer tous les mouve-
mens de la tête des oiseaux, les directions diverses
que leur col lui imprime, pour apprécier chez
eux tous les avantages de cette organisation. Et
pour expliquer tous ces mouvemens, on n’a qu’à
comparer la myologie cervicale des oiseaux à celle
des mammifères : on trouvera chez les premiers
des muscles distincts, très-isolés, quant à leurs
interstices, et l’on verra chez les mammifères
les muscles confondus les uns avec les autres. La
myologie cervicale des mammifères ne peut être
expliquée que par celle des oiseaux : les digita