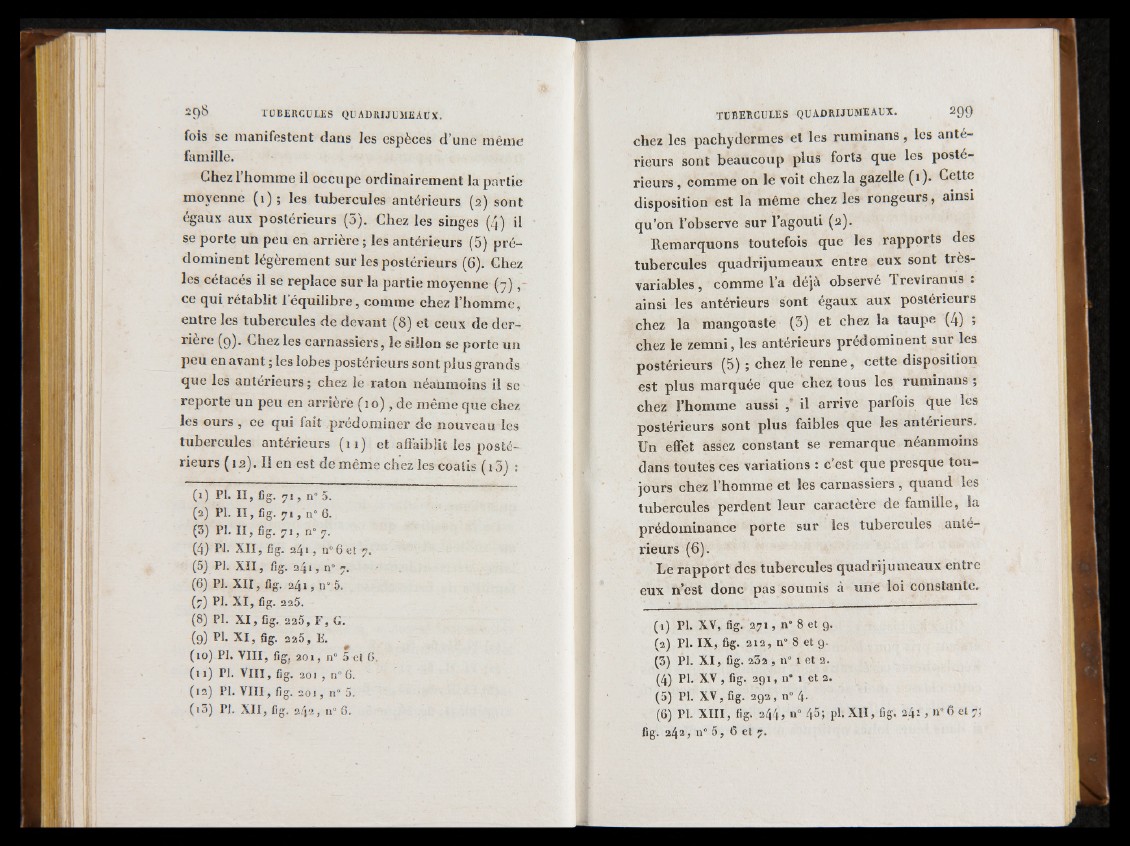
fois se manifestent dans les espèces d’une même
famille.
Chez l’homme il occupe ordinairement la partie
moyenne (1) ; les tubercules antérieurs (2) sont
égaux aux postérieurs (5). Chez les singes (4) il
se porte un peu en arrière ; les antérieurs (5) prédominent
légèrement sur les postérieurs (6). Chez
les cétacés il se replace sur la partie moyenne (7)
ce qui rétablit l’équilibre, comme chez l’homme,
entre les tubercules de devant (8) et ceux de der-
rière (9). Chez les carnassiers, le sillon se porte un
peu en avant ; les lobes postérieurs sont plus grands
que les antérieurs; chez le raton néanmoins il se
reporte un peu en arrière (10), de même que chez
les ours , ce qui fait prédominer de nouveau les
tubercules antérieurs (11) et affaiblit les postérieurs
(12). Il en est de même chez les coatis (i 3) :
(1) PI. II, fig. 71, n° 5.
(2) PI. I I , fig. 71, n° 6.
(3) PI. II, fig. 71, n° 7.
(4) P'I. XII, fig. 241, n°6et 7.
(5) PI. XII, fig. 241, n» 7.
(6) PI. XII, fig. 241, n° 5.
(7) PI. XI, fig. 225.
(8) PI. X I, fig.. 225, F, G.
(9) PI. X I, fig. 225, E.
(10) PI. VIII, fig, 201, n° 5 et 6.
(11) PI. VIII, fig. 201 , n° 6
(12) PI. VIII, fig. 20j , n° 5.
chez les pachydermes et les ruminans, les antérieurs
sont beaucoup plus forts que les postérieurs
, comme on le voit chez la gazelle (1). Cette
disposition est la même chez les rongeurs, ainsi
qu’on l’observe sur l’agouti (a).
Remarquons toutefois que les rapports des
tubercules quadrijumeaux entre eux sont très-
variables , comme l’a déjà observé Treviranus :
ainsi les antérieurs sont égaux aux postérieurs
chez la mangouste (3 ) et chez la taupe (4) ;
chez le zemni, les antérieurs prédominent sur les
postérieurs (5) ; chez le renne, cette disposition
est plus marquée que chez tous les ruminans ;
chez l’homme aussi ,’ il arrive parfois que les
postérieurs sont plus faibles que les antérieurs.
Un effet assez constant se remarque néanmoins
dans toutes ces variations : c est que presque toujours
chez l’homme et les carnassiers , quand les
tubercules perdent leur caractère de famille, la
prédominance porte sur les tubercules antérieurs
(6).
Le rapport des tubercules quadrijumeaux entre
eux n’est donc pas soumis à une loi constante.
(1) PI. XV, fig. 271, n* 8 et 9.
(2) PI. IX, fig. 212, n° 8 et 9.
(3) Pl. X I, fig. 25a , n° 1 et 2.
(4) Pl. XV , fig. 291, n* 1 et 2.
(5) Pl. XV, fig. 292, n° 4.
(6) PL XIII, fig. 244> n° 45; pl. XII, fig. 241, n#6 et 7;
fig’. 24a > n° 5 , 6 et 7.