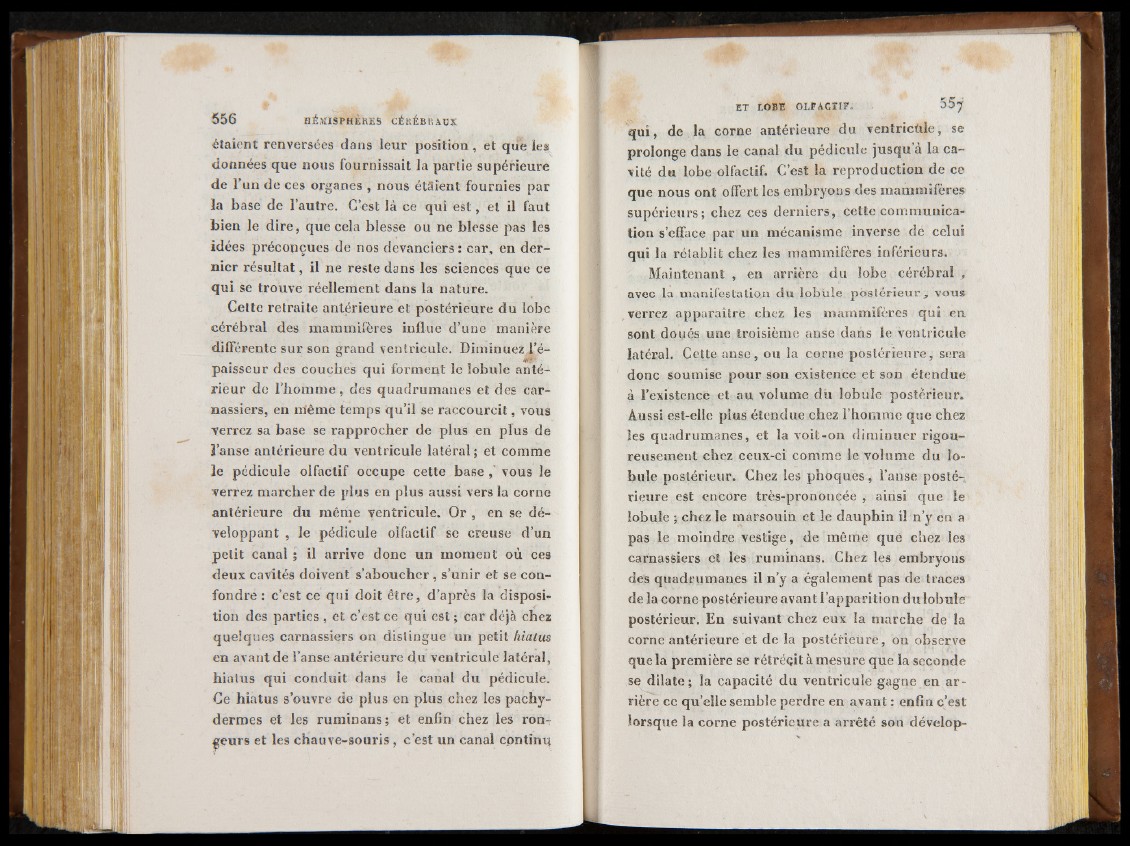
étaient renversées dans leur position, et que les
données que nous fournissait la partie supérieure
de l’un de ces organes , nous étaient fournies par
la base de l’autre. C’est là ce qui e s t, et il faut
bien le dire, que cela blesse ou ne blesse pas les
idées préconçues de nos devanciers : car, en dernier
résultat, il ne reste dans les sciences que ce
qui se trouve réellement dans la nature.
Celte retraite antérieure et postérieure du lobe
cérébral des mammifères influe d’une manière
differente sur son grand ventricule. Diminuez l’é-
paisseur des couches qui forment le lobule anté-
rieur de l’homme, des quadrumanes et des carnassiers,
en même temps qu’il se raccourcit, vous
verrez sa base se rapprocher de plus en plus de
l ’anse antérieure du ventricule latéral; et comme
le pédicule olfactif occupe cette base , vous le
verrez marcher de plus en plus aussi vers la corne
antérieure du même ventricule. Or , en se développant
, le pédicule olfactif se creuse d’un
petit canal ; il arrive donc un moment où ces
deux cavités doivent s’aboucher, s’unir et se confondre
: c’est ce qui doit être, d ’après la disposition
des parties , et c’est ce qui est ; car déjà chez
quelques carnassiers on distingue un petit hiatus
en avant de l’anse antérieure du ventricule latéral,
hiatus qui conduit dans le canal du pédicule.
Ce hiatus s’ouvre de plus en plus chez les pachydermes
et les ruminans; et enfin chez les rongeurs
et les chauve-souris , c’est un canal continu
qui, de la corne antérieure du ventrictile, se
prolonge dans le canal du pédicule jusqu a la cavité
du lobe olfactif. C’est la reproduction de ce
que nous ont offert les embryons des mammifères
supérieurs; chez ces derniers, cette communication
s’efface par un mécanisme inverse de celui
qui la rétablit chez les mammifères inférieurs.
Maintenant , en arrière du lobe cérébral ,
avec la manifestation du lobule postérieur, vous
verrez apparaître chez les mammifères qui en
sont dopés une troisième anse dans le ventricule
latéral. Cette anse, ou la corne postérieure, sera
donc soumise pour son existence et son étendue
à l’existence et au volume du lobule postérieur.
Aussi est-elle plus étendue chez l’homme que chez
les quadrumanes, et la voit-on diminuer rigoureusement
chez ceux-ci comme le volume du lobule
postérieur. Chez les phoques * l’anse postérieure
est encore très-prononcée , ainsi que le
lobule ; chez le marsouin et le dauphin il n’y en a
pas le moindre vestige, de même que chez les
carnassiers et les ruminans. Chez les embryons
des quadrumanes il n’y a également pas de traces
de la corne postérieure avant l’apparition dulobuïe
postérieur. En suivant chez eux la marche de la
corne antérieure et de la postérieure, on observe
que la première se rétrégit à mesure que la seconde
se dilate; la capacité du ventricule gagne en a rrière
ce qu’elle semble perdre en avant : enfin c’est
lorsque la corne postérieure a arrêté son dévelop