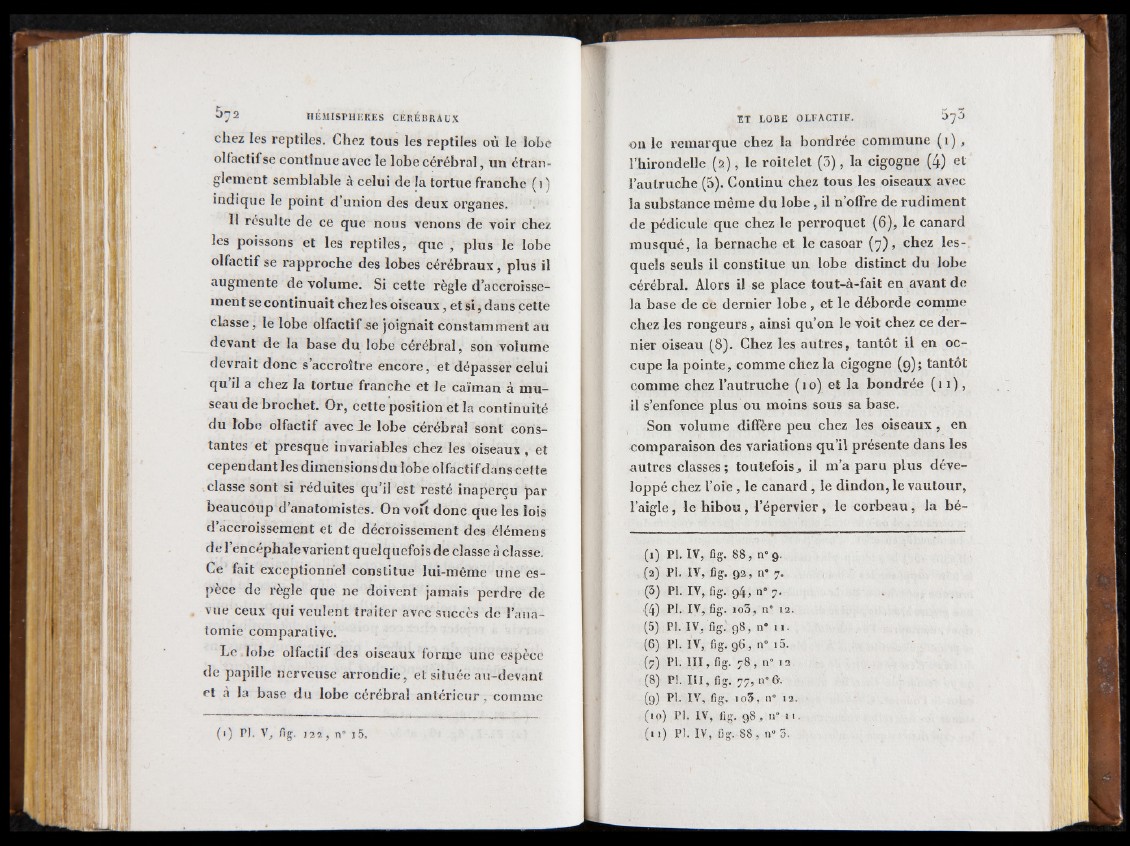
5^2 HEMISPHERES CÉRÉBRAUX
chez les reptiles. Chez tous les reptiles où le lobe
olfactif se continue avec le lobe cérébral, un étranglement
semblable à celui de la tortue franche (1 )
indique le point d’union des deux organes.
Il résulte de ce que nous venons de voir chez
les poissons et les reptiles, que , plus le lobe
olfactif se rapproche des lobes cérébraux, plus il
augmente de volume. Si cette règle d’accroissement
se continuait chez les oiseaux, et si, dans cette
classe, le lobe olfactif se joignait constamment au
devant de la base du lobe cérébral, son volume
devrait donc s accroître encore, et dépasser celui
qu il a chez la tortue franche et le caïman à museau
de brochet. Or, cette position et la continuité
du lobe olfactif avec Je lobe cérébral sont constantes
et presque invariables chez les oiseaux , et
cependant les dimensions du lobe olfactif dans cette
classe sont si réduites qu’il est resté inaperçu par
beaucoup d anatomistes. On voit donc que les lois
d accroissement et de décroissement des élémens
de l’encéphalevarient quelquefois de classe à classe.
Ce fait exceptionnel constitue lui-même une espèce
de règle que ne doivent jamais perdre de
vue ceux qui veulent traiter avec succès de l’anatomie
comparative.
Le lobe olfactif des oiseaux forme une espèce
de papille nerveuse arrondie, et située au-devant
et cà la base du lobe cérébral antérieur, comme
ET LOBE OLFACTIF. 6 7 0
en le remarque chez la bondrée commune ( i ) ,
l’hirondelle (2), le roitelet (3), la cigogne (4) et
l’autruche (5). Continu chez tous les oiseaux avec
la substance même du lobe, il n’offre de rudiment
de pédicule que chez le perroquet (6), le canard
musqué, la bernache et le casoar (7), chez les-,
quels seuls il constitue un lobe distinct du lobe
cérébral. Alors il se place tout-à-fait en avant de
la base de ce dernier lobe , et le déborde comme
chez les rongeurs, ainsi qu’on le voit chez ce dernier
oiseau (8). Chez les autres, tantôt il en occupe
la pointe, comme chez la cigogne (9); tantôt
comme chez l’autruche (10) et la bondrée (11),
il s’enfonce plus ou moins sous sa base.
Son volume diffère peu chez les oiseaux, en
comparaison des variations qu’il présente dans les
autres classes; toutefois., il m’a paru plus développé
chez l’oie, le canard, le dindon, le vautour,
l’aigle, le hibou, l’épervier , le corbeau, la bé-
111
(0 PI. IV, fig. 88 , n” 9.
m Pi. IV, fi g. 92, n* 7.
v PL IV, fig. 94, n° 7.
(4) PI. IV, fig. io3 , n° 12.
(5) Pi. IV, fig.' 98, n# 11.
(6) PI. IV, fig. 96, n° i 5.
(7) PI. I I I .,6 g . 78 , n° 12
(8) P!. III.> Gg. 77, n° &.
(9) PL IV, fig. io3 , n° 12
(>o ) ri. iv ILJ. 98 , II0 ! 1
(11 ) PI. IV, fisj. 88 , n" 5.