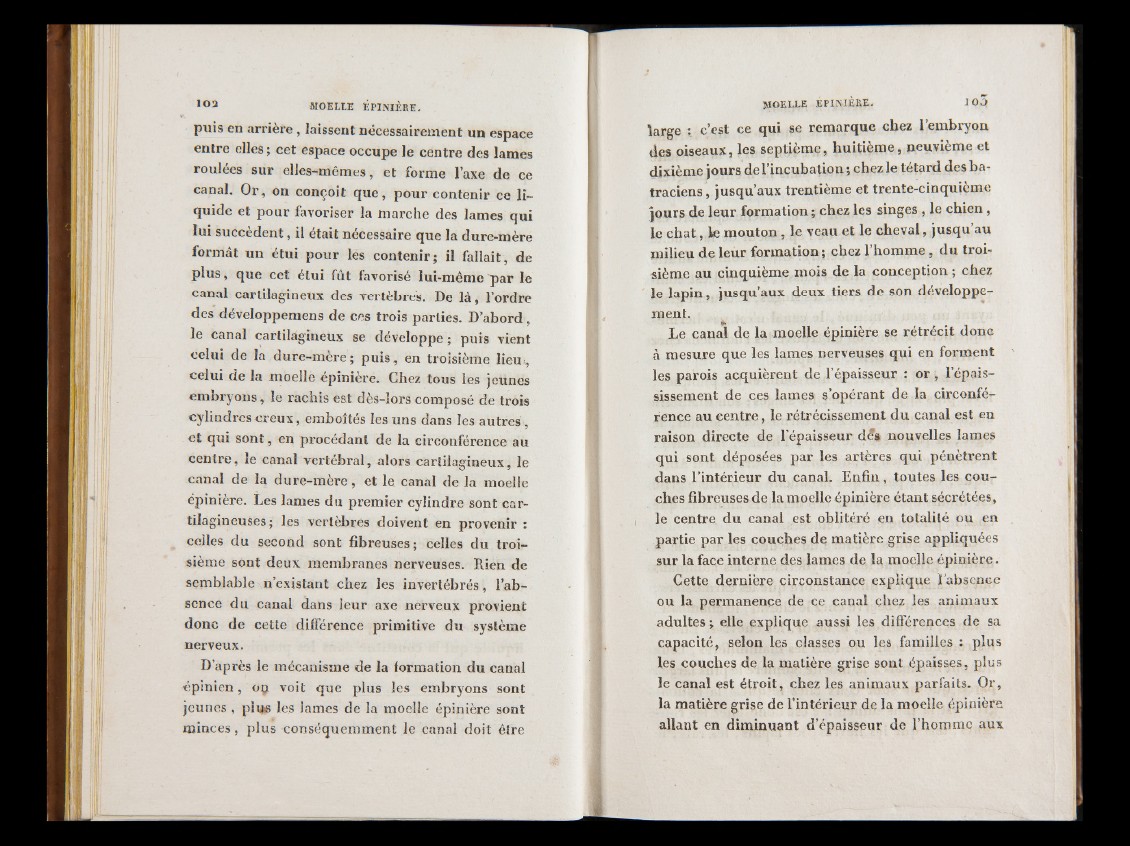
puis en arrière, laissent nécessairement un espace
entre elles ; cet espace occupe le centre des lames
roulées sur elles-mêmes, et forme l’axe de ce
canal. Or, on conçoit que, pour contenir ce liquide
et pour favoriser la marche des lames qui
lui succèdent, il était nécessaire que la dure-mère
formât un étui pour les contenir; il fallait, de
p lu s, que cet étui fût favorisé lui-même par le
canal cartilagineux des vertèbres. De là , l’ordre
des développemens de ces trois parties. D’abord,
le canal cartilagineux se développe ; puis vient
celui de la dure-mère; puis, en troisième lieu,
celui de la moelle épinière. Chez tous les jeunes
embryons, le rachis est dès-lors composé de trois
cylindres creux, emboîtés les uns dans les autres ,
e t qui sont, en procédant de la circonférence au
centre, le canal vertébral, alors cartilagineux, le
canal de la dure-mère, et le. canal de la moelle
épinière. Les lames du premier cylindre sont cartilagineuses;
les vertèbres doivent en provenir:
celles du second sont fibreuses; celles du troisième
sont deux membranes nerveuses. Rien de
semblable n’existant chez les invertébrés, l’absence
du canal dans leur axe nerveux provient
donc de cette différence primitive du système
nerveux.
D’après le mécanisme de la formation du canal
épinien, op voit que plus les embryons sont
jeunes , plus les laines de la moelle épinière sont
minces, plus conséquemment le canal doit être
large : c’est ce qui se remarque chez l’embryon
des oiseaux, les septième, huitième, neuvième et
dixième jours del’incubation ; chez le têtard des batraciens
, jusqu’aux trentième et trente-cinquième
jours de leur formation ; chez les singes , le chien,
le chat,, le m outon, le veau et le cheval, jusqu au
milieu de leur formation ; chez l’homme, du troisième
au cinquième mois de la conception; chez
le lapin, jusqu’aux deux tiers de son développement.
Le canal de la moelle épinière se rétrécit donc
à mesure que les lames nerveuses qui en forment
les patois acquièrent de l’épaisseur : o r , l’épaississement
de ces lamçs s’opérant de la circonfé^
rence au centre, le rétrécissement du canal est en
raison directe de l’épaisseur dis nouvelles lames
qui sont déposées par les artères qui pénètrent
dans l’intérieur du canal. Enfin, toutes les couches
fibreuses de la moelle épinière étant sécrétées,
| le centre du canal est oblitéré en totalité ou en
partie par les couches de matière grise appliquées
sur la face interne des lames de la moelle épinière.
Cette dernière circonstance explique l’absence
ou la permanence de ce canal chez les animaux
adultes ; elle explique aussi les différences de sa
capacité, selon les classes ou les familles : plus
les couches de la matière grise sont épaisses, plus
le canal est étroit, chez les animaux parfaits. Or,
la matière grise de l’intérieur de la moelle épinière
allant en diminuant d’épaisseur de l’homme aux