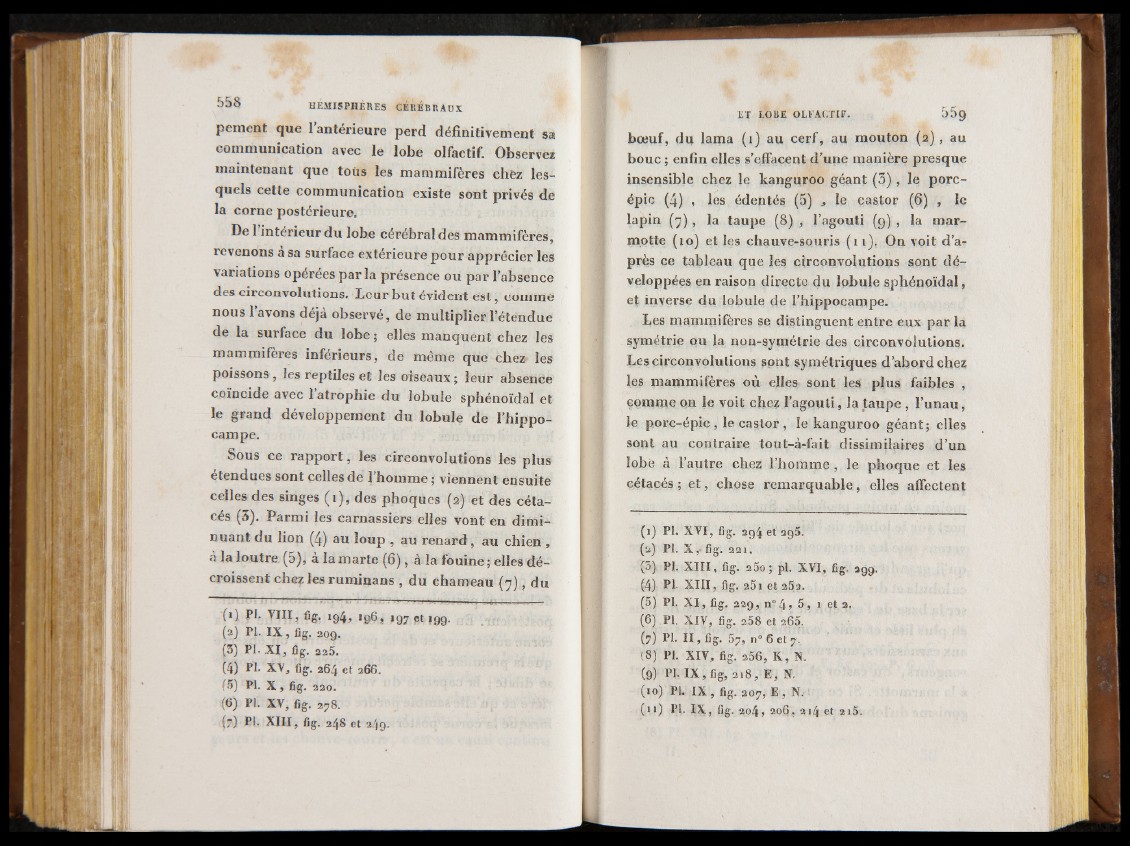
peinent que 1 antérieure perd définitivement sa
communication avec le lobe olfactif. Observez
maintenant que toüs les mammifères chèz lesquels
cette communication existe sont privés de
la corne postérieure.
De 1 intérieur du lobe cérébral des mammifères,
revenons a sa surface extérieure pour apprécier les
variations opérées par la présence ou par l’absence
des circonvolutions. Leur but évident e st, comme
nous lavons déjà observé, de multiplier l’étendue
de la surface du lobe ; elles manquent chez les
mammifères inférieurs, de meme que chez les
poissons, les reptiles et les oiseaux; leur absence
coïncide avec l’atrophie du lobule sphénoïdal et
le grand développement du lobule de l’hippocampe.
Sous ce rap p o rt, les circonvolutions les plus
etendues sont celles de 1 homme ; viennent ensuite
celles des singes (î), des phoques (a) et des cétacés
(3). Parmi les carnassiers elles vont en diminuant
du lion (4) au loup , au renard, au chien ,
à la loutre (5), à la marte (6), à la fouine; elles décroissent
chez les ruminans , du chameau (7), du
(1) , PL VIII, fig. 194,•96 ? *97 et 199.
(2) PI. IX , fig. 209.
(3) PI. XI, fig. 225.
(4 ) f l - X V , fig. 2 6 4 et 266.
(5) PI. X , fig. 220.
(6) PL XV, fig. 278.
boeuf, du lama (1) au cerf, au mouton (2), au
bouc ; enfin elles s’effacent d ’une manière presque
insensible che? le kanguroo géant (5) , le porc-
épic (4) , les édentés (5) le castor (6) , le
lapin (7), la taupe (8) , l’agouti (9) , la marmotte
(10) et les chauve-souris (11), On voit d’après
ce tableau que les circonvolutions sont développées
en raison directe du lobule sphénoïdal,
et inverse du lobule de l’hippocampe.
Les mammifères se distinguent entre eux par la
symétrie ou la non-symétrie des circonvolutions.
Les circonvolutions sont symétriques d ’abord chez
les mammifères où elles sont les plus faibles ,
comme on le voit che? l’agouti, la taupe , l’unau,
le porc-épic, le castor, le kanguroo géant; elles
sont au contraire tout-à-fait dissimilaires d ’un
lobé à l’autre chez l’homme, le phoque et les
cétacés; e t, chose remarquable, elles affectent
(1) PL XVI, fig. 294 et 295.
(2) PI. X,- fig. 221.
(3) PL XIII, fig. 25o; pl. XVI, fig. 399.
(4) Pl- XIII, fig. 251 et 25a.
(5) Pl. 3LI, fig. 229, n°4 j 5 , 1 et 2.
(6) PL XIV, fig. 258 et 265.
(7) PL I I , fig. 57, n° 6 et 7.
(8) PL XIV, fig. 256, K, N.
(9) PL IX , fig, 218, E , N.
(10) PL IX, fig. 207, E, N,