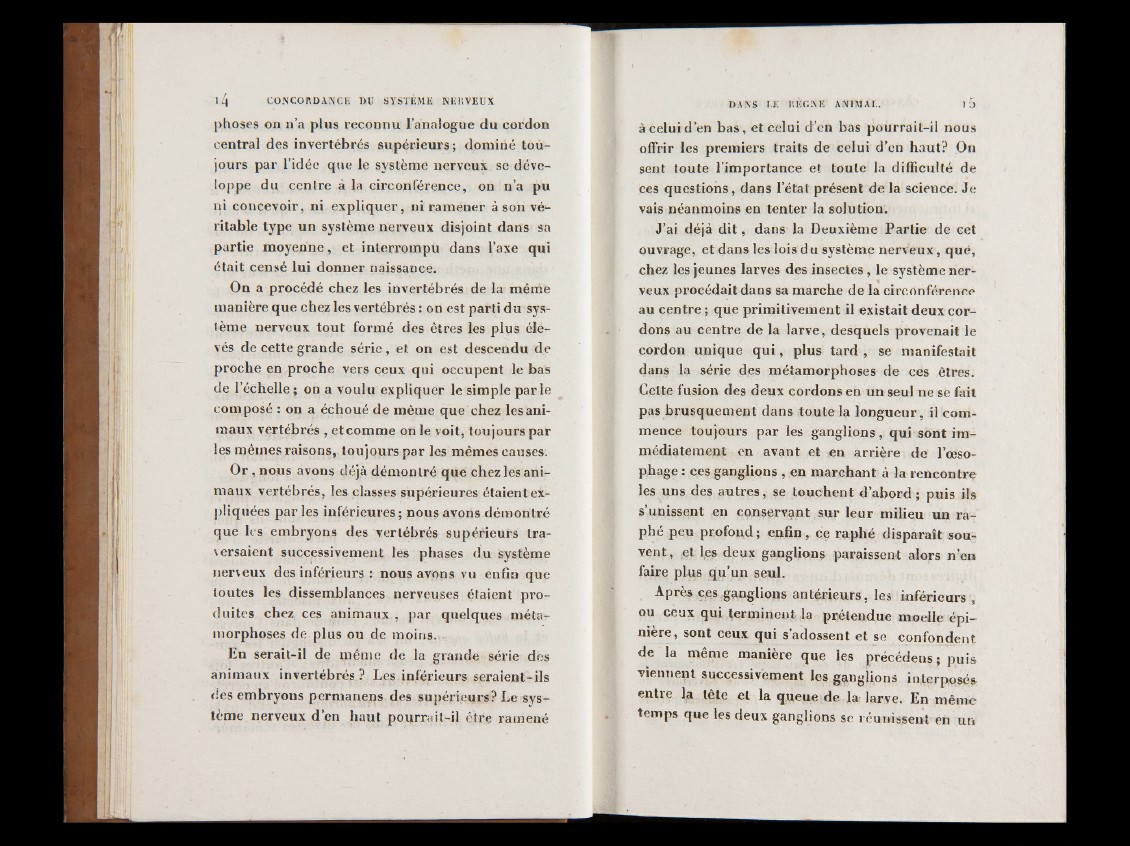
phoses on n’a plus reconnu l’analogue du cordon
central des invertébrés supérieurs; dominé toujours
par l’idée que le système nerveux, se développe
du centre à la circonférence, on n’a pu
ni concevoir, ni expliquer, ni ramener à son \é>-
ritable type un système nerveux disjoint dans sa
partie moyenne, et interrompu dans l’axe qui
était censé lui donner naissance.
On a procédé chez les invertébrés de la même
manière que chez les vertébrés : on est parti du système
nerveux tout formé des êtres les plus élevés
de cette grande série, et on est descendu de
proche en proche vers ceux qui occupent le bas
de l’échelle ; on a voulu expliquer le simple parle
composé : on a échoué de même que chez les animaux
vertébrés , et comme on le voit, toujours par
les mêmes raisons, toujours par les mêmes causes.
O r, nous avons déjà démontré que chez les animaux
vertébrés, les classes supérieures étaient expliquées
par les inférieures; nous avons démontré
que les embryons des vertébrés supérieurs traversaient
successivement les phases du système
nerveux des inférieurs : nous avons vu enfin que
toutes les dissemblances nerveuses étaient produites
chez ces animaux , par quelques méta+
inorphoses de plus ou de moins.
En serait-il de même de la grande série des
animaux invertébrés ? Les inférieurs seraient-ils
fies embryons permanens des supérieurs? Le système
nerveux d ’en haut ponmdt-il être ramené
àceluid’en bas, et celui d’en bas pourrait-il nous
offrir les premiers traits de celui d’en haut? On
sent toute l’importance et toute la difficulté de
ces questions, dans l’état présent de la science. Je
vais néanmoins en tenter la solution.
J’ai déjà d i t , dans la Deuxième Partie de cet
ouvrage, et dans les lois du système nerveux, que,
chez les jeunes larves des insectes , le système nerveux
procédait dans sa marche de la circonférence
au centre ; que primitivement il existait deux cordons
au centre de la larve, desquels provenait le
cordon unique q u i, plus tard , se manifestait
dans la série des métamorphoses de ces êtres.
Cette fusion des deux cordons en un seul ne se fait
pas brusquement dans toute la longueur, il commence
toujours par les ganglions, qui sont immédiatement
en avant et en arrière de l’oeso-
phage : ces ganglions , en marchant à la rencontre
les uns des autres, se touchent d’abord ; puis ils
s’unissent en conservant sur leur milieu un ra-
phé peu profond; enfin , ce raphé disparaît souvent,
et les deux ganglions paraissent alors n ’en
faire plus qu’un seul.
Après ces ganglions antérieurs. les inférieurs ,
ou ceux qui terminent la prétendue moelle épinière,
sont ceux qui s’adossent et se confondent
de la même manière que les précédens ; puis
viennent successivement les ganglions interposés
entie la tête et la queue de la larve. En même
temps que les dèux ganglions se réunissent en un