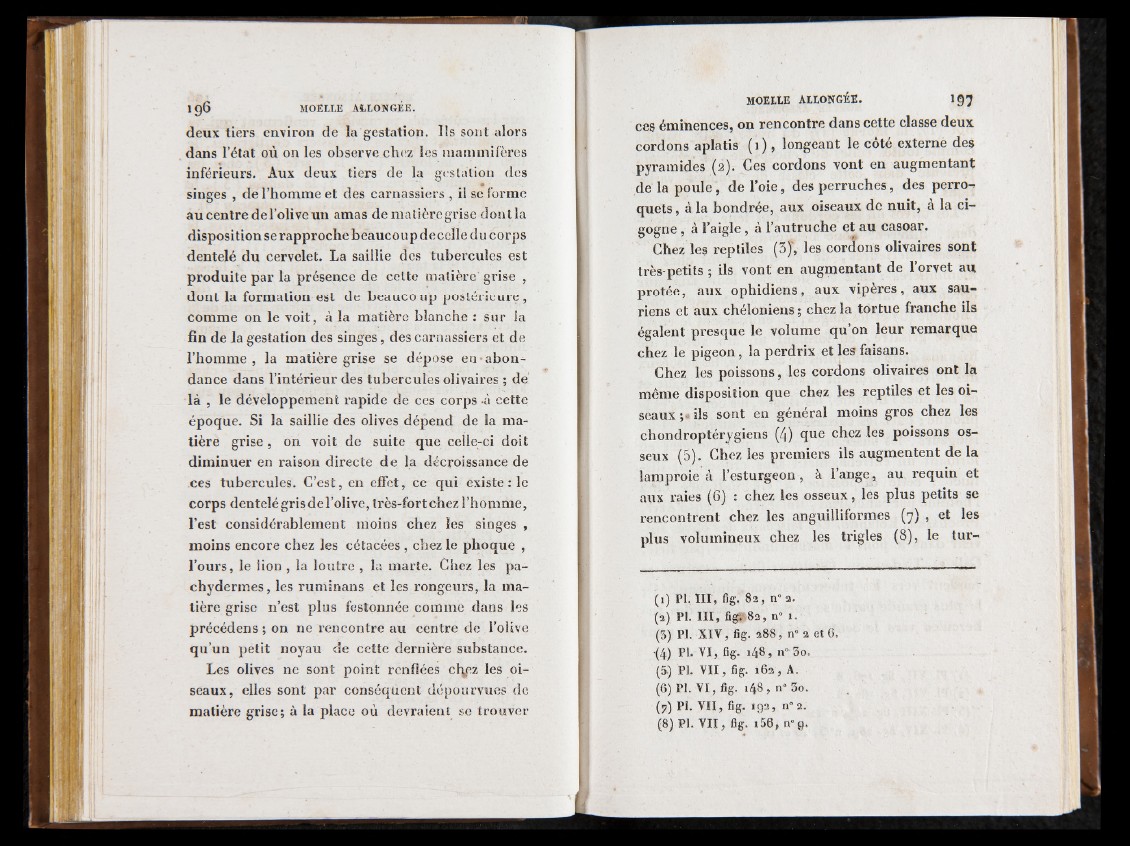
deux tiers environ de la gestation, lis sont alors
dans l’état où on les observe chez les mammifères
inférieurs. Aux deux tiers de la gestalion des
singes , de l’homme et des carnassiers , il se forme
aucentre de l’olive un amas de matière grise dontla
disposition se rapproche beaucoup decelle du corps
dentelé du cervelet. La saillie des tubercules est
produite par la présence de celte matière grise ,
dont la formation est de beaucoup postérieure,
comme on le voit, à la matière blanche : sur la
fin de la gestation des singes, des carnassiers et de
l’homme , la matière grise se dépose en-abon^-
dance dans l’intérieur des tubercules olivaires ; de'
là , le développement rapide de ces corps à cette
époque. Si la saillie des olives dépend de la matière
grise , on voit de suite que celle-ci doit
diminuer en raison directe de la décroissance de
ces tubercules. C’est, en effet, ce qui existe : le
corps dentelé gris de l’olive, très-fort chez l’homme,
l’est considérablement moins chez les singes ,
moins encore chez les cétacées , chez le phoque ,
l’ours, le lion , la loutre , la marte. Chez les pachydermes,
les ruminans et les rongeurs, la matière
grise n’est plus festonnée comme dans les
précédens ; on ne rencontre au centre de l’olive
qu’un petit noyau de cette dernière substance.
Les olives ne sont point renflées cl\pz les oiseaux,
elles sont par conséquent dépourvues de
matière grise; à la place où devraient se trouver
MOELLE ALLONGÉE. 197
ces éminences, on rencontre dans cette classe deux
cordons aplatis (1), longeant le côté externe des
pyramides (2). Ces cordons vont en augmentant
de la poule, de l’oie, des perruches, des perro->
quets, à la bondrée, aux oiseaux de nuit, a la cigogne
, à l’aigle , à l’autruche et au casoar.
Chez les reptiles les cordons olivaires sont
très-petits ; ils vont en augmentant de l’orvet au
protée, aux ophidiens, aux vipères, aux sauriens
et aux chéloniens ; chez la tortue franche ils
égalent presque le volume qu’on leur remarque
chez le pigeon, la perdrix et les faisans.
Chez les poissons, les cordons olivaires ont la
même disposition que chez les reptiles et les oiseaux;*
ils sont en général moins gros chez les
chondroptérygiens (4) que chez les poissons osseux
(5). Chez les premiers ils augmentent de la
lamproie à l’esturgeon, à l’angex au requin et
aux raies (6) : chez les osseux, lés plus petits se
rencontrent chez les anguilliformes (7) , et les
plus volumineux chez les trigles (8), le tur-
(1) p|;ïilw fig. 82, n° 2.
(а) PI. III, fig»8a, n *i.
(3) PI. XIV, fig. 288, n° 2 et 6.
•(4) PI. VI, fig. 148, n°'3o.
E PI. VII, fig. 162 , A.
(б) PI. VI, fig. 148, n° 3o.
(?) PI. VII, fig. 193, n° 2.
(8) PI. VII, fig. i 56, rrg.