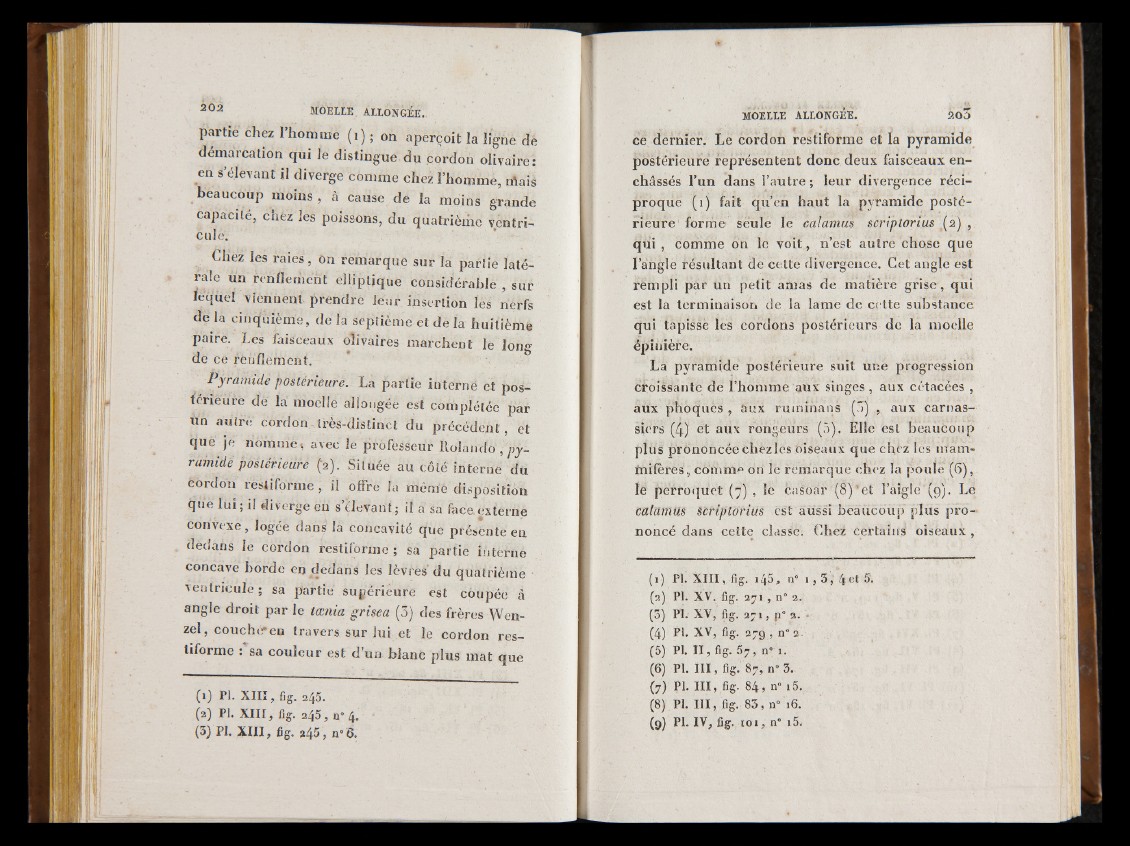
partie chez l'homme (i) ; on aperçoit la ligne dé
démarcation qui le distingue du cordon olivaire:
en s’élevant il diverge comme chez l’hommè, niais
beaucoup moins , à cause de la moins grande
capacité, cnez les poissons, du quatrième ventricule.
Chez les raies, on remarque sur la partie latérale
un rendement elliptique considérable , sur
lequel viennent prendre leur insertion les nerfs
de la cinquième, de la septième et de la huitième
paire. Les faisceaux olivaires marchent le long
de ce renflement.
Pyramide postérieure. La partie interné et postérieure
de la moelle allongée est complétée par
un autre cordon très-distinct du précédent, et
què je nommé-, avec le professeur llolando , pyramide
postérieure (2). Située au côté interne du
cordon restiforme, il offre la même disposition
que lui ; il diverge en s’élevant; il a sa facaextéme
convexe, logée dans la concavité que présente en
dedans le cordon restiforme ; sa partie interné
concave borde en dedans les lèvrès' du quatrième
ventricule ; sa partie supérieure est coupée à
angle droit par le taenia grisea (3) des frères Wen-
zel, couche*en travers sur lui et le cordon restiforme
: sa couleur est d’un blanc plus mat que 1 2
(1) PI. XIII, fig. 245.
(2) PI. XIII, fig. 245, n° 4.
MOELLE ALLONGÉE,
ce dernier. Le cordon restiforme et la pyramide
postérieure représentent donc deux faisceaux enchâssés
l’un dans l’autre ; leur divergence réciproque
(1) fait qu’en haut la pyramide postérieure
forme- seule le calamus sçriplorius (2) ,
qui , comme on le voit, n’est autre chose que
l ’angle résultant de cette divergence. Cet angle est
rempli par un petit amas de matière grise, qui
est la terminaison de la lame de cette substance
qui tapisse les cordons postérieurs de la moelle
épinière.
La pyramide postérieure suit une progression
croüsante de l’homme aüx singes, aux cétacées ,
aux phoques , aux rumina ns (3) , aux carnassiers
(4) et aux rongeurs (5). Elle est beaucoup
plus prononcée chezlcs oiseaux que chez les nïam-
ftiifères , comme on lé remarque chez la poule (6),
lé perroquet (7) , le çaèoar '(8) *et Tàiglé' (9). Le
calamus êtriptdriüs est aussi beaucoup plus prononcé
dans cette classe. Che;z certains oisèaux,
(0 P). XIII, fi§ 145, n6
m PI. XV • fio- 271 , n0 2.
(5) PI. XV> %• 271, ji'1 2.
(4) Pi. XV? fig- 279.» ci° 2.
C5) PI. II , fig. 5S » n° 1•
(6) PI. III > fig- 87, n° 3.
(7) PI. III ? fig- 84 , n° x5.
(8) PI. III » fig- 83, n° 16.
(9) PI. IV, fig- '[Oi, n” i5.