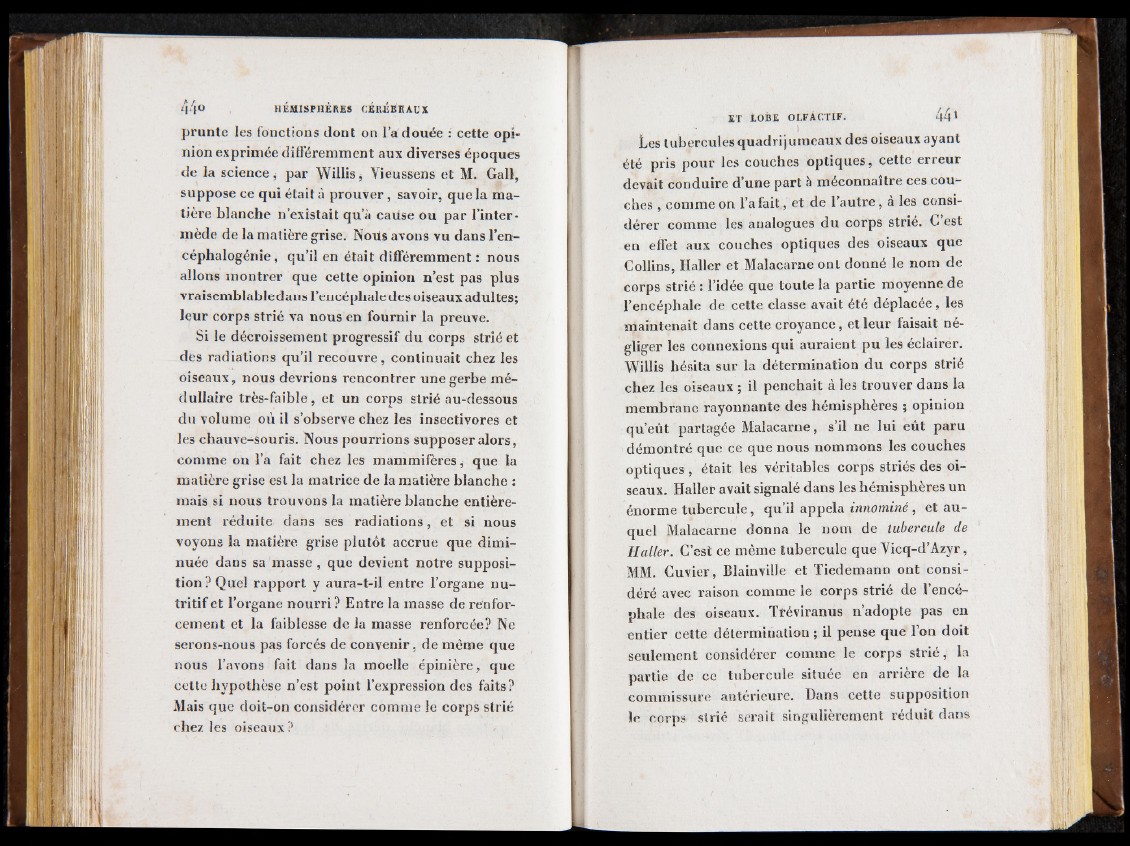
prunte les fonctions dont on l’a douée : cette opinion
exprimée différemment aux diverses époques
de la science* par Willis* Yieussens et M. Gall,
suppose ce qui était à prouver, savoir, que la matière
blanche n’existait qu’à caüse ou par l’intermède
de la matière grise. Noiis avons vu dans l’en-
céphalogénie, qu’il en était différemment : nous
allons montrer que cette opinion n’est pas plus
vraisemblable dans l’encéphale des oiseaux adultes;
leur corps strié va nous en fournir la preuve.
Si le décroissement progressif du corps strié et
des radiations qu’il recouvre, continuait chez les
oiseaux, nous devrions rencontrer une gerbe médullaire
très-faible, et un corps strié au-dessous
du volume où il s’observe chez les insectivores et
les chauve-souris. Nous pourrions supposer alors,
comme on l’a fait chez les mammifères* que la
matière grise est la matrice de la matière blanche :
mais si nous trouvons la matière blanche entièrement
réduite dans ses radiations, et si nous
voyons la matière grise plutôt accrue que diminuée
dans sa masse , que devient notre supposition?
Quel rapport y aura-t-il entre l’organe nutritif
et l’organe nourri? Entre la masse de renforcement
et la faiblesse de la masse renforcée? Ne
serons-nous pas forcés de convenir, de même que
nous l’avons fait dans la moelle épinière, que
cette hypothèse n’est point l’expression des faits?
Mais que doit-on considérer comme le corps strié
chez les oiseaux?
Les tubercules quadrijumeaux des oiseaux ayant
été pris pour les couches optiques* cette erreur
devait conduire d’une part à méconnaître ces couches
, comme on l’a fait, et de l’au tre , a les considérer
comme les analogues du corps strié. C est
en effet aux couches optiques des oiseaux que
Collins, Haller et Malacarne ont donné le nom de
corps strié : l’idée que toute la partie moyenne de
l’encéphale de cette classe avait été déplacée, les
maintenait dans cette croyance, et leur faisait négliger
les connexions qui auraient pu les éclairer.
Willis hésita sur la détermination du corps strié
chez les oiseaux ; il penchait à les trouver dans la
membrane rayonnante des hémisphères ; opinion
qu’eût partagée Malacarne, s’il ne lui eût paru
démontré que ce que nous nommons les couches
optiques , était les véritables corps striés des oiseaux.
Haller avait signalé dans les hémisphères un
énorme tubercule, qu’il appela innommé, et auquel
Malacarne donna le nom de tubercule de
Haller. C’est ce même tubercule que Vicq-d’Azyr,
MM. Cuvier, Blainville et Tiedemann ont considéré
avec raison comme le corps strié de l’encéphale
des oiseaux. Ttéviranus n’adopte pas en
entier cette détermination ; il pense que l’on doit
seulement considérer comme le corps strié, la
partie de ce tubercule située en arrière de la
commissure antérieure. Dans cette supposition
le corps strié serait singulièrement réduit dans