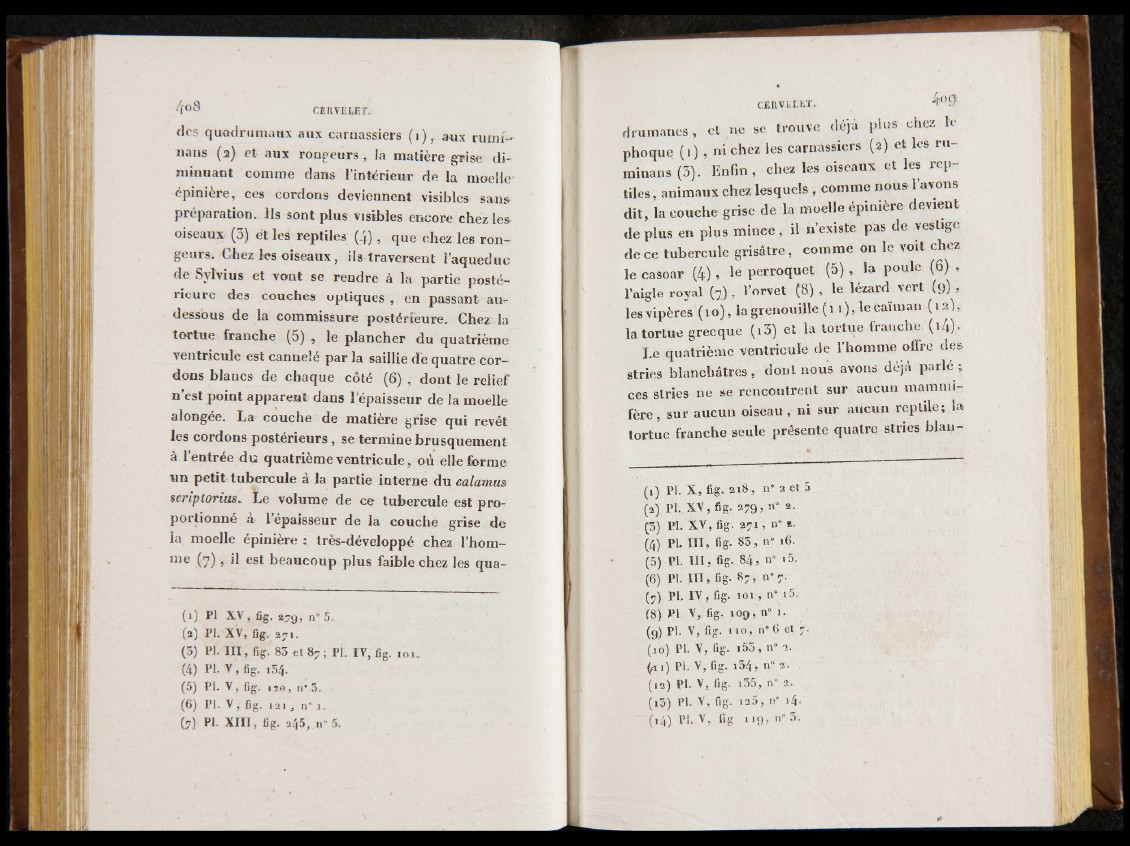
des qundrumaux aux carnassiers ( j) , aux ruinio
n s (2) et aux rondeurs, la matière grise diminuant
comme dans l’intérieur de la moelle
épinière, ees cordons deviennent visibles sans
préparation. Us sont plus visibles encore chez les
oiseaux (3) et les reptiles (4) , que chez les rongeurs.
Chez les oiseaux, ils traversent l’aqueduc
de Sylvius et vont se rendre à la partie postérieure
des couches optiques , en passant au-
dessous de la commissure postérieure. Chez la
tortue franche (5) , le plancher du quatrième
ventricule est cannelé par la saillie de quatre cordons
blancs de chaque côté (6) , dont le relief
n ’est point apparent dans l’épaisseur de la moelle
alongée. La couche de matière grise qui revêt
les cordons postérieurs, se termine brusquement
à l’entrée du quatrième ventricule, ou elle forme
un petit tubercule à la partie interne du calamus
scriptorius. Le volume de ce tubercule est proportionné
à l’épaisseur de la couche grise de
la moelle épinière : très-développé chez l’hom-
me (?) > *1 est beaucoup plus faible chez les qua-
(1) PI XV, fig. 279, n° 5.
(а) PI. XV, fig. 271.
(3) PI. III, fig. 83 et 87 ; PL IV, fig. 101.
(4) Pi. v , fig. ,54.
(5) PI. V,fig. I20, n* 3.
(б) PI. V, fig. ,2 1 , n° 1.
(7) PI. XIII, fig. 245, ir 5.
drumaues , et ne se trouve déjà plus chez te
phoque (1) , ni chez les carnassiers (2) et les ru-
minans (3). Enfin, chez les oiseaux et les reptiles,
animaux chez lesquels y comme nous l’avons
dit, la couche grise de la moelle épinière devient
de plus en plus mince , il n’existe pas de vestige
de ce tubercule grisâtre, comme on le voit chez
le casoar (4), le perroquet (5) , la poule (6) ,
l’aigle royal (7), l’orvet (8) , le lézard vert (9) ,
lesvipères (10), la grenouille (11), le caïman (12Ï,
la tortue grecque ( i 3) et la tortue franche
Le quatrième ventricule de l’homme offre des
stries blanchâtres, dont nous avons déjà parlé;
ces stries ne se rencontrent sur aucun mammifère,
sur aucun oiseau , ni sur aucun reptile; la
tortue franche seule présente quatre stries blan-
(1) PI. X, fig. 218 , n' 3 et 5
(2) PI. XV, fig. 279, n° 2.
(3) PI- XV, fig. 271, n° s.
(4) PL III, fig. 83, n° 16.
(5) PL III, fig. 84, n° là*.
(6) PL III, fig. 87, n° 7-
(7) PL IV, fig. îo x , n* i 5.
( 8 ) PL V, fig. 109, n » j .
(9) PL V, fig. n o , n* 6 et 7.
(10) PL V, ftg. 155, n" 2.
$ ïij PL V, fig. i 34, n” 2.
(12) PL V, fig. i 35, n" 2.
( i5) PL V, fig. 125, ne 14.
(14) PL V, fig 119, n” 3.