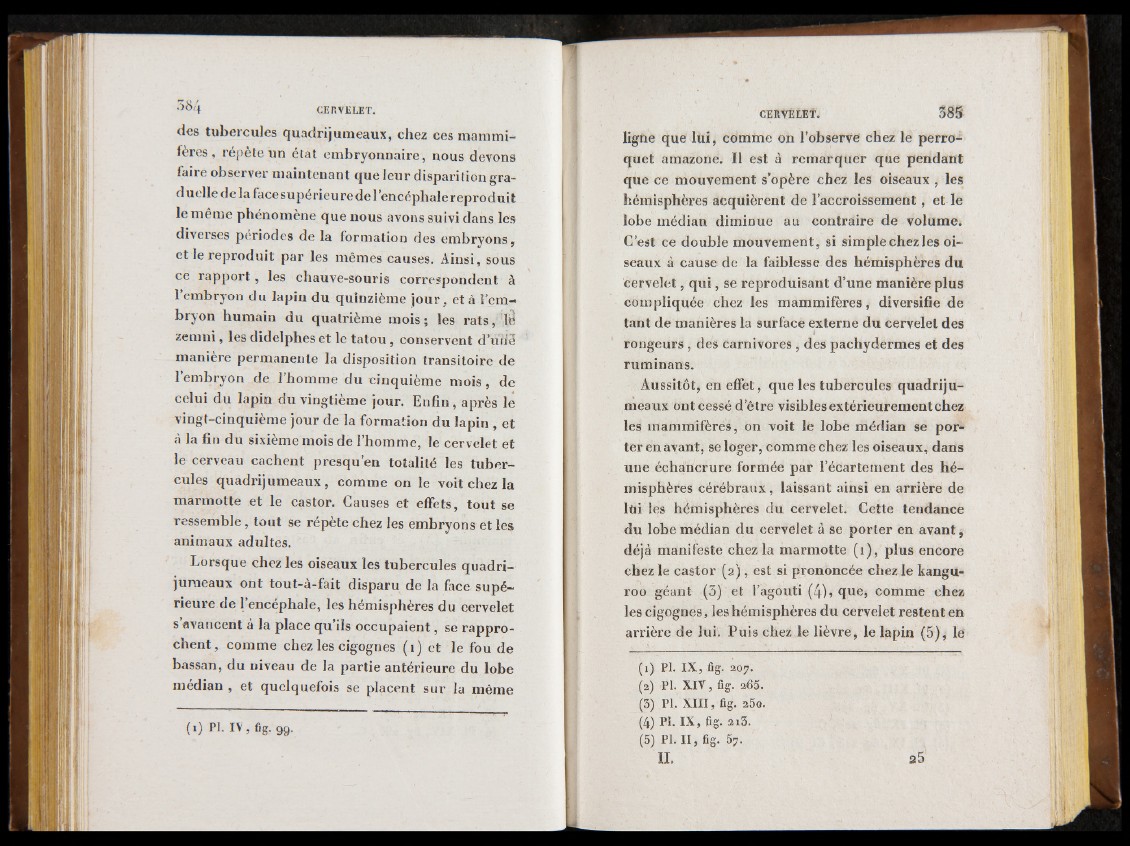
des tubercules quadrijumeaux, chez ces mammifères
, répète un état embryonnaire, nous devons
faire observer maintenant que leur disparition graduelle
de la face supérieure de l’encéphale reproduit
le même phénomène que nous avons suivi dans les
diverses périodes de la formation des embryons,
et le reproduit par les mêmes causes. Ainsi, sous
ce rapport, les chauve-souris correspondent à
1 embryon du lapin du quinzième jour, et à l’embryon
humain du quatrième mois; les rats, fil
zenuii > les didelphes et le ta to u , conservent d’uh'3
manière permanente la disposition transitoire de
l’embryon de l’homme du cinquième mois, de
celui du lapin du vingtième jour. Enfin, après le
vingt-cinquième jour de la formation du lapin , et
à la fin du sixième mois de l’homme, le cervelet et
le cerveau cachent presqu’en totalité les tubercules
quadrijumeaux, comme on le voit chez la
marmotte et le castor. Causes et effets, tout se
ressemble, tout se répète chez les embryons et les
animaux adultes.
Lorsque chez les oiseaux les tubercules quadrijumeaux
ont tout-à-fait disparu de la face supérieure
de l’encéphale, les hémisphères du cervelet
s avancent a la place qu’ils occupaient, se rapprochent,
comme chez les cigognes (1) et le fou de
bassan, du niveau de la partie antérieure du lobe
médian , et quelquefois se placent sur la même
ligne que lui, comme on l’observe chez le perro*^
quel amazone. Il est à remarquer que pendant
que ce mouvement s’opère chez les oiseaux , les
hémisphères acquièrent de l’accroissement, et le
lobe médian diminue au contraire de volume*
C’est ce double mouvement, si simple chez les oiseaux
à cause de la faiblesse des hémisphères du
cervelet, q u i, se reproduisant d’une manière plus
compliquée chez les mammifères, diversifie de
tant de manières la surface externe du cervelet des
rongeurs , des Carnivores , des pachydermes et des
ruminans.
Aussitôt, en effet, que les tubercules quadrijumeaux
ont cessé d’être visibles extérieurement chez
les mammifères, on voit le lobe médian se porter
en avant, se loger, comme chez les oiseaux, dans
une échancrure formée par l’écartement des hémisphères
cérébraux, laissant ainsi en arrière de
loi les hémisphères du cervelet. Cette tendance
du lobe médian du cervelet à se porter en avant,
déjà manifeste chez la marmotte (î), plus encore
chez le castor (2), est si prononcée chez le tangu-
roo géant (3) et l’agouti (4), que, comme chez
les cigognes , les hémisphères du cervelet restent en
arrière de lui. Puis chez le lièvre, le lapin (5), le
( 1 ) P I . I X , f ig . 2 0 7 .
(2) PI. X IV , fig. 265.
(3) PI. X I I I , fig. a5o.
(4) P I . I X , f ig . 2 1 3.
(5) PI. I I , fig. 57.
IL