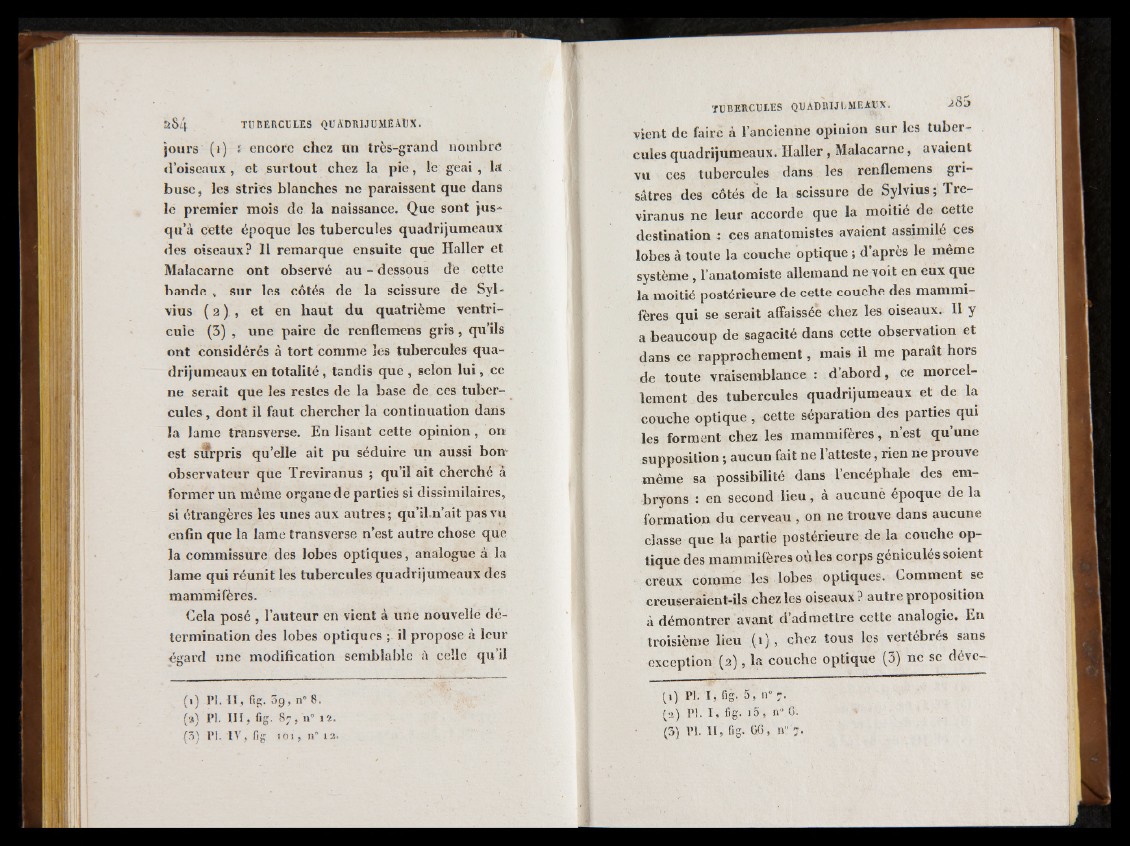
S S 4 TUBERCULES QUADRIJUMEAUX,
jours (i) : encore chez tïn très-grand nombre
d’oiseaux, et surtout chez la p ie, le geai , la
buse, les stries blanches ne paraissent que dans
le premier mois de la naissance. Que sont jusqu’à
cette époque les tubercules quadrijumeaux
des oiseaux? Il remarque ensuite que Haller et
Malacarne ont observé au - dessous de cette
bande , sur les côtés de la scissure de Syl-
vins ( 2 )., et en haut du quatrième ventricule
(3) , une paire de renflemens gris, qu’ils
ont considérés à tort comme les tubercules quadrijumeaux
en totalité , tandis que , selon lu i, ce
ne serait que les restes de la base de ces tubercules
, dont il faut chercher la continuation dans
la lame transverse. En lisant cette opinion, on
est surpris qu’elle ait pu séduire un aussi bonv
observateur que Treviranus ; qu’il ait cherché à
former un même organe de parties si dissimilaires,
si étrangères les unes aux autres; qu’il.n’ait pas vu
enfin que la lame transverse n’est autre chose que
la commissure des lobes optiques, analogue à la
lame qui réunit les tubercules quadrijumeaux des
mammifères.
Cela posé , l’auteur en vient à une nouvelle détermination
des lobes optiques il propose à leur
égard une modification semblable à celle qu’il
(1) PI. II, Gg. 5g , n° 8.
(a) PI. III, Gg. 87, n* îs.
(5) PI. IV, fig 101, n" 12.
vient de faire à l’ancienne opinion sur les tubercules
quadrijumeaux. Haller , Malacarne, avaient
vu ces tubercules dans les renflemens grisâtres
des côtés de la scissure de Sylvius ; Treviranus
ne leur accorde que la moitié de cette
destination ; ces anatomistes avaient assimilé ces
lobes à toute la couche optique ; d apres le même
système , l’anatomiste allemand ne voit en eux que
la moitié postérieure de cette couche des mammifères
qui se serait affaissée chez les oiseaux. Il y
a beaucoup de sagacité dans cette observation et
dans ce rapprochement, mais il me paraît hors
de toute vraisemblance : d’abord, ce morcellement
des tubercules quadrijumeaux et de la
couche optique , cette séparation des parties qui
les forment chez les mammifères, n’est qu’une
supposition ; aucun fait ne l’atteste, rien ne prouve
même sa possibilité dans 1 encephale des embryons
: en second lieu, à aucune époque de la
formation du cerveau, on ne trouve dans aucune
classe que la partie postérieure de la couche optique
des mammifères où les corps géniculés soient
creux comme les lobes optiques. Comment se
creuseraient-ils chez les oiseaux? autre proposition
à démontrer avant d admettre cette analogie. En
troisième lieu ( i ) , chez tous les vertébrés sans
exception (2), la couche optique (3) ne se deve-
(1) PI. I, Gg. 5, n»-.
(2) Pf.'t, Gg. 15 , n" G.