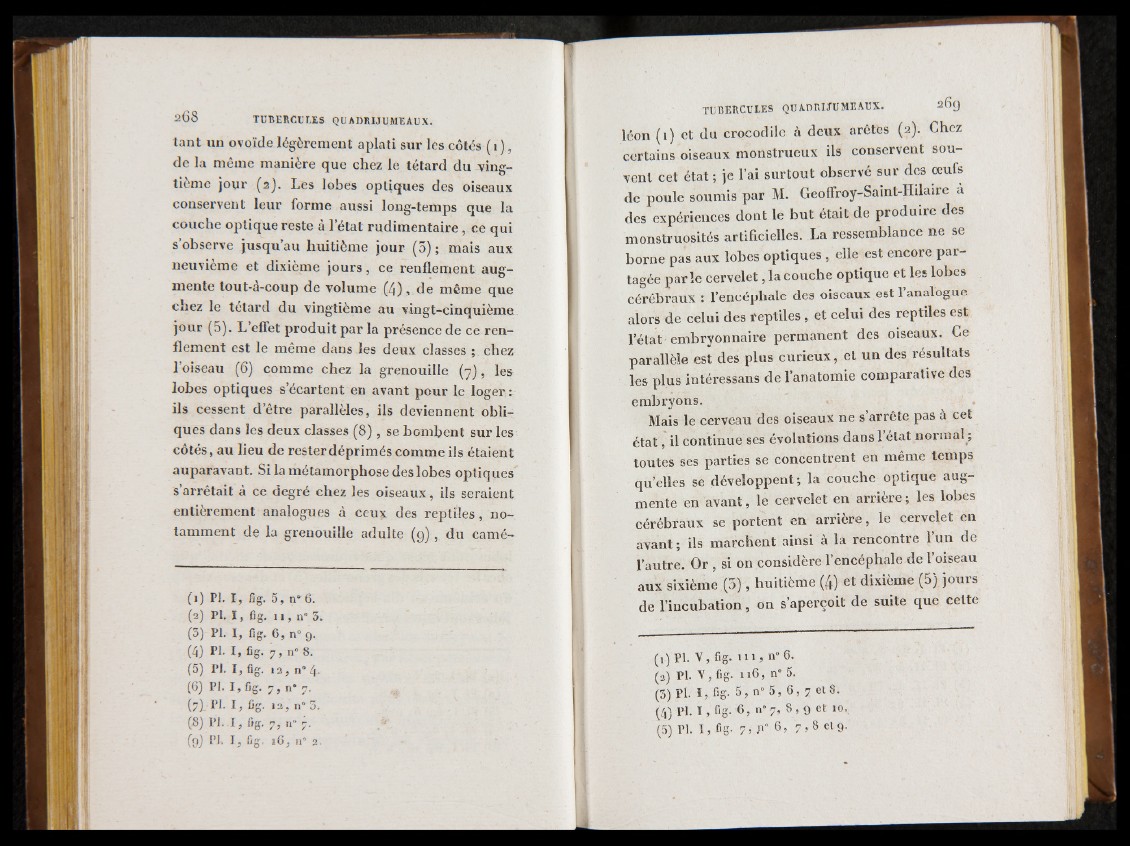
tant un ovoïde légèrement aplati sur les côtés (1),
de la même manière que chez le têtard du vingtième
jour (2). Les lobes optiques des oiseaux
conservent leur forme aussi long-temps que la
couche optique reste à l’état rudimentaire, ce qui
s observe jusqu’au huitième jour (0); mais aux
neuvième et dixième jours, ce renflement augmente
tout-â-coup de volume (4) , de même que
chez le têtard du vingtième au vingt-cinquième
jour (5). L’effet produit par la présence de ce renflement
est le même dans les deux classes ; chez
l’oiseau (6) comme chez la grenouille (7), les
lobes optiques s’écartent en avant pour le loger a
ils cessent d ’être parallèles, ils deviennent obliques
dans les deux classes (8) , se bombent sur les
côtés, au lieu de rester déprimés comme ils étaient
auparavant. Si la métamorphose des lobes optiques
s’arrêtait à ce degré chez les oiseaux -, ils seraient
entièrement analogues à ceux des reptiles, notamment
de la grenouille adulte (9), du camé-
( 1) P L I , fig. 5» n“ 6.
w PL I , fig. 11 , n° 3.
(3) PL I , % 6, n ° 9-
(4) PL I , f i s 7>
n° 8.
(5) PL I , s 1
a i n° 4.
(6) PL I , es - 7 >n* 7-
( 7)- PL I , fig- 12 , n ” 5.
(S) PL I , fig. 7? n° 7-
léon (1) et du crocodile à deux arêtes (2). Chez
certains oiseaux monstrueux ils conservent souvent
cet état ; je l’ai surtout observé sur des oeufs
de poule soumis par M. Geoffroy-Saint-Hilaire à
des expériences dont le but était de produire des
monstruosités artificielles. La ressemblance ne se
borne pas aux lobes optiques, elle est encore partagée
parle cervelet, la couche optique et les lobes
cérébraux : l’encéphale des oiseaux est 1 analogue
alors de celui des reptiles , et celui des reptiles est
l’état embryonnaire permanent des oiseaux. Ce
parallèle est des plus curieux, et un des résultats
les plus intéressans de l’anatomie comparative des
embryons.
Mais le cerveau des oiseaux ne s’arrête pas à cet
é ta t, il continue ses évolutions dans 1 état normal ;
toutes ses parties se concentrent en même temps
quelles se développent; la couche optique augmente
en avant, le cervelet en arriéré ; les lobes
cérébraux se portent en arrière, le cervelet en
avant ; ils marchent ainsi a la rencontre 1 un de
l’autre. Or , si on considère l’encéphale de l oiseau
aux sixième (3), huitième (4) et dixième (5) jours
de l’incubation, on s’aperçoit de suite que celte
(1) pi. V, fig. 111, n° 6.
(2) PI. y , fig- n 6 , n° 5.
(3) Pi. I , fig- 5 , n° 5 , 6 , 7 et 8.
(',) Pl. I , fig- 6 , n° 7, 8 , 9 et io v