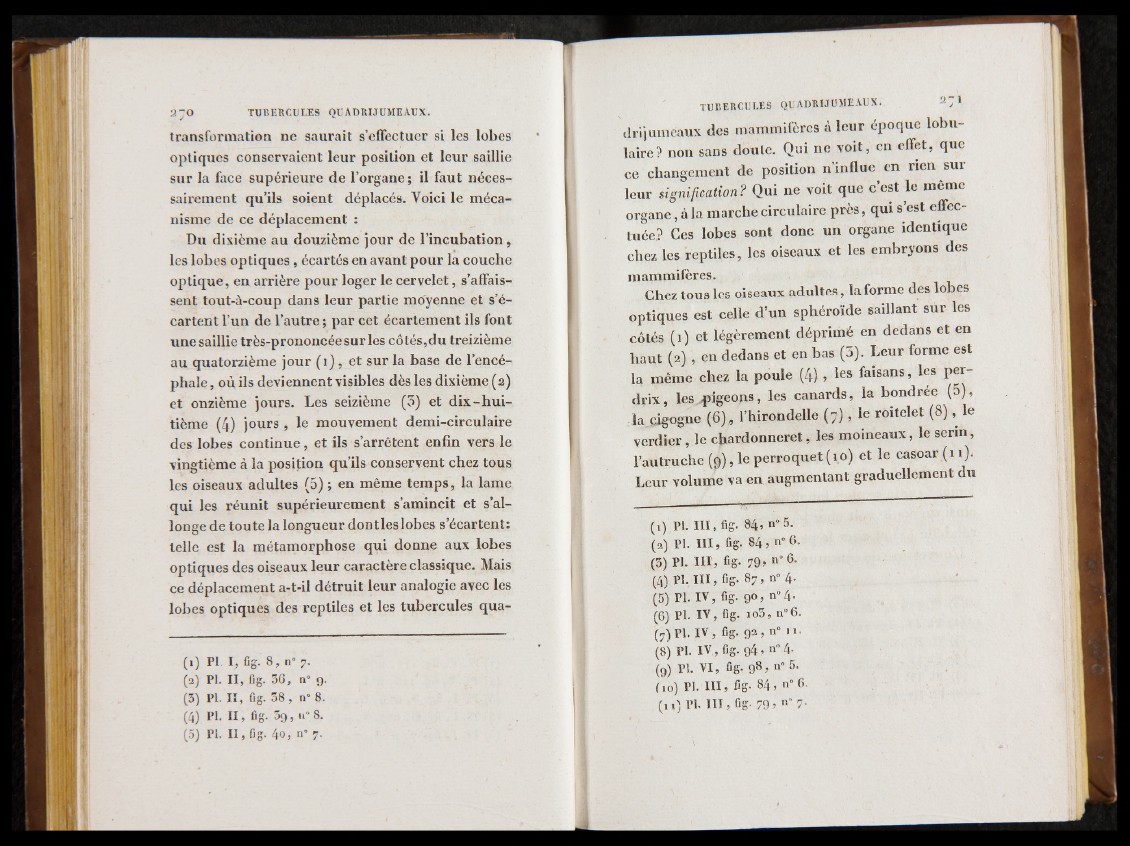
transformation ne saurait s’effectuer si les lobes
optiques conservaient leur position et leur saillie
sur la face supérieure de l’organe ; il faut nécessairement
qu’ils soient déplacés. Voici le mécanisme
de ce déplacement :
Du dixième au douzième jour de l’incubation,
les lobes optiques , écartés en avant pour la couche
optique, en arrière pour loger le cervelet, s’affaissent
tout-à-coup dans leur partie moyenne et s’écartent
l’un de l’autre ; par cet écartement ils font
une saillie très-prononcée sur les côtés,du treizième
au quatorzième jour ( i ) , et sur la base de l’encéphale
, où ils deviennent visibles dès les dixième (2)
et onzième jours. Les seizième (3) et d ix -h u itième
(4) jours , le mouvement demi-circulaire
des lobes continue, et ils s’arrêtent enfin vers le
vingtième à la position qu’ils conservent chez tous
les oiseaux adultes (5) ; en même temps, la lame
qui les réunit supérieurement s’amincit et s’allonge
de toute la longueur dontles lobes s’écartent:
telle est la métamorphose qui donne aux lobes
optiques des oiseaux leur caractère classique. Mais
ce déplacement a-t-il détruit leur analogie avec les
lobes optiques des reptiles et les tubercules qua-
(1) PI I, fig. 8 , n° 7.
(2) PI. II, fig. 36, n° 9.
(3) PI. II, fig. 3 8 , o° 8.
(4) PI. I I , fig. 3g , u° 8.
(5) PI. I I , fig- 4o, n° 7.
drijuméaux des mammifères à leur époque lobulaire?
non sans doute. Qui ne voit, en effet, que
ce changement de position n’influe en rien sur
leur signification? Qui ne voit que c’est le meme
organe, à la marche circulaire près, qui s’est effectuée.?
Ces lobes sont donc un organe identique
chez les reptiles, les oiseaux et les embryons des
mammifères.
Chez tous les oiseaux adultes, la forme des lobes
optiques est celle d’un sphéroïde saillant sur les
côtés (1) et légèrement déprimé en dedans et en
haut (2) , en dedans et en bas (3). Leur forme est
la même chez la poule (4) ? ies faisans, les perdrix,
les ^pigeops, les canards, la bondrée (5),
la cigogne (6), l’hirondelle (7), le roitelet (8), le
verdier, le chardonneret, les moineaux, le serin,
l’autruche (9), le perroquet (10) et le casoar(11).
Leur volume va en augmentant graduellement du
(!) PI. III, fig- 84» n° 1 2 3 4 5-
(3) PI. I I I , fig- 8 4 ? n” 6.
(3) PI. III'? fig- 79» n° 6-
(4) PI. I I I , fig- 87, n° 4 .
(5) PI. IV, fig. 90, a" 4 .
(6) PI. IV, fig. io3 , n° 6.
(7) PI. IV, fig. 9 2 , n° 11.
(8) PI. IV ? fig. 9 4 » n" 4-
(9) PI. VI, fig. 98 ? n» 5.
(10) PI. III, fig- 84, n° 6.