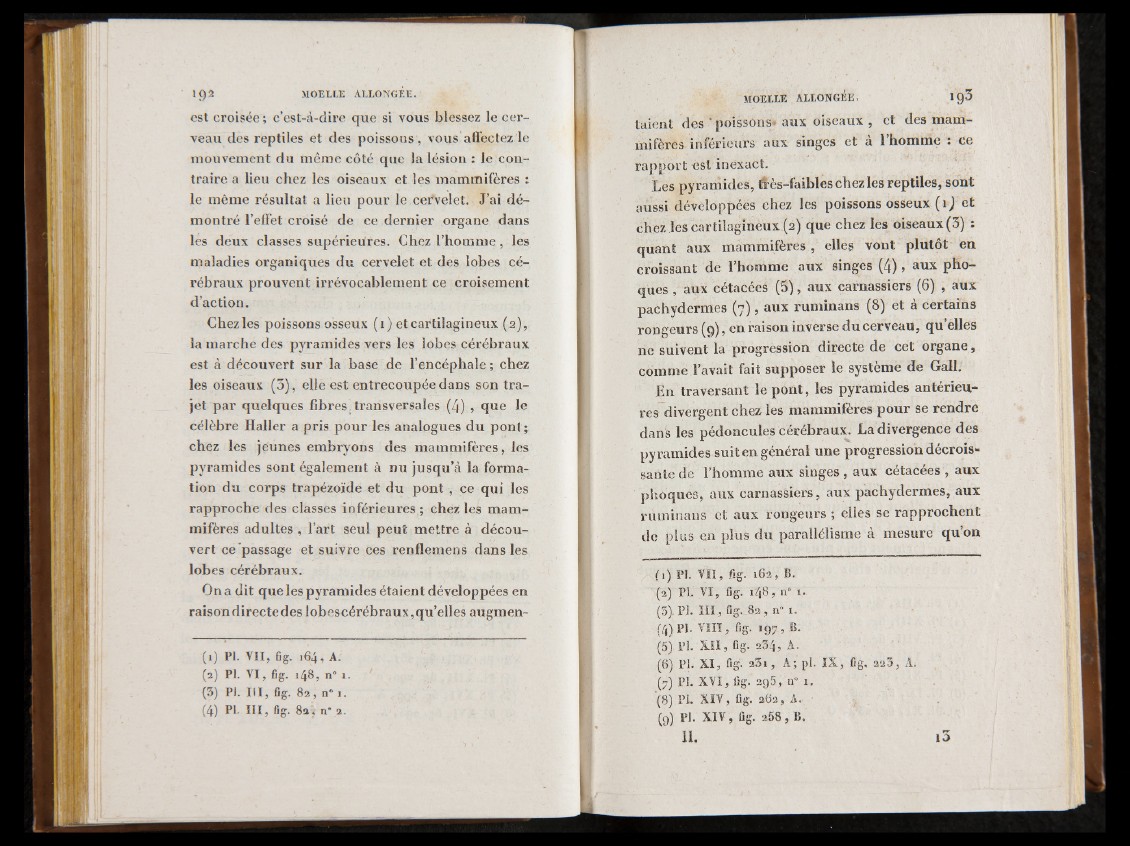
est croisée ; c’est-à-dire que si vous blessez le cerveau
des reptiles et des poissons , vous affectez le
mouvement du même côté que la lésion : le contraire
a lieu chez les oiseaux et les mammifères :
le même résultat a lieu pour le cervelet. J’ai démontré
l’effet croisé de ce dernier organe dans
les deux classes supérieures. Chez l’homme, les
maladies organiques du cervelet et des lobes cérébraux
prouvent irrévocablement ce croisement
d’action.
Chez les poissons osseux (i) et cartilagineux (2),
la marche des pyramides vers les lobes cérébraux
est à découvert sur la base de l’encéphale ; chez
les oiseaux (3), elle est entrecoupée dans son trajet
par quelques fibres, transversales (4) , que le
célèbre Haller a pris pour les analogues du pont ;
chez les jeunes embryons des mammifères, les
pyramides sont également à nu jusqu’à la formation
du corps trapézoïde et du pont, ce qui les
rapproche des classes inférieures ; chez les mammifères
adultes , lart seul peut mettre à découvert
ce'passage et suivre ces renflemens dans les
lobes cérébraux.
On a dit que les pyramides étaient développées en
raison directe des lobescérébraux, qu’elles augmen(
1) PI. VII, fig. 164, A.
(2) PI. VI, fig. 148, n° i.
(3) PI. III, fig. 82, n° 1.
(4) PI. III, fig. 8a:j n* 2.
taient des ‘ poissons» aux oiseaux , et des mammifères
inférieurs aux singes et a 1 homme : ce
rapport est inexact.
Les pyramides, ffès-faibles chez les reptiles, sont
aussi développées chez les poissons osseux ( îj et
chez les cartilagineux (2) que chez les oiseaux (3) :
quant aux mammifères, elles vont plutôt en
croissant de l’homme aux singes (4) , aux phoques
, aux eétacées (5), aux carnassiers (6) , aux
pachydermes (7), aux ruminans (8) et à certains
rongeurs (9), en raison inverse du cerveau, qu’elles
ne suivent la progression directe de cet organe,
comme l’avait fait supposer le système de Gall.'
En traversant le poïit, les pyramides antérieures'
divergent chez les mammifères pour se rendre
dans les pédoncules cérébraux^. La divergence des
pyramides suit en général une progression décroissante
de l’homme aux singes , aux eétacées , aux
phoques, aux carnassiers, aux pachydermes, aux
ruminans et aux rongeurs ; elles se rapprochent
de plus en plus du parallélisme à mesure qu’on
f i ) P I . V I I , f i g . 1 6 2 , B .
(2) P I . V I , f ig . i f | 8 , n° 1 .
(5). P I . I I I , f ig . 8 2 , a " 1.
(4) PI - V I I I , f ig . 1 9 7 , B.
(5) P I . X I I , f ig . 234, A .
(6 ) P I . X I , f ig . 23i , A ; pl. I X , f ig , 223, A .
( 7 ) P I . X V I , f ig . 2 9 5 , n° î .
(8 ) P l . X I V , f ig . 2 6 2 , A.. ■
(9 ) PI. X I V , f ig . 258, B .