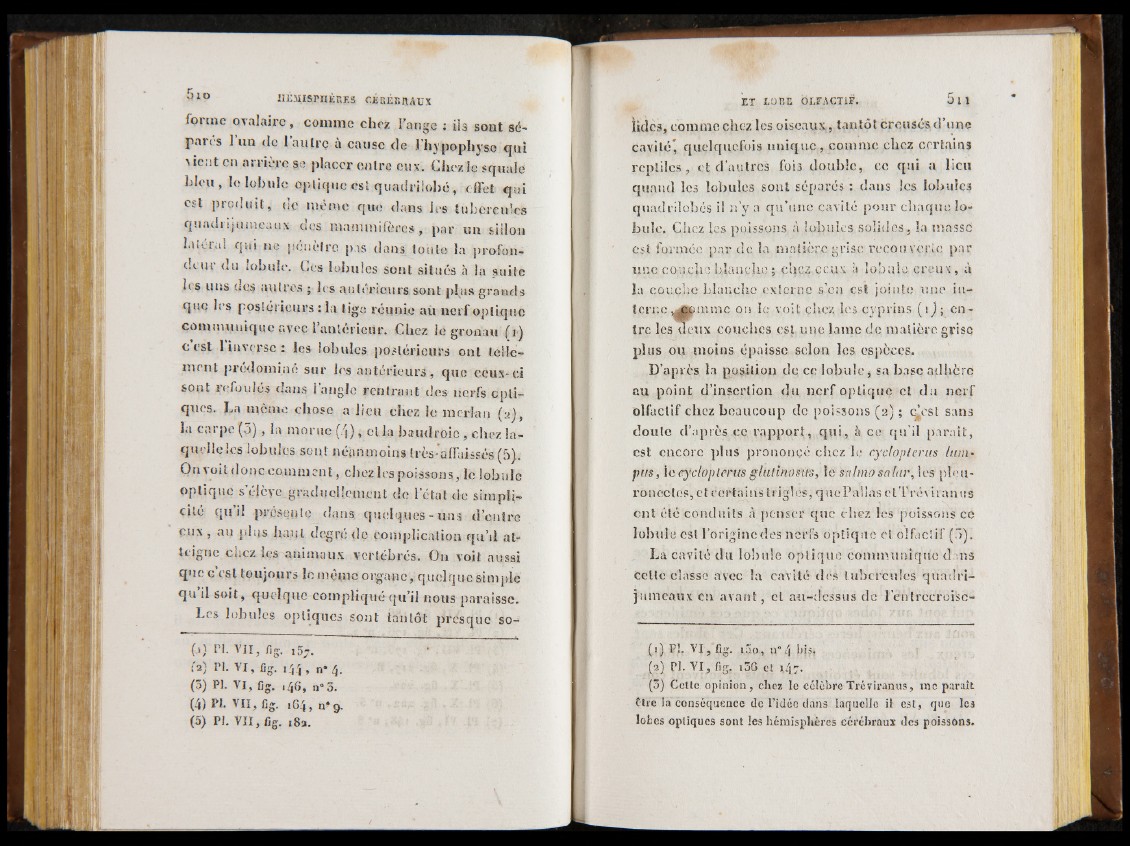
forme ovalaire, comme chez l'ange : ils sont sépares
l’un de l’aulrç à cause de l'hypophyse qui
>ie;it en arriére &e placer entre eux. Chez le squale
bleu, le lobule optique est quadrüohc, effet qui
est produit^ ne meme que dans les tubercules
qu.uii ijumeaux oes mammifères, par un sillon
latéral qui ne pénètre pas dans toute la profondeur
du lobule. Ces lobules sont situés à la suite
les uns des autres ; les antérieurs sont plps grands
que les postérieurs : la tige réunie au nerf optique
communique avec l’antérieur. Chez le gronau (j)
c est 1 inverse : les lobules postérieurs ont tellement
prédomine sur les antérieurs, que ceux-ci
sont refoulés dans l’angle rentrant des nerfs optiques.
La môme chose a lieu chez le merlan (a),
la carpe (5) , la morue (/,), cl la baudroie , chez laquelle
les lobules sont néanmoins très-affaissés (5),.
On voit donc comment, chez les poissons, le lobule
optique s e{cye graduellement de l étal de simplicité
qui! présente dans, quelques-uns d’entre
eu x , au plus haut degré dç complication qu’il atteigne
chez les animaux vertébrés. On voit aussi
que c’est toujours le même organe, quelque simple
qu il suit, quelque compliqué qu’il nous paraisse.
Les lobules optiques sont tantôt presque so-
O y n . v i i , %. , 5-.
(2) PI- fi s- *44 » n* 4.
(5) PI. VI, fig. 146, n°3.
(4) PI. v i l , fig. 164,0*9.
Iidcs, comme chez les oiseaux, tantôt creusés d’une
cavité* quelquefois unique, comme chez certains
reptiles, et d’autres fois double, ce qui a lieu
quand les lobules sont séparés : dans les lobules
quadrilobés il n’y a qu’une cavité pour chaque lobule.
Chez les poissons à lobules solides, la masse
est formée par de la matière grise rceouverie par
une couche blanche • chez ceux à lobule creux, à
îa couche blanche externe s’en est jointe une iu-
tcimc*jfcommc on le voit chez les cyprins ( i j ; entre
les deux couches est une lame de matière grisç
plus ou moins épaisse scion les espèces.
D’après la position de ce lobule, sa base adhère
au point d’insertion du nerf o p t i q u e cl du nerf
olfactif chez beaucoup de poissons (2} ; céest sans
doute d’après ce rapport, qui, h ce q u ’il paraît,
est encore plus prononcé chez le cyclonterus lam-
pus, ïecycloplcrmglulinosït's, le snlniosalar, les pieu-
roncctes, et certains trigles, que Pal las et T ré vira nas
ont é t é conduits à penser que chez les poissons ce
lobule est l’origine des nerfs Optique et ôjfacliif (ü).
La cavité du lobule optique communique d. ns
celte classe avec la cavité des tubercules quadrijumeaux
en avant, cl au-dessus de Tentrccroise-
(1} P!. VI, f ig . i 3o, u” 4 bis,
(2) PI. VI, fig, i 56 et r47-
(3) Cette opinion, chez le célèbreTréïiranus, me paraît
tire la conséquence de l’idée dans laquelle il est, que les
lobes optiques sont les hémisphères cérébraux des poissons.