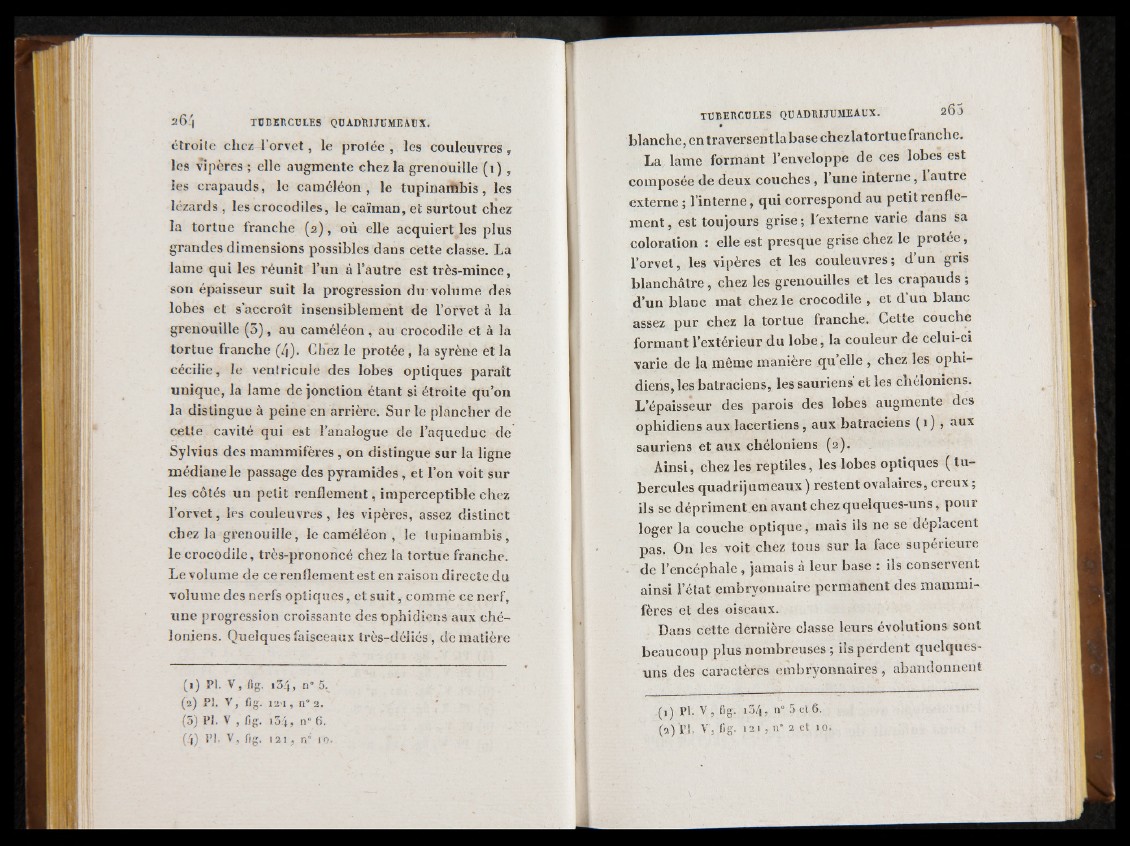
étroite chez l’orvet, le protée , les couleuvres T
les vipères ; elle augmente chez la grenouille (1) ,
les crapauds, le caméléon, le tupinarftbis, les
lézards , les crocodiles, le caïman, et surtout chez
la tortue franche (2), où elle acquiert les plus
grandes dimensions possibles dans cette classe. La
lame qui les réunit l’un à l’autre est très-mince,
son épaisseur suit la progression du volume des
lobes et s’accroît insensiblement de l’orvet à la
grenouille (3), au caméléon , au crocodile et à la
tortue franche (4). Chez le protée, la syrène et la
cécilie, le ventricule des lobes optiques paraît
unique, la lame de jonction étant si étroite qu’on
la distingue à peine en arrière. Sur le plancher de
cette cavité qui est l’analogue de l’aqueduc de
Sylvius des mammifères , on distingue sur la ligne
médiane le passage des pyramides, et l’on voit sur
les côtés un petit renflement, imperceptible chez
l’orvet, les couleuvres, les vipères, assez distinct
chez la grenouille, le caméléon , le lupinambis,
le crocodile, très-prononcé chez la tortue franche.
Le volume de ce renflement est en raison directe du
volume des nerfs optiques, et suit, comme ce nerf,
une progression croissante des ophidiens aux ché-
loniens. Quelques faisceaux très-déliés, de matière 1 2
(1) PI. V, fig. 134, n" 5.
(2) PI. V, fig. 12a, n° 2.
(5) PI. V , fig. i54, n° 6.
tubercules qu ad rijumeau x.
blanche, entraversentlabase chezla tortue franche.
La lame formant l’enveloppe de ces lobes est
composée de deux couches , l’une interne, 1 autre
externe ; l’interne, qui correspond au petit renflement
, est toujours grise ; l'externe varie dans sa
coloration : elle est presque grise chez le protée,
l’orvet, les vipères et les couleuvres; d’un gris
blanchâtre, chez les grenouilles et les crapauds ;
d’un blanc mat chez le crocodile , et d’un blanc
assez pur chez la tortue franche. Cette couche
formant l’extérieur du lobe, la couleur de celui-ci
varie de la même manière qu elle , chez les ophidiens,
les batraciens, les sauriens’ et les chéloniens.
L’épaisseur des parois des lobes augmente des
ophidiens aux lacertiens, aux batraciens (1) , aux
sauriens et aux chéloniens (2).
Ainsi, chez les reptiles, les lobes optiques ( tu bercules
quadrijumeaux) restent ovalaires, creux;
ils se dépriment.en avant chez quelques-uns, pour
loger la couche optique, mais ils ne se déplacent
pas. O11 les voit chez tous sur la face supérieure
de l’encéphale , jamais à leur base : ils conservent
ainsi l’état embryonnaire permanent des mammifères
et des oiseaux.
Dans cette dernière classe leurs évolutions sont
beaucoup plus nombreuses ; iis perdent quelques-
uns des caractères embryonnaires , abandonnent
(1) PI. V, fig. i34, n° 5 et 6.
(a) ri. V, fig 121, n* 2 et 10.