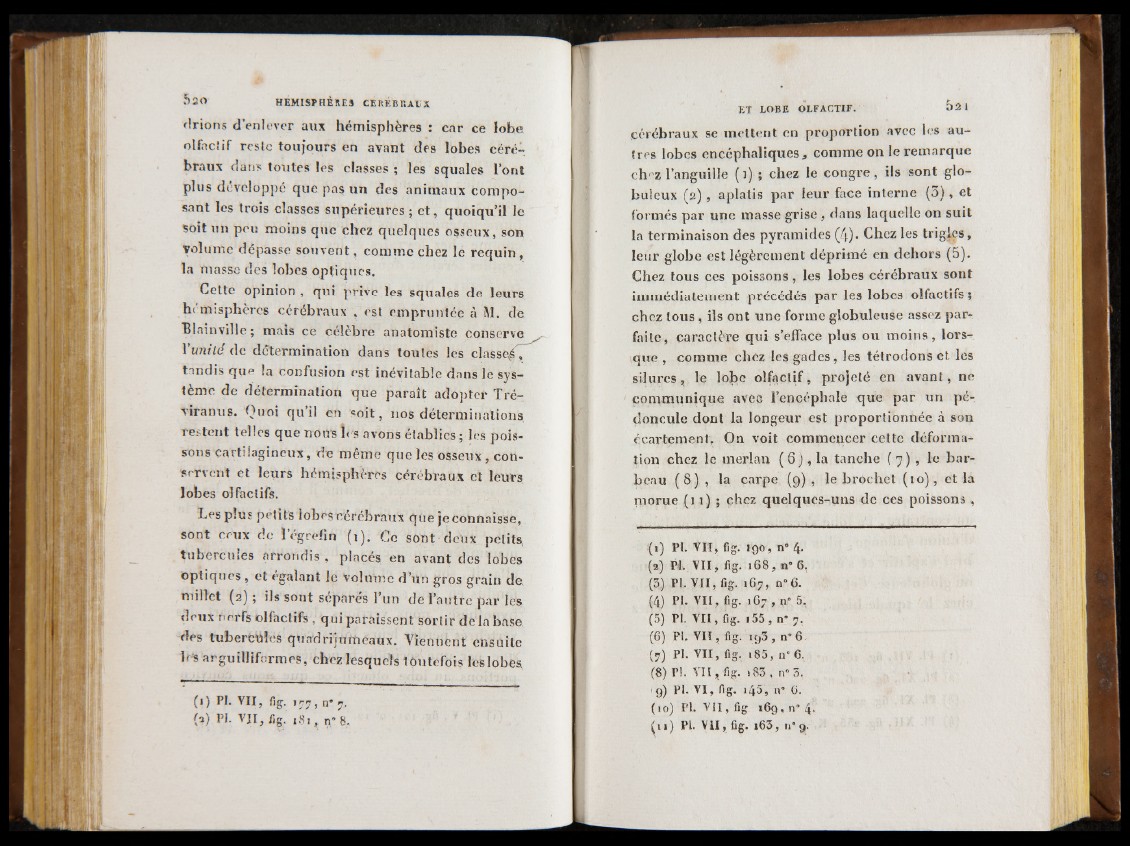
cirions d ’enlever aux hémisphères : car ce lobe
olfactif reste toujours en avant des lobes cérébraux
dans toutes les classes ; les squales l’ont
plus développé que pas un des animaux composant
les trois classes supérieures ; e t, quoiqu’il le
soit un peu moins que chez quelques osseux, son
volume dépasse souvent, comme chez le requin,
la masse des lobes optiques.
Cette opinion , qui prive les squales de leurs
hémisphères cérébraux , est empruntée à M. de
Blainville; mais ce célèbre anatomiste conserve
Yunile de détermination dans toutes les classe/T
tandis que la confusion est inévitable dans le système
de détermination que parait adopter Tré-
viranus. Quoi qu’il en soit, nos déterminations
restent telles que nous 1rs avons établies; les poissons
cartilagineux, de même que les osseux/conservent
et leurs hémisphères cérébraux et leurs
lobes olfactifs.
Les plus petits lobescérébraux que je Connaisse,
sont ceux do ï égrefin (i). Ce sont deux petits*
tubercules arrondis , placés en avant des lobes
Optiques, et égalant le volume d ’un gros grain de.
millet (2) ; ils sont sépares 1 un de l’autre par lés
deux nerfs olfactifs, qui paraissent sortir de la base,
des tubertuîes quadrijumeaux. Viennent ensuite
les arguilliformes, chez lesquels toutefois les lobes
(l) PI. VII, fig. inn, n* 7.
(?) Pi- VII, fig. 181, n*8,
cérébraux se mettent en proportion avec les autres
lobes encéphaliques, comme on le remarque
chnz l’anguille (i) ; chez le congre, ils sont globuleux
(2), aplatis par leur face interne (3) , et
formés par une masse grise , dans laquelle on suit
la terminaison des pyramides (4). Chez les triglcs,
leur globe est légèrement déprimé en dehors (5).
Chez tous ces poissons, les lobes cérébraux sont
immédiatement précédés par les lobes olfactifs ;
chez tous, ils ont une forme globuleuse assez parfaite,
caractère qui s’efface plus ou moins, lorsque
, comme chez les gades, les tétrodons et les
silures v le lobe olfactif, projeté en avant, ne
communique aveô l’encéphale que par un pédoncule
dont la longeur est proportionnée à son
écartement. On voit commencer cette déformation
chez le merlan ( 6 ) , la tanche ( 7) , le barbeau
(8 ) , la carpe (9) , le brochet (10), et la
morue {11) ; chez quelques-uns de ces poissons ,
(1) PI. VIT, fig. 190, n* 4.
(2) PI. VII, fig. 168, n° 6,
(5) PI. VII, fig. 167, n° 6.
(4) PL VII, fig. 167 , n° 5,
(5) PL VII, fig. 155, n* 7.
(6) PL VII, fig. 193, n° 6
(7) PL VII, fig. i 85, n° 6.
(8) PL Vit, fig . i 83 , n° 3,
19) PL VI, fig. i 45, n“ G.
(10) PL VII, fig 169,11° 4
f n ) PL Vil, fig. i63, 0*9.