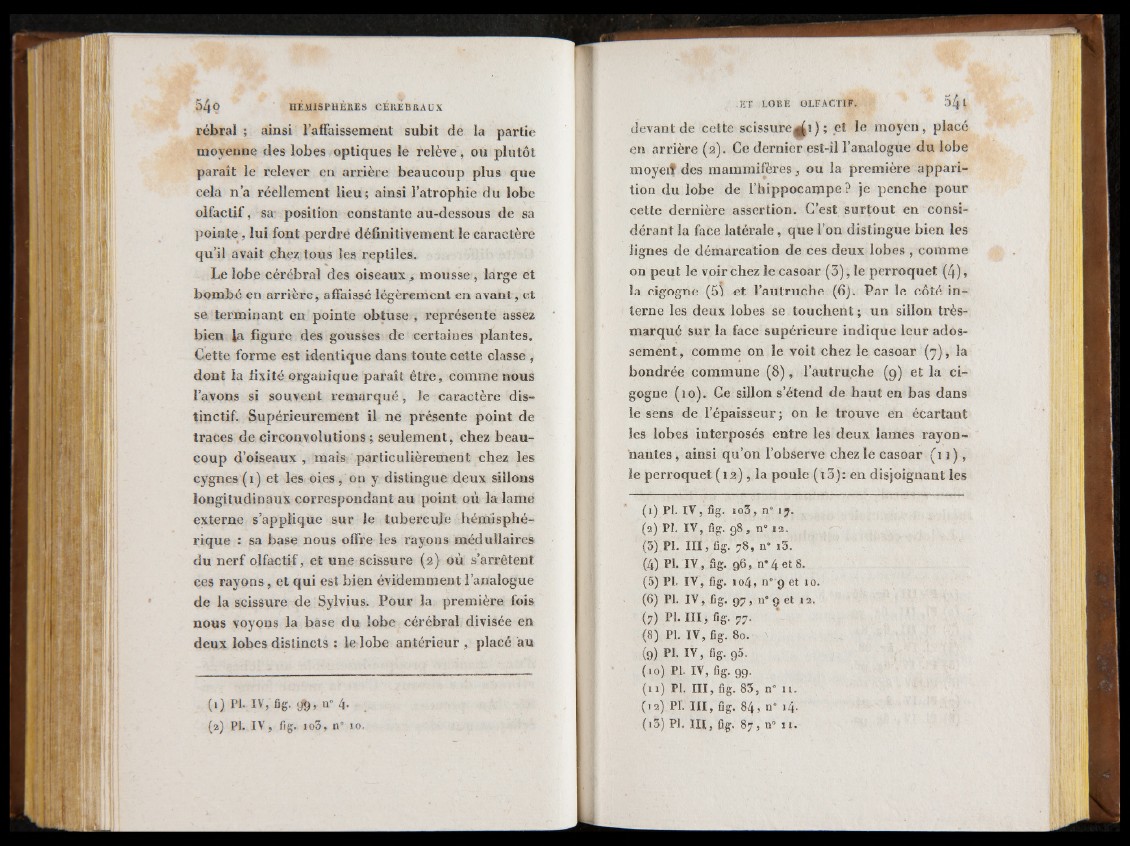
rébral ; ainsi l'affaissement subit de la partie
moyenne des lobes optiques le relève, ou plutôt
paraît le relever en arrière beaucoup plus que
cela n ’a réellement lieu; ainsi l’atrophie du lobe
olfactif, sa position constante au-dessous de sa
pointe , lui font perdre définitivement le caractère
qu’il avait chez tous les reptiles.
Le lobe cérébral des oiseaux, mousse , large et
bombé en arrière, affaissé légèrement en avant, et
se terminant en pointe obtuse , représente assez
bien la figure des gousses de certaines plantes.
Cette forme est identique dans toute cette classe ,
dont la fixité organique paraît être, comme nous
l’avons si souvent remarqué, le caractère distinctif.
Supérieurement il ne présente point de
traces de circonvolutions ; seulement, chez beaucoup
d’oiseaux , mais particulièrement chez les
cygnes (1) et les oies, on y distingue deux sillons
longitudinaux correspondant au point où la lame
externe s’applique sur le tubercule hémisphérique
: sa base nous offre les rayons médullaires
du nerf olfactif, et une scissure (2) où s’arrêtent
ces rayons, et qui est bien évidemment l’analogue
de la scissure de Sylvius. Pour la première fois
nous voyons la base du lobe cérébral divisée en
deux lobes distincts : le lobe antérieur , placé au
devant de cette scissureW1); et le moyen, placé
en arrière (2). Ce dernier est-il l’analogue du lobe
moyeù des mammifères, ou la première apparition
du lobe de l’hippocampe ? je penche pour
cette dernière assertion. C’est surtout en considérant
la face latérale, que l’on distingue bien les
lignes de démarcation de ces deux lobes , comme
on peut le voir chez le casoar (3), le perroquet (4 ) >
la cigogne (5) et l’autruche (6j. Par le côté interne
les deux lobes se touchent; un sillon très-
marqué sur la face supérieure indique leur adossement,
comme on le voit chez le casoar (7), la
bondrée commune (8), l’autruche (9) et la cigogne
(10). Ce sillon s’étend de haut en bas dans
le sens de l’épaisseur; on le trouve en écartant
les lobes interposés entre les deux lames rayonnantes
, ainsi qu’on l’observe chez le casoar (11) ,
le perroquet (12), la poule ( 13 J : en disjoignant les
(1) PJ. IV, fig. io5 , n° 17.
(2) PI. IV, fig. 98, n° 12.
(3) PL III, fig. 78, n“ i 5.
(4) PI. IV, fig. 96, n* 4 et 8.
(5) PL IV, fig. 104, n° 9 et 10.
(6) PL IV, fig. 97, n* 9 et 12.
(7) PI. III, fig. 77.
(8) PL IV, fig. 80.
(9) PI. IV, fig. 95.
(10) PI. IV, fig. 99.
(n ) PI. III, fig. 83, n° u .
(12) PI. III, fig. 84, n° 14.