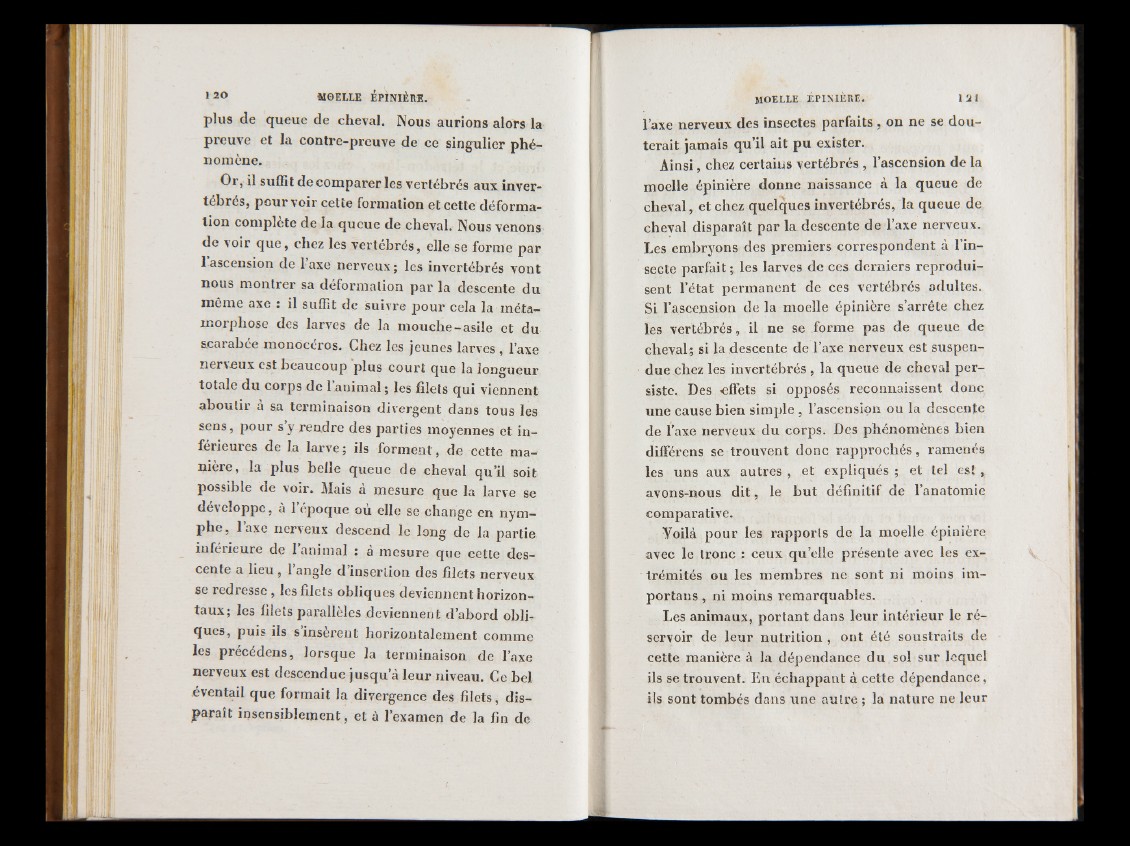
plus de queue de cheval. Nous aurions alors la
preuve et la contre-preuve de ce singulier phénomène.
Or, il suffit de comparer les vertébrés aux invertébrés,
pourvoir cette formation et cette déformation
complété de la queue de cheval. Nous venons
de voir que, chez les vertébrés, elle se forme par
l ’ascension de l’axe nerveux; les invertébrés vont
nous montrer sa déformation par la descente du
même axe : il suffit de suivre pour cela la métamorphose
des larves de la mouche-asile et du
scarabée monoceros. Chez les jeunes larves , l’axe
nerveux est beaucoup plus court que la longueur
totale du corps de 1 animal; les filets qui viennent
aboutir à sa terminaison divergent dans tous les
sens, pour s y rendre des parties moyennes et inférieures
de la larve ; ils forment, de cette manière,
la plus belle queue de cheval qu’il soit
possible de voir. Mais à mesure que la larve se
développe, à 1 epoque ou elle se change en nymphe,
l ’axe nerveux descend le long de la partie
inférieure de l’animal : à mesure que cette descente
a lieu , l’angle d ’insertion des filets nerveux
se redresse , les filets obliques deviennent horizontaux;
les filets parallèles deviennent d’abord obliques,
puis ils s’insèrent horizontalement comme
les precédens, lorsque la terminaison de Taxe
nerveux est descendue jusqu’à leur niveau. Ce bel
éventail que formait la divergence des filets, disparaît
insensiblement, et à l’examen de la fin de
l’axe nerveux des insectes parfaits , on ne se douterait
jamais qu’ü ait pu exister.
Ainsi, chez certains vertébrés , l’ascension de la
moelle épinière donne naissance à la queue de
cheval, et chez quelques invertébrés, la queue de
cheval disparaît par la descente de l’axe nerveux.
Les embryons des premiers correspondent à l’insecte
parfait; les larves de ces derniers reproduisent
l’état permanent de ces vertébrés adultes.
Si l'ascension de la moelle épinière s’arrête chez
les vertébrés, il ne se forme pas de queue de
cheval; si la descente de l’axe nerveux est suspendue
ehez les invertébrés , la queue de cheval persiste.
Des effets si opposés reconnaissent donc
une cause bien simple , l’ascension ou la descente
de l’axe nerveux du corps. Des phénomènes bien
différens se trouvent donc rapprochés, ramenés
les uns aux autres , et expliqués ; et tel e s t,
avons-nous d it, le but définitif de l’anatomie
comparative.
Voilà pour les rapports de la moelle épinière
avec le tronc : ceux qu’elle présente avec les extrémités
ou les membres ne sont ni moins im-
portans , ni moins remarquables.
Les animaux, portant dans leur intérieur le réservoir
de leur nutrition , ont été soustraits de
cette manière à la dépendance du sol sur lequel
ils se trouvent. En échappant à cette dépendance,
ils sont tombés dans une autre ; la nature ne leur