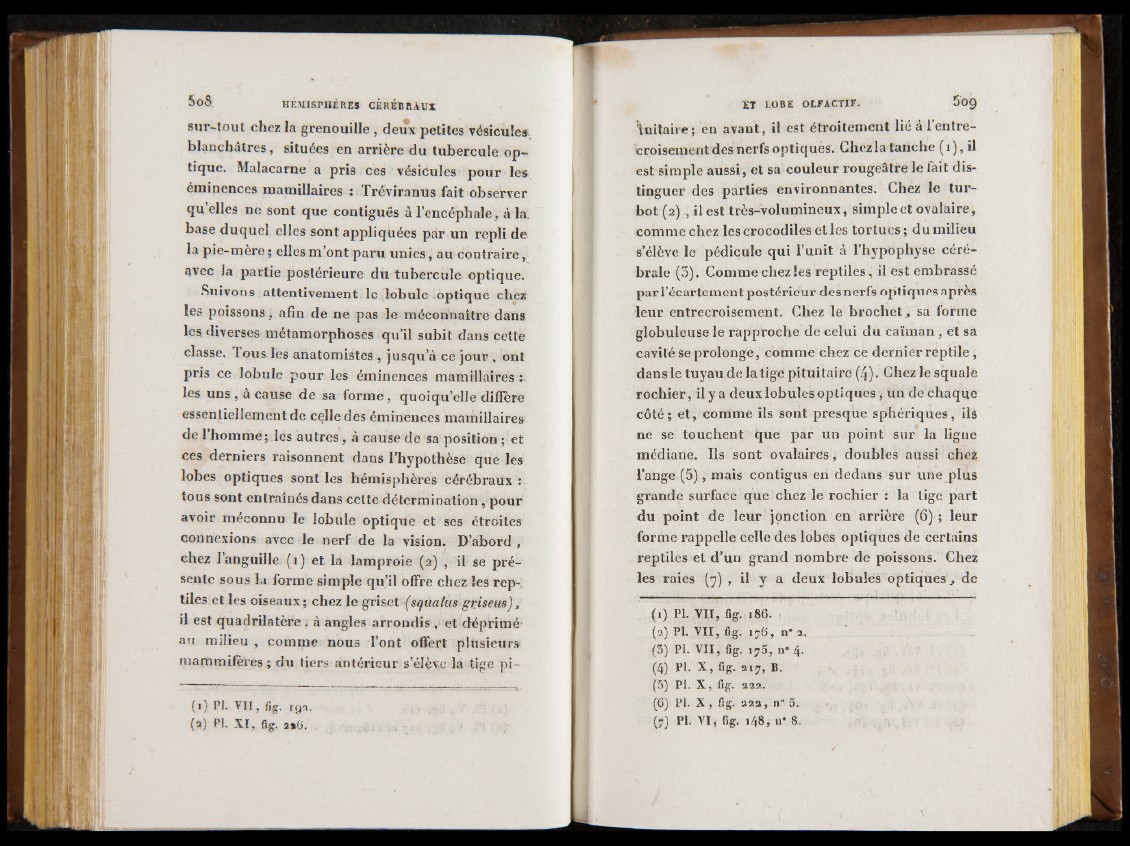
sur-tout chez la grenouille , deux petites vésicules,
blanchâtres, situées en arrière du tubercule op-*
tique. Malacarne a pris ces vésicules pour les
éminences mamillaires : Tréviranus fait observer
qu elles ne sont que contiguës à l’encéphale, à la,
base duquel elles sont appliquées par un repli de
la pie-mere ; elles m’ont paru unies, au contraire,
avec Ja partie postérieure du tubercule optique.
Suivons attentivement le lobule optique chez
les poissons, afin de ne pas le méconnaître dans
les. diverses métamorphoses qu’il subit dans cette
classe. Tous les anatomistes , jusqu’à ce jour , ont
pris ce lobule pour les éminences mamillaires
les u n s, à cause de sa forme, quoiqu’elle diffère
essentiellement de celle des éminences mamillaires
de 1 homme; les autres, à cause de sa position ; et
ces derniers raisonnent dans l’hypothèse que les
lobes optiques sont les hémisphères cérébraux :
tous sont entraînés dans celte détermination, pour
avoir méconnu le lobule optique et ses étroites
connexions avec le nerf de la vision. D’abord ,
chez I anguille (1) et la lamproie (a) , il se présente
sous la forme simple qu’il offre chez les reptiles
et les oiseaux; chez le griset (squalus gvisem)^
il est quadrilatère, à angles arrondis , et déprimé
au milieu , comme nous l’ont offert plusieurs-
mammifères ; du tiers antérieur s’élève la tige pi-
(i) PI. v i l , fig. rps.
( ? ) PI . X I , f ig . a»G.
W taire; en avant, il est étroitement lié à l'entrecroisement
des nerfs optiques. Ghczla tanche (1), il
est simple aussi , et sa couleur rougeâtre le fait distinguer
des parties environnantes. Chez le turbot
(2),, il est très-volumineux, simple et ovalaire,
comme chez les crocodiles et les tortues ; du milieu
s’élève le pédicule qui l’unit à l’hypophyse cérébrale
(3). Comme chez les reptiles, il est embrassé
par l’écartement postérieur des nerfs optiques après
leur entrecroisement. Chez le brochet j sa forme
globuleuse le rapproche de celui du caïman, et sa
cavité se prolonge, comme chez ce dernier reptile,
dans le tuyau de la tige pituitaire (4). Chez le squale
rochier, il y a deux lobules optiques, un de chaque
côté; et, comme ils sont presque sphériques, ils
ne se touchent que par un point sur la ligne
médiane. Ils sont ovalaires, doubles aussi cheÈ
l’ange (5), mais contigus en dedans sur une plus
grande surface que chez le rochier : la lige part
du point de leur jonction en arrière (6) ; leur
forme rappelle celle des lobes optiques de certains
reptiles et d’un grand nombre de poissons. Chez
les raies (7) , il y a deux lobules optiques., de
( 1 ) P I . V I I , f ig . 1 8 6 .
(2) P I . VII, f ig . 1 7 6 , n* 2.
(3) PL VII, fig. i 75, n* 4.
(4 ) P L X , f i g . 2 1 7 , B .
( 5) P L X , f ig . 2 2 2 .
(6) P L X , f ig . 2 2 3 , n” 5.
(?) PI; VI; fig. 148, n* 8.