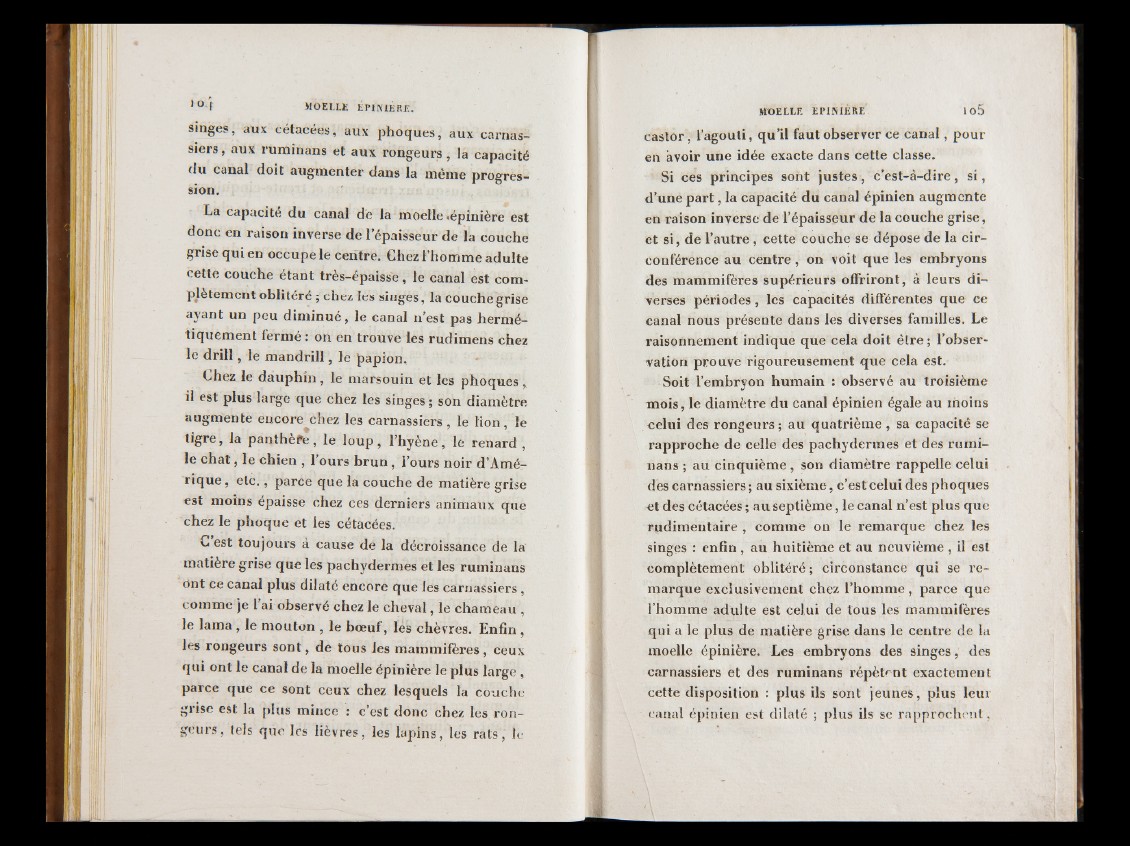
singes, aux cétacées, aux phoques, aux carnassiers,
aux rumînans et aux rongeurs, la capacité
du canal doit augmenter dans la même progression.
La capacité du canal dé la moelle »épinière est
donc en raison inverse de l’épaisseur de la couche
grise qui en occupe le centre. Chez l’homme adulte
èette couche étant très-épaisse, le canal est complètement
oblitéré ; chez les singes, la couche grise
ayant un peu diminué, le canal n'est pas hermétiquement
fermé : on en trouve les rudimens chez
le d rill, le mandrill, le papion.
Chez le dauphin, le marsouin et les phoques §
il est plus large que chez les singes ; son diamètre
augmente encore chez les carnassiers , le lion, le
tigre, la panthèfe, le loup, l’hyène, le renard ,
le c h a t, le chien , l’ours b ru n , l’ours noir d^Amév
rîq u e , e tc., parce que la couche de matière grise
est moins épaisse chez ces derniers animaux que
chez le phoque et les cétacées.
C est toujours à cause de la décroissance de la
matière grise que les pachydermes et les ruminans
Ont ce canal plus dilaté encore que les carnassiers,
comme je l’ai observé chez le cheval, le chameau ,
le lama , le mouton , le boeuf, les chèvres. Enfin ,
les rongeurs sont, de tous les mammifères, ceux
qui ont le canal de la moelle épinière le plus large ,
parce que ce sont ceux chez lesquels la couche
grise est la plus mince : c’est donc chez les rongeurs,
tels que les lièvres, les lapins, les rats, le
castor , l’agouti, qu’il faut observer ce canal, pour
en avoir une idée exacte dans cette classe.
Si ces principes sont justes, c’est-à-dire, si,
d’une p a rt, la capacité du canal épinien augmente
en raison inverse de l’épaisseur de la couche grise ,
et si, de l’au tre , cette couche se dépose de la circonférence
au centre, on voit que les embryons
des mammifères supérieurs offriront, à leurs diverses
périodes, les capacités différentes que ce
canal nous présente dans les diverses familles. Le
raisonnement indique que cela doit être; l’observation
prouve rigoureusement que cela est.
Soit l’embryon humain : observé au troisième
mois, le diamètre du canal épinien égale au moins
celui des rongeurs; au quatrième, sa capacité se
rapproche de celle des pachydermes et des ruminans
; au cinquième, son diamètre rappelle celui
des carnassiers; au sixième, c’est celui des phoques
et des cétacées ; au septième, le canal n’est plus que
rudimentaire , comme on le remarque chez les
singes : enfin , au huitième et au neuvième , il est
complètement oblitéré ; circonstance qui se remarque
exclusivement chez l’homme, parce que
l’homme adulte est celui de tous les mammifères
qui a le plus de matière grise dans le centre de la
moelle épinière. Les embryons des singes, des
carnassiers et des ruminans répètent exactement
cette disposition : plus ils sont jeunes, plus leur
canal épinien est dilaté ; plus ils se rapprochent,