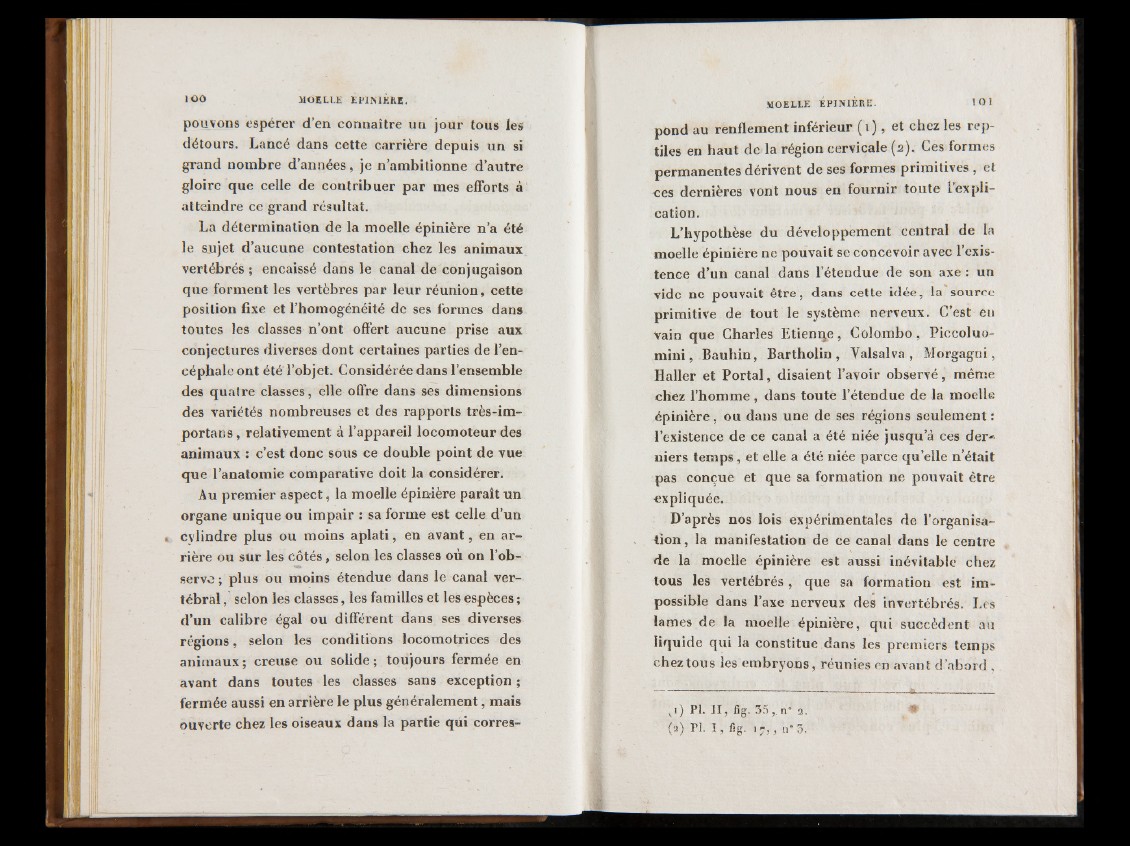
pouvons espérer d’en connaître un jour tous les
détours. Lancé dans cette carrière depuis un si
grand nombre d’années, je n’ambitionne d’autre
gloire que celle de contribuer par mes efforts à
atteindre ce grand résultat.
La détermination de la moelle épinière n’a été
le sjujet d’aucune contestation chez les animaux
vertébrés; encaissé dans le canal de conjugaison
que forment les vertèbres par leur réunion, cette
position fixe et l’homogénéité de ses formes dans
toutes les classes n’ont offert aucune prise aux
conjectures diverses dont certaines parties de l’encéphale
ont été l’objet. Considérée dans l’ensemble
des quatre classes, elle offre dans ses dimensions
des variétés nombreuses et des rapports très-im-
portans, relativement à l’appareil locomoteur des
animaux : c’est donc sous ce double point de vue
que l’anatomie comparative doit la considérer.
Au premier aspect, la moelle épinière paraît un
organe unique ou impair : sa forme est celle d’un
cylindre plus ou moins aplati, en avant, en arrière
ou sur les côtés, selon les classes où on l'observe
; plus ou moins étendue dans le canal vertébral
, selon les classes, les familles et les espèces ;
d’un calibre égal ou différent dans ses diverses
régions, selon les conditions locomotrices des
animaux ; creuse ou solide ; toujours fermée en
avant dans toutes les classes sans exception ;
fermée aussi en arrière le plus généralement, mais
ouverte chez les oiseaux dans la partie qüi correspond
au renflement inférieur ( i ) , et chez les reptiles
en haut de la région cervicale (a). Ces formes
permanentes dérivent de ses formes primitives , et
ces dernières vont nous en fournir toute l’explication.
L’hypothèse du développement central de la
moelle épinière ne pouvait se concevoir avec l’existence
d’un canal dans l’étendue de son axe : un
vide ne pouvait être, dans cette idée, la source
primitive de tout le système nerveux. C’est en
vain que Charles Etienqe, Colombo, Piccoluo-
mini , Bauhin, Bartholin , Valsalva , Morgagni,
Haller et Portai, disaient l’avoir observé, même
chez l’homme , dans toute l’étendue de la moelle
épinière, ou dans une de ses régions seulement :
l’existence de ce canal a été niée jusqu’à ces dér*
niers temps, et elle a été niée parce qu’elle n’était
pas conçue et que sa formation ne pouvait être
expliquée.
D’après nos lois expérimentales de l’organisation,
la manifestation de ce canal dans le centre
de la moelle épinière est aussi inévitable chez
tous les vertébrés i que sa formation est impossible
dans l’axe nerveux des invertébrés. Les
lames de la moelle épinière, qui succèdent au
liquide qui la constitue dans les premiers temps
chez tou s les embryons, réunies en avant d ’abord ,
vi) PI. II, fig. 3 5 n° 2.