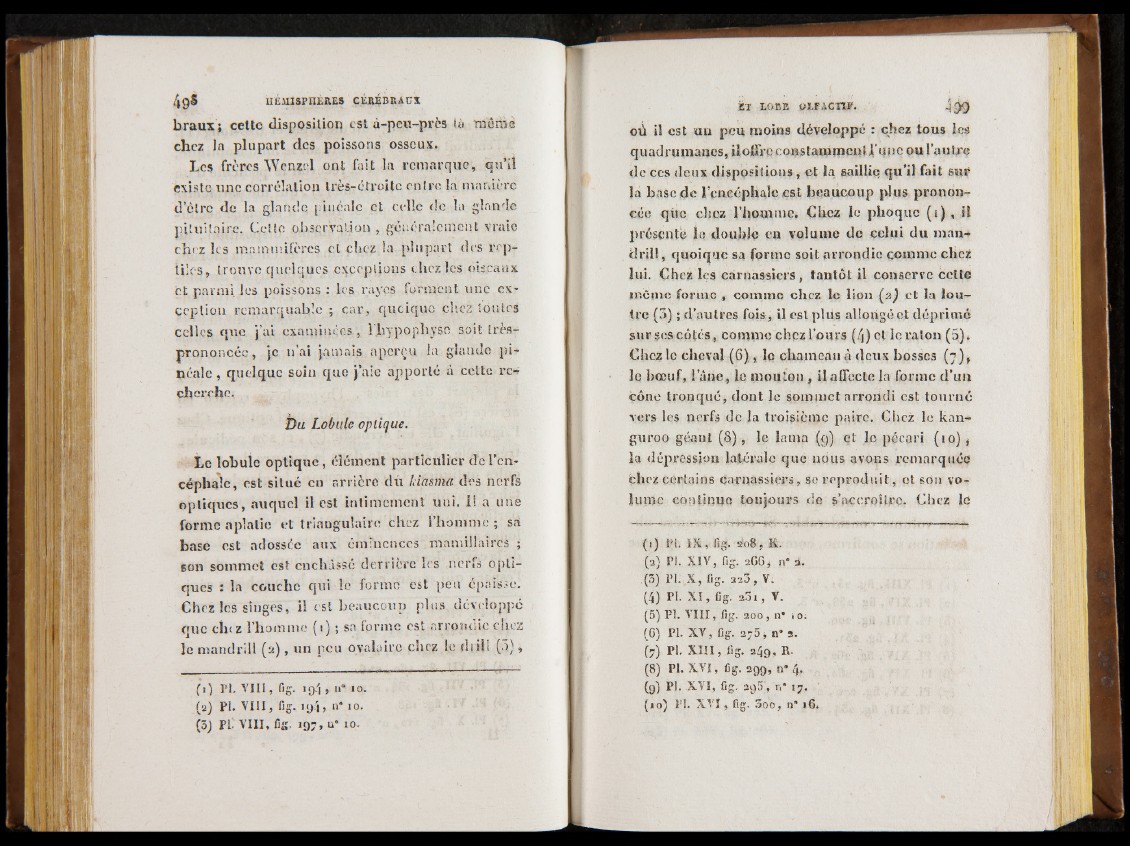
braux; cette disposition est à-peu-près là même
chez la plupart des poissons osseux.
Les frères Wcnzcl ont fait la remarque, qu’il
existe une corrélation très-étroite onlrc la manière
d’èlrc de la glande pinéalc et celle de la glande
pituitaire. Celle observation , généralement vraie
chez les mammifères et chez la plupart des reptiles,
trouve quelques exceptions chez les oiseaux
et parmi les poissons : les rayes forment une exception
remarquable ; car, quoique citez toutes
celles que j’ai examinées , 1,hypophyse soit très-
prononcée, je n’ai jamais aperçu la glande pi-
néale, quelque soin que j’aie apporté à cette rc-
cherche.
Du Lobule optique.
Le lobule optique, élément particulier de l’encéphale,
est situé en arrière dû kiasma des nerfs
optiques, auquel il est intimement uni. Il a une
forme aplatie et triangulaire chez 1 homme ; sa
base est adossée aux éminences mansiilaircs ;
son sommet est enchâssé derrière les nerfs optiques
: la couche qui le forme est pieu épaisse.
Chez les singes, il est beaucoup plus développé
que cinz l'homme (i) ; sa forme est arrondie chez
le mandrill (a), un peu ovalaire chez le drilt (5),
( 0 »1. VIII, fi g. 194, u“ 10.
(2) PI. VIII, fig. 194» 10.
où il est un peu moins développé : chez tous les
quadrumanes, ilojS’reconstammcntruue ou l’autre
de ces deux dispositions, et la saillie qu’il fait sut
la base de l'encéphale est beaucoup plus prononcée
que chez l’homme. Chez le phoque (i) , il
présente lo double en volume de celui du mandrill
, quoique sa forme soit arrondie comme chez
lui. Chez les carnassiers, tantôt il conserve cette
môme forme , comme chez le lion (a) et la loutre
(a) ; d’autres fois, il est plüs allongé et déprimé
sur ses côtés, comme chez l’ours (/j) et le raton (5)*
Chez le cheval (6) , le chameau à (leux bosses (7),
le boeuf, l’âne, le mouton , il affecte la forme d’un
cône tronqué, dont le sommet arrondi est tourné
vers les nerfs de la troisième paire. Chez le kan-
guroo géant (§), le lama (9) et le pécari (10) *
la dépression latérale que nous avons remarquée
chez certains carnassiers, se reproduit, et son volume
continue! toujours de s’accroître. Chez le
( 1 } P L I X , fis*. a b S , ML
(2 ) PI . X I V , f ig . aGG j n" a .
,(3) P I . X , f ig . 2 2 3 , V .
(4) pi. x i , fig. 201, v.
( 5) P I . V I I I , f ig . 2 0 0 , n* i o ;
È § PI . X V , f ig . 275, n" 3.
( y ) P I . XIII, fig. 249, R.
(8 ) PI . X V I , fig. 2 9 9 , n* 4 .
(9 ) P I . X V I , f ig . 3 9 5 ' , n* 1 7 .
(10) PL XVÎ, fig. 3oo, n* »6*