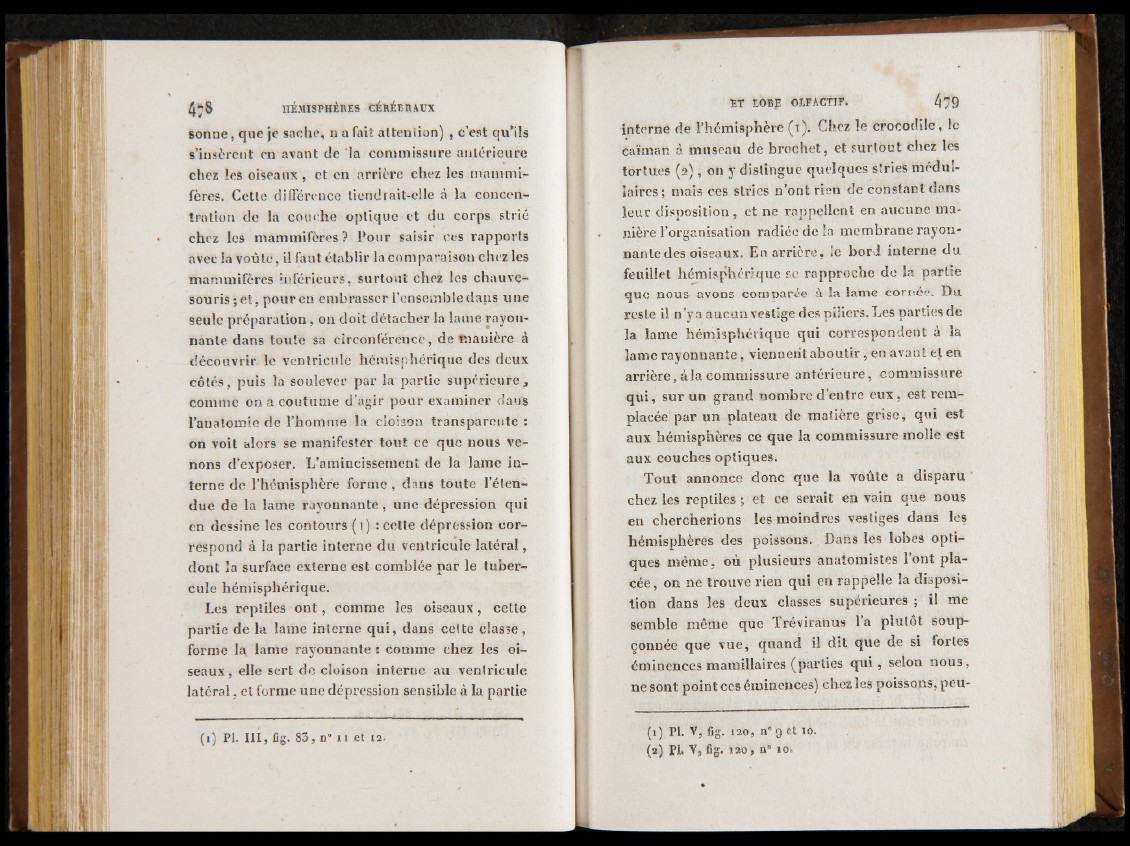
sonne, que je sache, n a fait atteniion) , c’est qu’ils
s’insèrent en avant de la commissure antérieure
chez les oiseaux, et en arrière chez les mammifères.
Cette différence tiendrait-elle à la concentration
de la couehe optique et du corps strié
chez les mammifères? Pour saisir ces rapports
avec la voûte, il faut établir la comparaison chez les
mammifères inférieurs, surtout chez les chauve-
souris ; et, pour en embrasser l’ensemble dans une
seule préparation, on doit détacher la lame rayonnante
dans toute sa circonférence, de manière à
découvrir le ventricule hémisphérique des deux
côtés, puis la soulever par la partie supérieure,
comme on a coutume d’agir pour examiner dans
l’anatomie de l’homme la cloison transparente :
on voit alors se manifester tout ce que nous venons
d’exposer. L’amincissement de la lame interne
de l’hémisphère forme, dans toute l’étendue
de la lame rayonnante, une dépression qui
en dessine les contours (1) : cette dépression correspond
à la partie interne du ventricule latéral,
dont îa surface externe est comblée par le tubercule
hémisphérique.
Les reptiles ont, comme les oiseaux, cette
partie de la laine interne qui, dans cette classe,
forme la lame rayonnante î comme chez les oiseaux
, elle sert de cloison interne au ventricule
latéral, et forme une dépression sensible à la partie
(1) PI. III, fig. 83, n° 11 et 12.
interne de l’hémisphère (1). Chez le crocodile, le
caïman à museau de brochet, et surtout chez les
tortues (2), on y distingue quelques stries médullaires;
mais ces stries n’ont rien de constant dans
leur disposition , et ne rappellent en aucune manière
l’organisation radiée de la membrane rayonnante
des oiseaux. En arrière, ie bord interne du
feuillet hémisphérique se rapproche de la partie
que nous avons comnarée à la lame cornée. Du
reste il n’y a aucun vestige des piliers. Les parties de
la lame hémisphérique qui correspondent à îa
lame rayonnante, viennent aboutir, en avant fel en
arrière, à la commissure antérieure, commissure
qui, sur un grand nombre d’entre eux, est remplacée
par un plateau de matière grise, qui est
aux hémisphères ce que la commissure molle est
aux couches optiques.
Tout annonce donc que la voûte a disparu
chez les reptiles ; et ce serait en vain que nous
en chercherions les moindres vestiges dans les
hémisphères des poissons. Dans les lobes optiques
même, où plusieurs anatomistes l’ont placée,
on ne trouve rien qui en rappelle îa disposition
dans les deux classes supérieures ; il me
semble même que Tréviranus l’a plutôt soupçonnée
que vue, quand il dit que de si fortes
éminences mamillaires (parties q u i, selon nous,
ne sont point ces éminences) chez les poissons, peu-
(1) PI. V, fig. 120, n 'g e t 10.
(2) PI. V, fig. 120, ü° io.