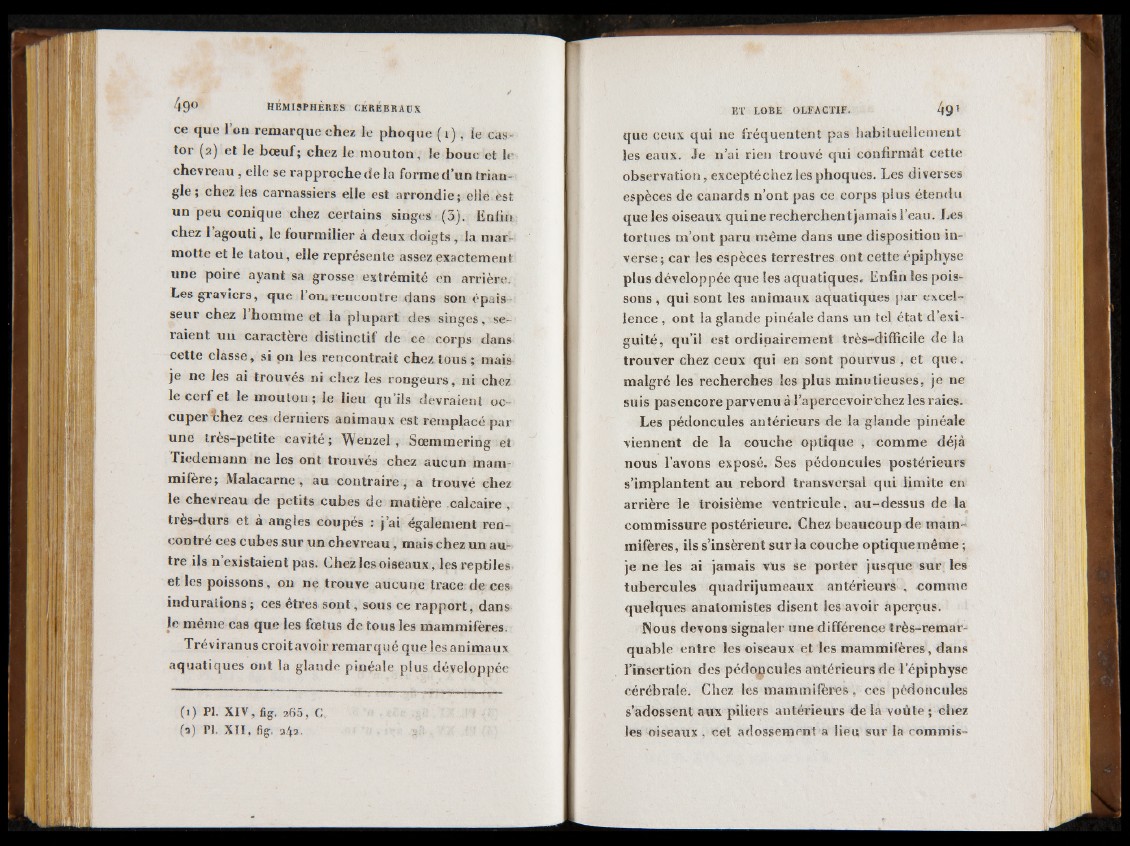
ce que Ton remarque chez le phoque (1), le castor
(2) et le boeuf; chez le mouton, le bouc et le
chevreau, elle se rapproche de la forme d’un triangle
; chez les carnassiers elle est arrondie; elle est
un peu conique chez certains singes (3). Enfin
chez l ’agouti, le fourmilier à deux doigts, la marmotte
et le tatou, elle représente assez exactement
une poire ayant sa grosse extrémité en arrière.
Les graviers, que l’on.rencontre dans son épaisseur
chez 1 homme et la plupart des singes,'seraient
uu caractère distinctif de ce corps dans
cette classe, si 011 les rencontrait chez tous ; mais
je ne les ai trouvés ni chez les rongeurs, ni chez
le cerf et le mouton; le lieu qu’ils devraient occ
u p e r i e z ces derniers animaux est remplacé par
une très-petite cavité; Wenzel , Soemmering et
Tiedemann ne les ont trouvés chez aucun mammifère;
Malacarne, au contraire, a trouvé chez
le chevreau de petits cubes de matière calcaire ,
très-durs et a angles coupés : j’ai également rencontré
ces cubes sur un chevreau, mais chez un autre
ils n existaient pas. Chez les oiseaux, les reptiles
et les poissons, on ne trouve aucupe trace de ces
indurations; ces êtres sont , sous ce rapport, dans
le même cas que les foetus de tous les mammifères.
Tréviranus croitavoir remarqué que les animaux
aquatiques ont la glande pinéale plus développée
(1) PI. XIV, fig. 265, C
(3) PL XII, fig. 343.
que ceux qui ne fréquentent pas habituellement
les eaux. Je n ’ai rien trouvé qui confirmât cette
observation, exceptéchez les phoques. Les diverses
espèces de canards n’ont pas ce corps plus étendu
que les oiseaux qui ne recherchent jamais l’eau. Les
tortues m’ont paru même dans une disposition inverse;
car les espèces terrestres ont cette épiphyse
plus développée que les aquatiques. Enfin les poissons
, qui sont les animaux aquatiques par excellence
, ont la glande pinéale dans un tel état d’exi-
guité, qu’il est ordinairement très-difficile de la
trouver chez ceux qui en sont pourvus , et que.
malgré les recherches les plus minutieuses, je ne
suis pasencore parvenu à l’apercevoir'chez les raies.
Les pédoncules antérieurs de la glande pinéale
viennent de la couche optique , comme déjà
nous l’avons exposé. Ses pédoncules postérieurs
s’implantent au rebord transversal qui limite en
arrière le troisième ventricule, au-dessus de la
commissure postérieure. Chez beaucoup de mammifères,
ils s’insèrent sur la couche optique même ;
je ne les ai jamais vus se porter jusque sur les
tubercules quadrijumeaux antérieurs , comme
quelques anatomistes disent ies avoir aperçus.
Nous devons signaler une différence très-remarquable
entre les oiseaux et les mammifères, dans
l’insertion des pédopcuîes antérieurs de l ’épiphyse
cérébrale. Chez les mammifères, ces pédoncules
s’adossent aux piliers antérieurs de la voûte ; chez
les oiseaux , cet adossement a lieu sur la commis