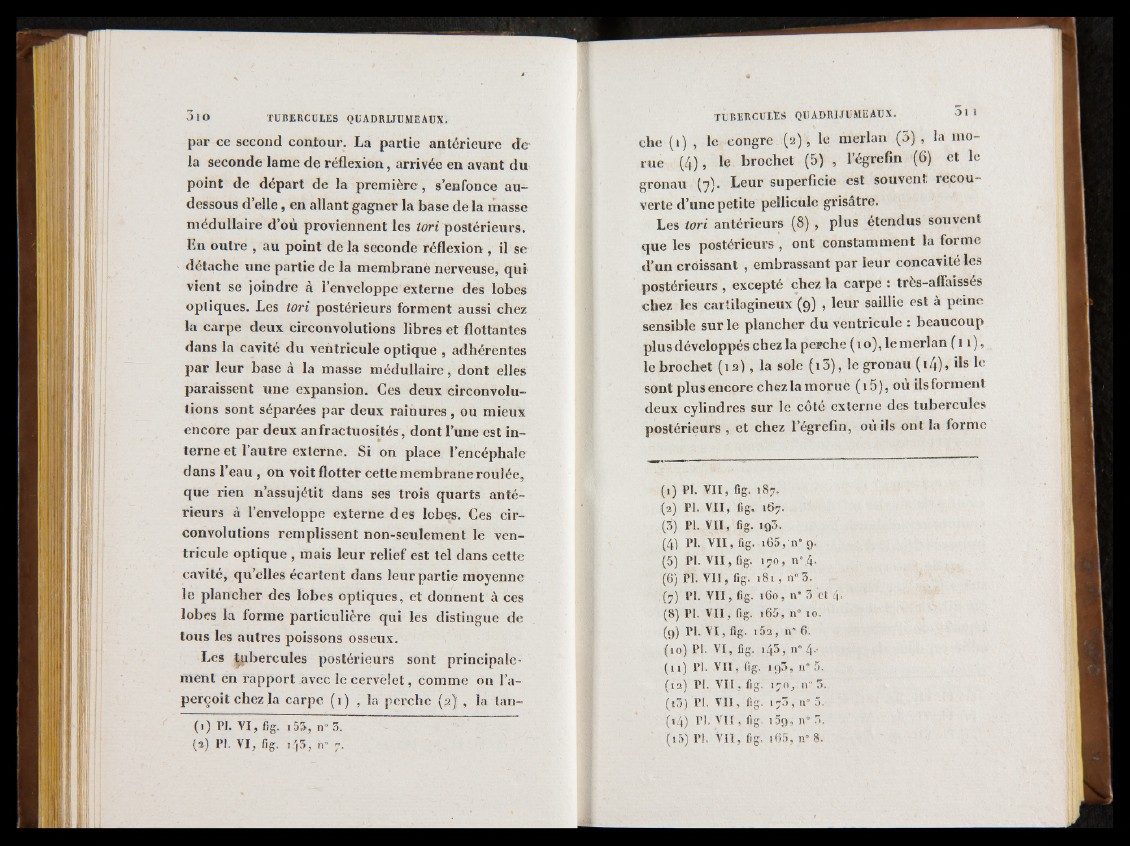
par ce second contour. La partie antérieure der
la seconde lame de réflexion, arrivée en avant du
point de départ de la première , s’enfonce au-
dessous d’elle, en allant gagner la base de la masse
médullaire d’où proviennent les tori postérieurs.
En outre , au point de la seconde réflexion , il se
détache une partie de la membranè nerveuse, qui
vient se joindre à i’enveloppe externe des lobes
opliques. Les tori postérieurs forment aussi chez
la carpe deux circonvolutions libres et flottantes
dans la cavité du ventricule optique , adhérentes
par leur base à la masse médullaire , dont elles
paraissent une expansion. Ces deux circonvolutions
sont séparées par deux rainures, ou mieux
encore par deux anfractuosités, dont l’une est interne
et l’autre externe, Si on place lencéphale
dans l’eau , on voit flotter cette membrane roulée,
que rien n ’assujétit dans ses trois quarts antérieurs
à l’enveloppe externe des lobes. Ces circonvolutions
remplissent non-seulement le ventricule
optique , mais leur relief est tel dans cette
cavité, qu’elles écartent dans leur partie moyenne
le plancher des lobes optiques, et donnent à ces
lobes la forme particulière qui les distingue de
tous les autres poissons osseux.
Les tpbercules postérieurs sont principale-
ment en rapport .avec le cervelet, comme on l’aperçoit
chez la carpe (1) , la perche (2) , la tan-
(1) PI. VI, fig. i 55, n*3.
che (i) , le congre ( 2 ) , le merlan (5) , la mo-
(4), le brochet (5)rue , l’égrefin (6) et le
gronau (7). Leur superficie est souvent recouverte
d’une petite pellicule grisâtre.
Les tori antérieurs (8) , plus étendus souvent
que les postérieurs , ont constamment la forme
d’un croissant , embrassant par leur concavité les
postérieurs , excepté chez la carpe : très-affaissés
chez les cartilagineux {9) , leur saillie est à peine
sensible sur le plancher du ventricule : beaucoup
plus développés chez la perche ( 1 o), le merlan ( 11 ) »
le brochet (12) , la sole ( i 3), le gronau (i4)» As le
sont plus encore chez la moruè ( i 5), ou ils forment
deux cylindres sur le côté externe des tubercules
postérieurs, et chez l’égrefin, où ils ont la forme
(1) PI. VII, fig. 187.
(2) PI. VII, fig. 167.
(3) PI. VII, fig. iq3.
(4) PI. VII, fig. i65, n‘ 9.
(5) PI. VII, fig. 170, n» 4.
(6) PI. VII, fig. 181, n" 3.
(7) PI. VII, fig. 160, n* 5 et 4.
(8) PI. VII, fig. i 65, n° 10.
(9) PI. VI, fig. i 52, n” 6.
(10) PI. VI, fig. i43, n"4--
l u ) PI. VII, fig. 195, n° 5.
(12) PI. VII, fig. 170, n” 3.
(13) PI. VII, fig. 173, n» 5.
(14) PI. Vif, fig. i 5q, n° 3.
(15) PI. VII, fig. 165, n” 8.