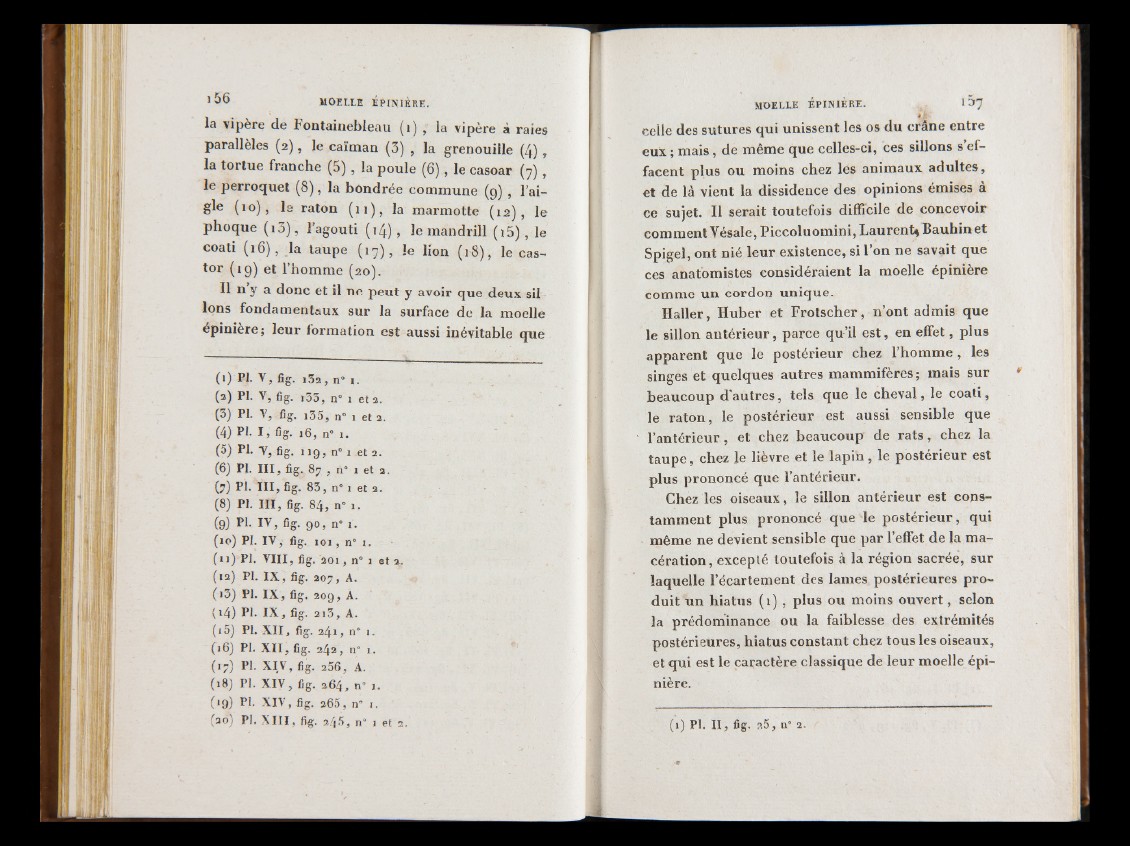
la vipère de Fontainebleau (i) , la vipère à raies
parallèles (2), le caïman (3) la grenouille (4) r
la tortue franche (5) , la poule (6), le casoar (7) ,
le perroquet (8), la bondrée commune (g) , l’aigle
(10), le raton (11), la marmotte (12), le
phoque ( i3), l’agouti (14), le mandrill ( l5) , le
coati (16), la taupe (17), le lion (18), le cas-
tor (ig) et l’homme (20).
Il n y a donc et il ne peut y avoir que deux sillons
fondamentaux sur la surface de la moelle
épinière; leur formation est aussi inévitable que
(I) PI. V, fig. 152, n° 1.
(а) PI. V, fig. i33, n° ï et a.
(3) Pl. V, fig. i35, n° 1 et 2.
(4) Pl. I, fig. 16, n° i.
(5) PI. Y, fig. ng, n° 1 et 2.
(б) Pl. n i , fig. 87 , n° 1 et 2.
(7) Pl. III, fig. 85, n° 1 et 2.
(8) Pl. III, fig. 84, n” 1.
(9) Pl. IV, fig. 90, n° 1.
(10) Pl. IV, fig. 101, n° î.
(II) Pl. VIII, fig. '201, n° 1 et a.
(12) Pl. IX, fig. 207, A.
(13) Pl. IX, fig. 209, A.
(14) PL IX, fig. 2i3 , A.
(15) Pl. XII, fig. 241, n* 1.
(16) Pl. XII, fig. 242, n» 1.
(17) Pl- XIV, fig. 256, A.
(18) PI. XIV, fig. 264, n” 1.
(19) PI. XIV, .fig. 265, n" 1.
MOELLE ÉPINIÈRE. y 1^7 tÈcelle
des sutures qui unissent les os du crâne entre
eux ; mais, de même que celles-ci, ces sillons s’effacent
plus ou moins chez les animaux adultes,
et de là vient la dissidence des opinions émises à
ce sujet. Il serait toutefois difficile de concevoir
comment Yésale, Piccoluomini, Laurent^ Bauhinet
Spigel, ont nié leur existence, si l’on ne savait que
ces anatomistes considéraient la moelle épinière
comme un cordon unique.
Haller, Huber et Frotscher, n’ont admis que
le sillon antérieur, parce qu’il est, en effet, plus
apparent que le postérieur chez l’homme, les
singes et quelques autres mammifères ; mais sur
beaucoup d’autres, tels que le cheval, le coati,
le raton, le postérieur est aussi sensible que
l’antérieur, et chez beaucoup de rats, chez la
taupe, chez le lièvre et le lapin, le postérieur est
plus prononcé que l’antérieur.
Chez les oiseaux, le sillon antérieur est constamment
plus prononcé que le postérieur, qui
même ne devient sensible que par l’effet de la macération,
excepté toutefois à la région sacrée, sur
laquelle l’écartement des lames postérieures produit
un hiatus (1) , plus ou moins ouvert, selon
la prédominance ou la faiblesse des extrémités
postérieures, hiatus constant chez tous les oiseaux,
et qui est le caractère classique de leur moelle épinière.