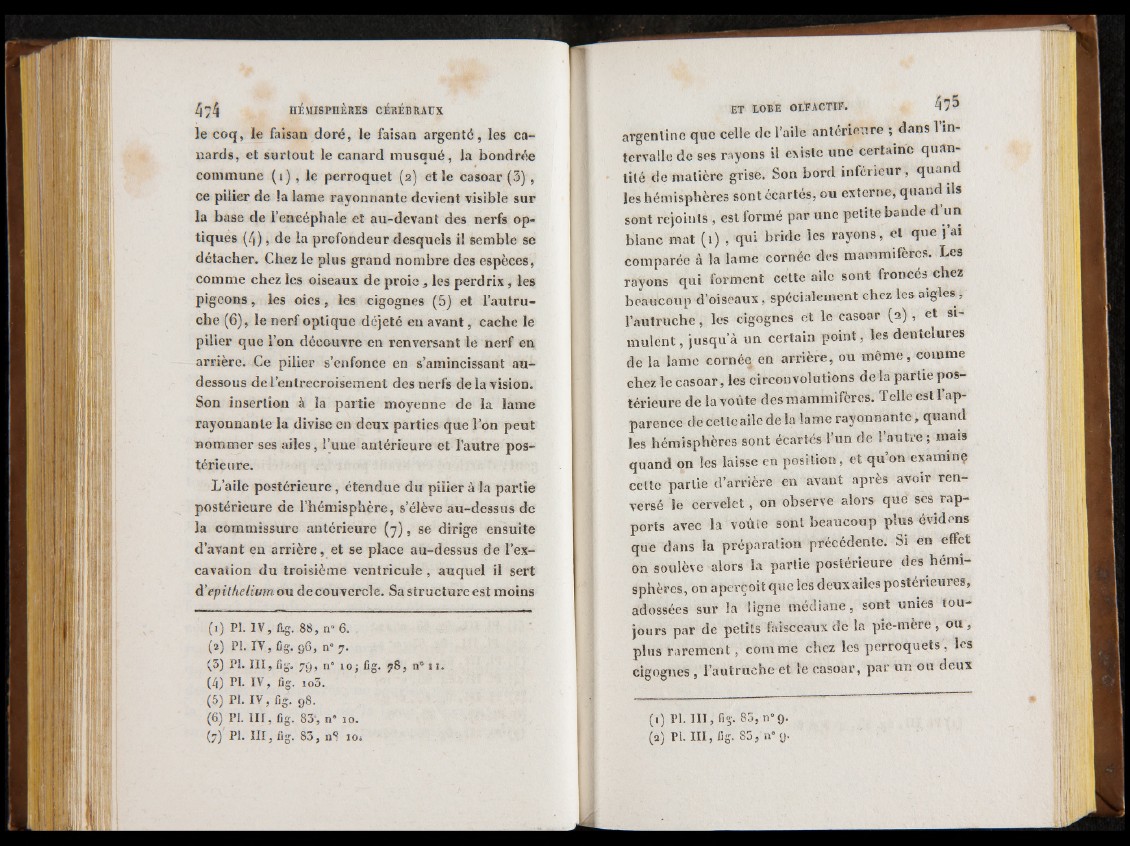
le coq, le faisan doré, le faisan argenté, les canards,
et surtout le canard musqué, la bondrée
commune ( i ) , le perroquet (2) et le casoar (3) ,
ce pilier de la lame rayonnante devient visible sur
la base de l'encéphale et au-devant des nerfs optiques
(4|, de la profondeur desquels il semble se
détacher. Chez le plus grand nombre des espèces,
comme chez les oiseaux de proie, les perdrix, les
pigeons, les oies, les cigognes (5) et l'autruche
(6), le nerf optique déjeté en avant, cache le
pilier que l’on découvre en renversant le nerf en
arrière. Ce pilier s’enfonce en s’amincissant au-
dessous de l ’entrecroisement des nerfs de la vision.
Son insertion à la partie moyenne de la lame
rayonnante la divise en deux parties que l ’on peut
nommer ses ailes, l’une antérieure et l ’autre postérieure.
L’aile postérieure, étendue du pilier à la partie
postérieure de l’hémisphère, s’élève au-dessus de
la commissure antérieure (7), se dirige ensuite
d’avant en arrière, et se place au-dessus de l’excavation
du troisième ventricule, auquel il sert
d'epithelium ou de couvercle. Sa structure est moins
(1) PL IV, ûg. 88, n° 6.
(2) Pl. IV, ûg. 96, n° 7.
(3) PL III, fig. 79, n° ûg. 78, n° 11.
(4) PL IV, fig. io3.
(5) PL IV, fig. 98.
(6) PL III, fig. 83‘, n" 10.
(7) PL III, fig. 83, n8 10*
argentine que celle de l’aile antérieure ; dans l’intervalle
de ses rayons il existe une certaine quantité
de matière grise. Son bord inférieur , quand
les hémisphères sont écartés, ou externe, quand ils
sont rejoints , est formé par une petite bande d un
blanc mat (1) , qui bride les rayons, et que j’ai
comparée à la lame cornée des mammifères. Les
rayons qui forment cette aile sont froncés chez
beaucoup d’oiseaux, spécialement chez les aigles,
l’autruche, les cigognes et le casoar (a) , et simulent,
jusqu’à un certain point, les dentemres
de la lame cornée en arrière, ou même, comme
chez le casoar, les circonvolutions de la partie postérieure
de la voûte des mammifères. Telle est l’apparence
de cette aile de la lame rayonnante, quand
les hémisphères sont écartés 1 un de 1 autre ; mais
quand on les laisse en position, et qu’on examine
cette partie d’arrière en avant après avoir renversé
le cervelet, on observe alors que ses rapports
avec la voûte sont beaucoup plus évidens
que dans la préparation précédente. Si en effet
on soulève alors la partie postérieure des hémisphères,
on aperçoit que les deux ailes postérieures,
adossées sur la ligne médiane, sont unies toujours
par de petits faisceaux de la pie-mère , ou ,
plus rarement, comme chez les perroquets, les
cigognes , l’autruche et le casoar, par un ou deux
(1) IM. IIT, fig. 83, n“9.
(2) Pl. III, fig. 85, a” y.