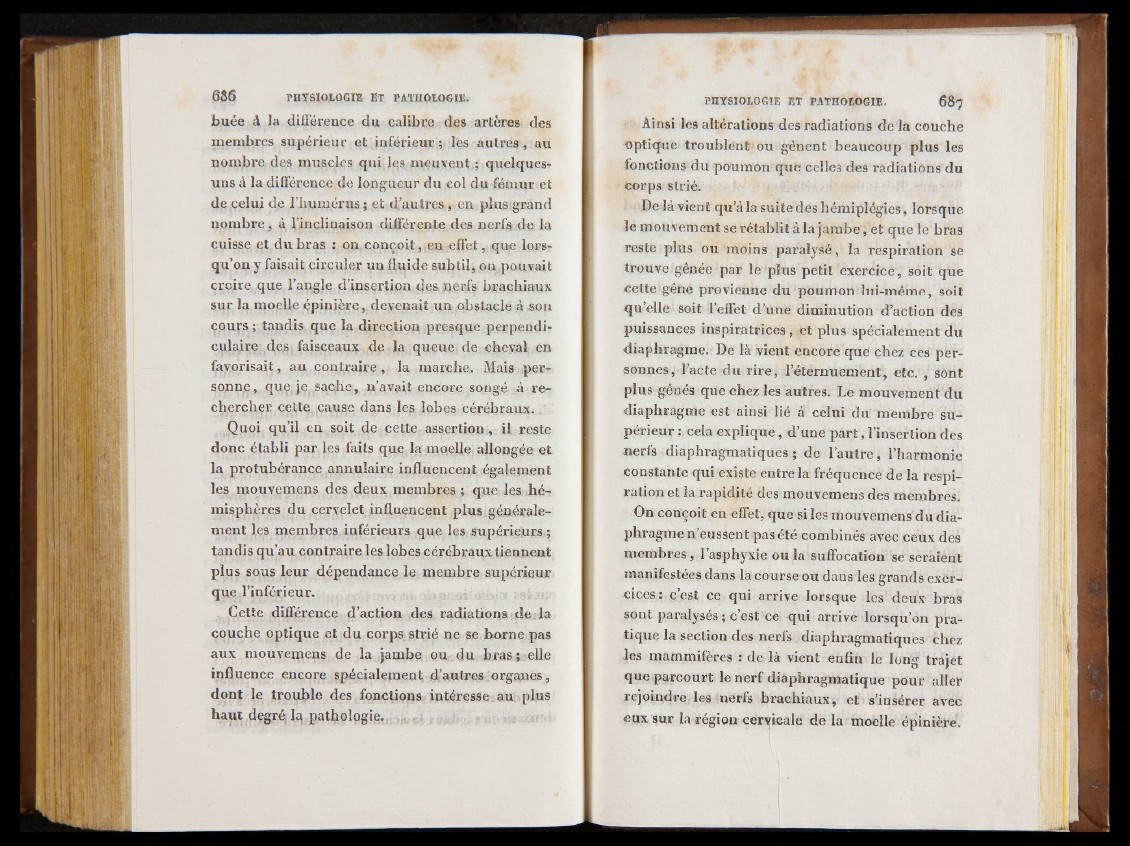
buée à la différence du calibre des artères des
membres supérieur et inférieur ; les autres, au
nombre des muscles qui Iqs meuvent : quelques-
uns à la différence de long ueur du col du fémur et
de celui de l'humérus; et d’autres , en plus grand
nombre, à l’inclinaison différente des nerfs de la
cuisse et du bras : on conçoit, en effet , que lorsqu’on
y faisait circuler un fluide subtil, on pouvait
croire que l’angle d’insertion des nerfs brachiaux
sur la moelle épinière, devenait un obstacle à son
cours; tandis que la direction presque perpendiculaire
de(s faisceaux de la queue, de cheval en
favorisait, au contraire , la marche. Mais personne,
que je sache, n’avait encore songé à rechercher
cette cause dans les lobes cérébraux.
Quoi qu’il en soit de cette assertion, il reste
donc établi par les faits que la moelle allongée et
la protubérance annulaire influencent également
les mouvemcns des deux membres ; que les hémisphères
du cervelet influencent plus généralement
les membres inférieurs que les supérieurs,;
tandis qu’au contraire les lobes cérébrâqx tiennent
plus sous leur dépendance le membre supérieur
que l’inférieur.
Cette différence d’action des radiations de,1a
couche optique et du corps strié ne se borne pas
aux mouvemens de la jambe ou du bras ; ;elle
influence encore spécialement d’autres organes,
dont le trouble des fonctions, intéresse,au plus
haut degré la, pathologie. .
Ainsi les altérations des radiations de la couche
Optique troublent ou gênent beaucoup plus les
fonctions du poumon que celles des radiations du
corps strié.
De là vient qu’à la suite des hémiplégies, lorsque
le mouvement se rétablit à la jambe, et que le bras
reste plus ou moins paralysé, la respiration se
trouve gênée par le plus petit exercice, soit que
cette gêne provienne du poumon lui-même, soit
qu’elle soit l’effet d’une diminution d’action des
puissances inspiratrices , et plus spécialement du
diaphragme. De là vient encore que chez ces personnes,
l’acte du rire, l’éternuement, etc. , sont
plus gênés que chez les autres. Le mouvement du
diaphragme est ainsi lié à celui du membre supérieur
cela explique, d’une part, l’insertion des
nerfs diaphragmatiques; de l’autre, l’harmonie
constante qui existe entre la fréquence de la respiration
et la rapidité des mouvemens des membres.
On conçoit en effet, que si les mouvemens du diaphragme
n’eussent pas été combinés avec ceux des
membres , l’asphyxie ou la suffocation se seraient
manifestées dans la course ou dans les grands exercices:
c’est ce qui arrive lorsque les deux bras
sont paralysés ; c’est ce qui arrive lorsqu’on pratique
la section des nerfs diaphragmatiques chez
les mammifères : de là vient enfin le long trajet
que parcourt le nerf diaphragmatique pour aller
rejoindre les nerfs brachiaux, et sfinsérer avec
eux sur la région ceryieale de la moelle épinière.