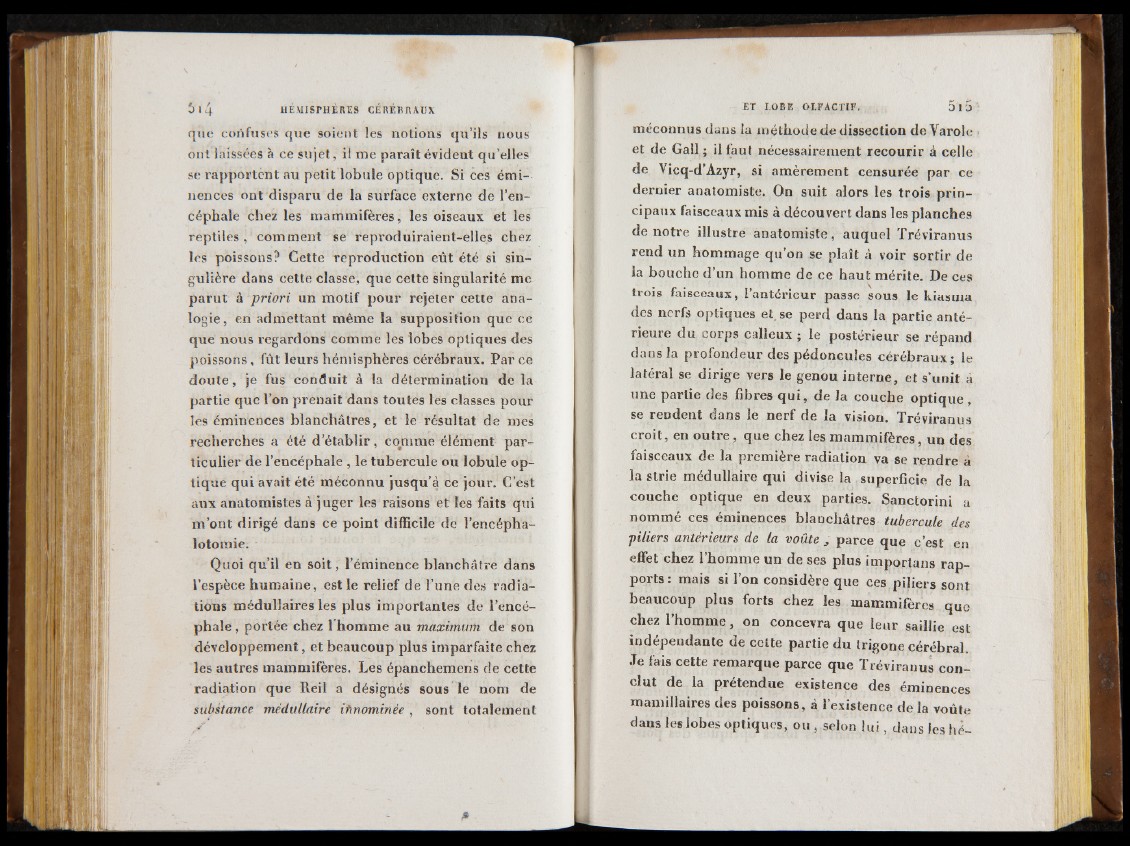
*D. 1i 4/
que confuses que soient les notions qu’ils nous
ont laissées à ce sujet, il me paraît évident qu’elles
se rapportent au petit lobule optique. Si ces éminences
ont disparu de la surface externe de l’encéphale
chez les mammifères, les oiseaux et les
reptiles, comment se reproduiraient-elles chez
les poissons? Cette reproduction eût été si singulière
dans cette classe, que celte singularité me
parut à priori un motif pour rejeter cette analogie,
en admettant même la supposition que ce
que nous regardons comme les lobes optiques des
poissons, fût leurs hémisphères cérébraux. Par ce
do u te , je fus conduit à la détermination de la
partie que l’on prenait dans toutes les classes pour
les éminences blanchâtres, et le résultat de mes
recherches a été d ’établir, coanime élément particulier
de l’encéphale , le tubercule ou lobule optique
qui avait été méconnu jusqu’à ce jour. C’est
aux anatomistes à juger les raisons et les faits qui
m ’ont dirigé dans ce point difficile de l’encéphalotomie.
Quoi qu’il en soit, l’éminence blanchâtre dans
l’espèce humaine, est le relief de l’une des radiations
médullaires les plus importantes de l’encéphale
, portée chez 1 homme au maximum de son
développement, et beaucoup plus imparfaite chez
les autres mammifères. Les épanchemens de cette
radiation que Reil a désignés sous le nom de
substance médullaire itinominée , sont totalement
méconnus dans la méthode de dissection de Varole
et de Gall ; il faut nécessairement recourir à celle
de Vicq-d’Azyr, si amèrement censurée par ce
dernier anatomiste. On suit alors les trois principaux
faisceaux mis à découvert dans les planches
de notre illustre anatomiste, auquel Tréviranus
rend un hommage qu’on se plaît à voir sortir de
la bouche d’un homme de ce haut mérite. De ces
trois faisceaux, l’antérieur passe sous le kiasma
des nerfs optiques et. se perd dans la partie antérieure
du corps calleux ; le postérieur se répand
dans la profondeur des pédoncules cérébraux; le
latéral se dirige vers le genou interne, et s’unit à
une partie des fibres qui, de la couche optique,
se rendent dans le nerf de la vision. Tréviranus
croit, en outre, que chez les mammifères, un des
faisceaux de la première radiation va se rendre à
la strie médullaire qui divise la superficie de la
couche optique en deux parties. Sanctorini a
nommé ces éminences blanchâtres tubercule des
■piliers antérieurs de la voûte J parce que c’est en
effet chez l’homme un de ses plus importans rapports
: mais si l’on considère que ces piliers sont
beaucoup plus forts chez les mammifères que
chez l’homme, on concevra que leur saillie est
indépendante de cette partie du trigone cérébral.
Je fais cette remarque parce que Tréviranus conclut
de la prétendue existence des éminences
mamillaires des poissons, à l’existence de la voûte
dans les lobes optiques, ou , selon lu i, dans les hé