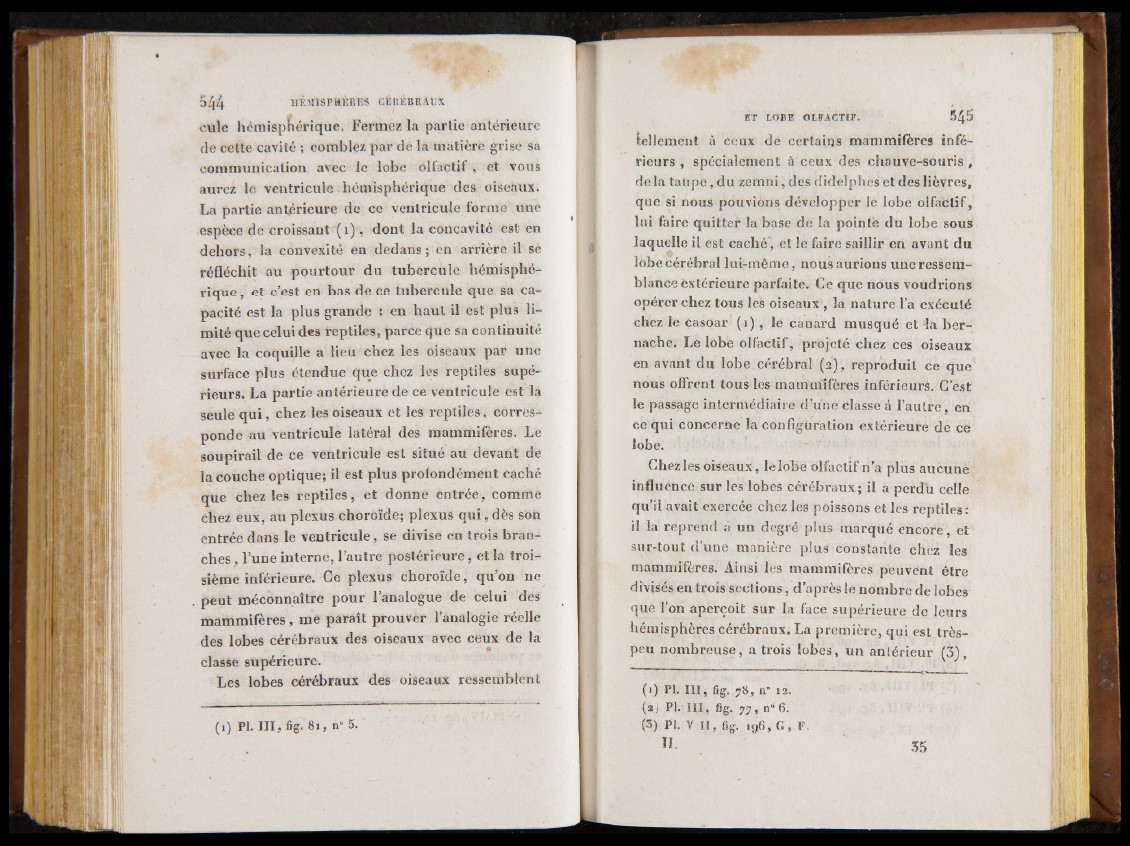
cule hémisphérique. Fermez la partie antérieure
de cette cavité ; comblez par de la matière grise sa
communication avec le lobe ollactil , et vous
aurez le ventricule hémisphérique des oiseaux.
La partie antérieure de ce ventricule forme une
espèce de croissant ( i ) , dont la concavité est en
dehors, la convexité en dedans; en arrière il se
réfléchit au pourtour du tubercule hémisphérique
, et c’est en bas de ce tubercule que sa capacité
est la plus grande : en haut il est plus limité
que celui des reptiles, parce que sa continuité
avec la coquille a lieu chez les oiseaux par une
surface plus étendue que chez les reptiles supérieurs.
La partie antérieure de ce ventricule est la
seule q u i, chez les oiseaux et les reptiles, corresponde
au ventricule latéral des mammifères. Le
soupirail de ce ventricule est situé au devant de
la couche optique; il est plus profondément caché
que chez les reptiles, et donne entrée , comme
chez eux, au plexus choroïde; plexus q u i, dès son
entrée dans le ventricule , se divise en trois branches
, l’une interne, l’autre postérieure, et la troisième
inférieure. Ce plexus choroïde, qu’on ne
peut méconnaître pour l’analogue de celui des
mammifères, me paraît prouver l’analogie réelle
des lobes cérébraux des oiseaux avec ceux de la
classe supérieure.
Les lobes cérébraux des oiseaux ressemblent
tellement à ceux de certains mammifères inférieurs
, spécialement à ceux des chauve-souris ,
delà taupe, du zemni, des didelphes et des lièvres,
que si nous pouvions développer le lobe olfactif,
lui faire quitter la base de la pointe du lobe sous
laquelle il est caché, et le faire saillir en avant du
lobe cérébral lui-même, nous aurions une ressemblance
extérieure parfaite. Ce que nous voudrions
opérer chez tous les oiseaux , la nature l’a exécuté
chez le casoar (1) , le canard musqué et la ber-
nache. Le lobe olfactif, projeté chez ces oiseaux
en avant du lobe cérébraiî (2), reproduit Ce que
nous offrent tous les mammifères inférieurs. C’est
le passage intermédiaire d'une classe à l’autre, en
ce qui concerne la configuration extérieure de ce
lobe.
Chez les oiseaux, le lobe olfactif n’a plus aucune
influence sur les lobes cérébraux; il a perdu celle
qu’il avait exercée chez les poissons et les reptiles:
il la reprend à un degré plus marqué encore, et
sur-tout d’une manière plus constante chei les
mammifères. Ainsi les mammifères peuvent être
divisés en trois sections, d ’après le nombre de lobes
que l’on aperçoit sur la face supérieure de leurs
hémisphères cérébraux. La première, qui est très-
peu nombreuse, a trois lobes, un antérieur (3),
(1) PL III, fig. 78, a" 12.
(2) PL III, fig. yjr, nri 6.
(3) PI. V II, fig. 196, G, F;
IL