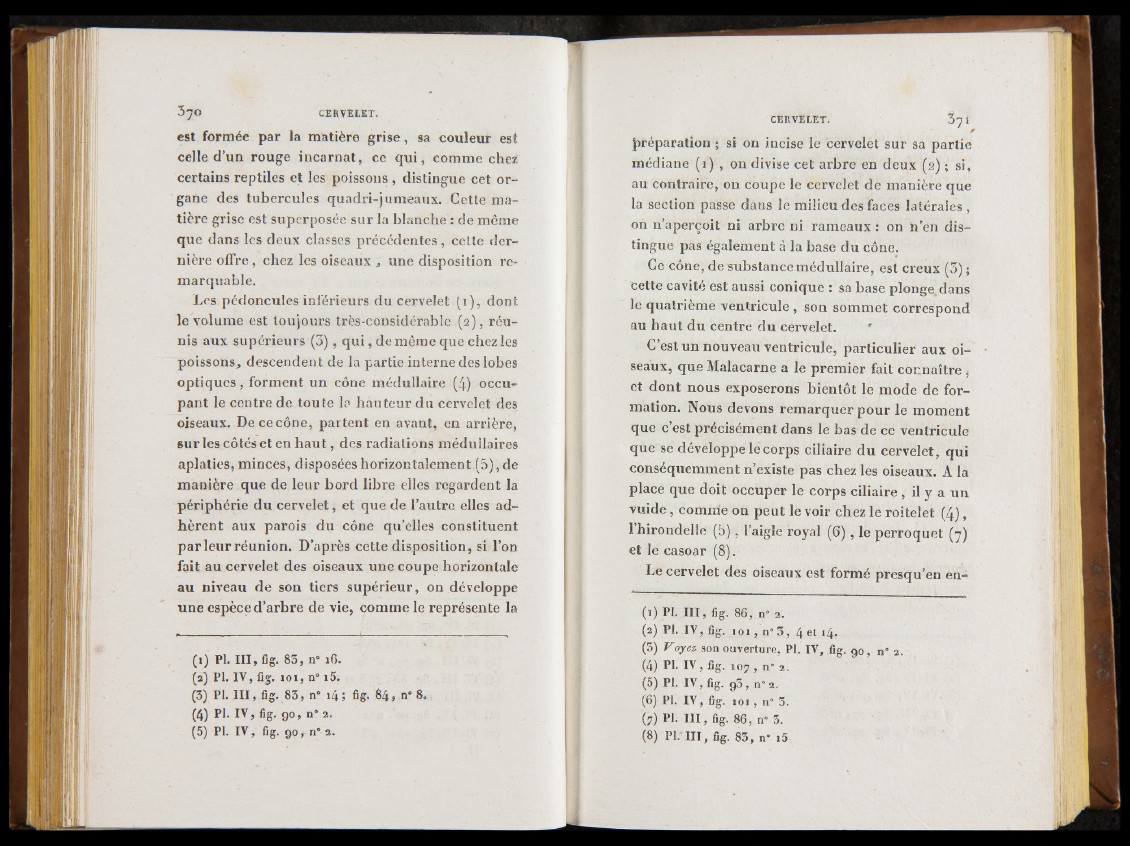
est formée par la matière grise, sa couleur est
celle d’un rouge incarnat, ce qui, comme chez
certains reptiles et les poissons , distingue cet organe
des tubercules quadri-jumeaux. Cette matière
grise est superposée sur la blanche : de même
que dans les deux classes précédentes, celle dernière
offre , chez les oiseaux , une disposition remarquable.
Les pédoncules inférieurs du cervelet (i), dont
le volume est toujours très-considérable (2), réunis
aux supérieurs (3) , q u i, de même que chez les
poissons., descendent de la partie interne des lobes
optiques, forment un cône médullaire (4) occupant
le centre de toute la hauteur du cervelet des
oiseaux* De ce cône, partent en avant, en arrière,
sur les côtés et en h a u t, des radiations médullaires
aplaties, minces, disposées horizontalement (5), de
manière que de leur bord libre elles regardent la
périphérie du cervelet, et que de l’autre elles adhèrent
aux parois du cône qu’elles constituent
par leur réunion. D’après cette disposition, si l’on
fait au cervelet des oiseaux une coupe horizontale
au niveau de son tiers supérieur, on développe
une espèce d’arbre de vie, pomme le représente la
(1) PL III, fig. 85, n° i0.
(2) PI. IV, fig. îoi, n° i5.
(3) PI. III, fig. 83, n° 14; fig. 84, n“ 8.
(4) PI. IV, fig. 90, n° 2.
(5) PI. IV, fig. 9o ï n° 2.
préparation ; si on incise le cervelet sur sa partie
médiane (x) , on divise cet arbre en deux (2) ; si,
au contraire, on coupe le cervelet de manière que
la section passe dans le milieu des faces latérales ,
on n’aperçoit ni arbre ni rameaux : on h ’en distingue
pas également à la base du cône.
Ce cône, de substance médullaire, est creux (3) ;
cette cavité est aussi conique : sa base plonge^dans
le quatrième ventricule , son sommet correspond
au haut du centre du cervelet. '
C’est un nouveau ventricule, particulier aux oiseaux,
que Malacarne a le premier fait connaître i
et dont nous exposerons bientôt le mode de formation.
Nous devons remarquer pour le moment
que c’est précisément dans le bas de ce ventricule
que se développe lé corps ciliaire du cervelet, qui
conséquemment n’existe pas chez les oiseaux. A la
place que doit occuper le corps ciliairç , il y a un
vuide, comine on peut le voir chez le roitelet (4),
1 hirondelle (5), l’aigle royal (6) , le perroquet (7)
et le casoar (8).
Le cervelet des oiseaux est formé presqu’en en-
(1) PI. III, fig. 86, n» 2.
(2) PL IV, fig. 101, n° 3 , 4 et 14.
(3) Voyez son ouverture, PL IV, fig. go, n" 2.
(4) PL IV, fig. 107, n° 2.
(5) PL IV, fig. 93 ,n « 2.
(6) PL IV, fig. 101, n» 3.
(7) PL III, fig. 86, n» 3.
(8) PL'III, fi€ . 83, n° i 5;