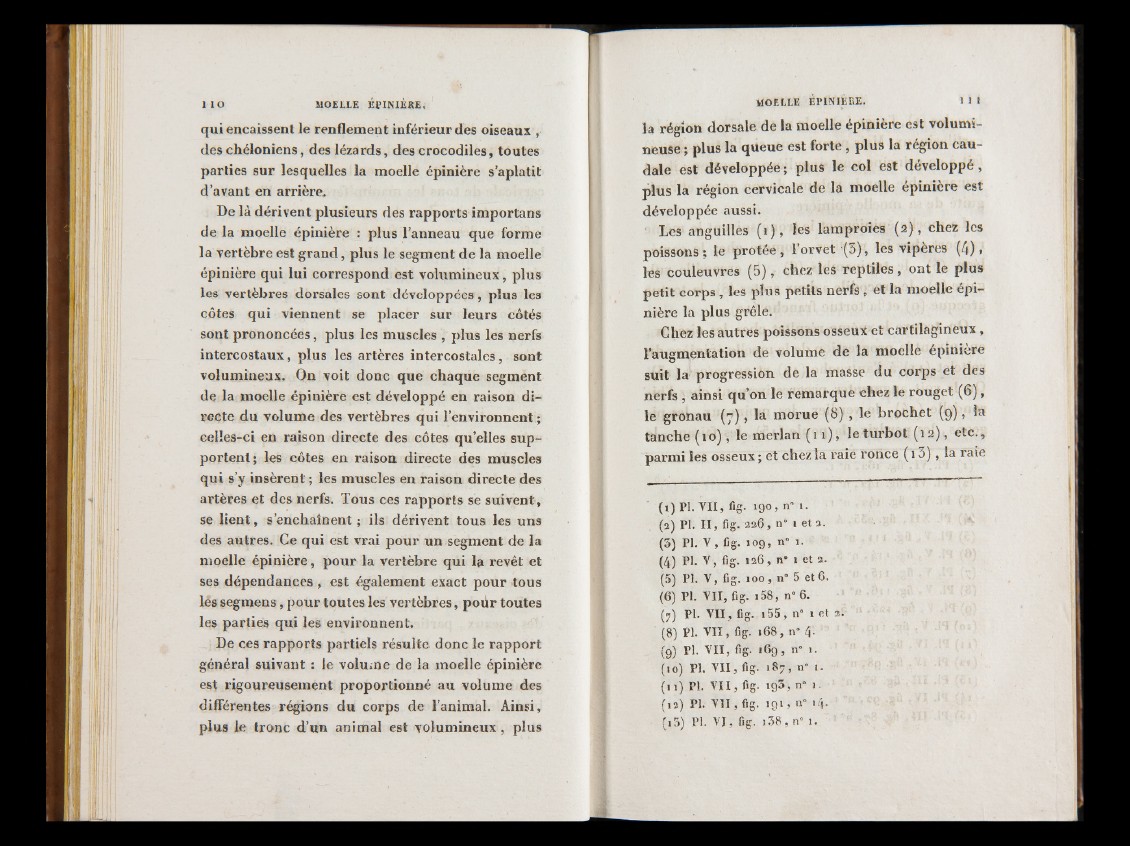
qui encaissent le renflement inférieur des oiseaux ,
des chéloniens, des lézards, des crocodiles, toutes
parties sur lesquelles la moelle épinière s’aplatit
d ’avant en arrière.
De là dérivent plusieurs des rapports importons
de la moelle épinière : plus l’anneau que forme
la vertèbre est grand, plus le segment de la moelle
épinière qui lui correspond est volumineux, plus
les vertèbres dorsales sont développées, plus les
côtes qui viennent se placer sur leurs côtés
sont prononcées, plus les muscles , plus les nerfs
intercostaux, plus les artères intercostales, sont
volumineux. On voit donc que chaque segment
de la moelle épinière est développé en raison directe
du volume des vertèbres qui l’environnent ;
celles-ci en raison directe des côtes qu’elles supportent;
les côtes en raison directe des muscles
qui s’y insèrent; les muscles en raison directe des
artères et des nerfs. Tous ces rapports se suivent,
se lient, s’enchaînent ; ils dérivent tous les uns
des autres. Ce qui est vrai pour un segment de la
moelle épinière, pour la vertèbre qui la revêt et
ses dépendances , est également exact pour tous
les segmens, pour toutes les vertèbres, poür toutes
les parties qui les environnent.
De ces rapports partiels résulte donc le rapport
général suivant : le volume de la moelle épinière
est rigoureusement proportionné au volume des
différentes régions du corps de l’animal. Ainsi,
plus le tronc d’un animal est volumineux, plus
la région dorsale de la moelle épinière est volumineuse
; plus la queue est forte, plus la région caudale
est développée ; plus le col est développé,
plus la région cervicale de la moelle épinière est
développée aussi.
Les anguilles (i) , les lamproies (2), chez les
poissons ; le protée, l’orvet (3), les vipères (4),
les couleuvres (5) | chez les reptiles, ont le plus
petit corps, les plus petits nerfs , et la moelle épinière
la plus grêle.
Chez les autres poissons osseux et cartilagineux,
l’augmentation de volume de la moelle épinière
suit la progression de la masse du corps et des
nerfs ; ainsi qu’on le remarque chez le rouget (6),
le gronau (7), la morue (8) , le brochet (9) , la
tanche (10), le merlan ( 11), le turbot (12), etc.,
parmi les osseux ; et chez la raie ronce ( 13), la raie
(1) PI. VII, fig. 190, n" 1.
(2) PI. I I , fig. 226, n° 1 et 2.
(3) PI. V, fig. 109, n" 1.
(4) PI. V, fig. 126, n* 1 et 2.
(5) PI. V, fig. 100, n” 5 et 6.
(6) PI. YII, fig. i 58, n° 6.
(7) PI. VII , fig. i 55, n° 1 et 2.
(8) PI. VU, fig. 168, n* 4.
(9) PI. VII, fig. 169, n° 1.
(10) PI. VII, fig. 187, n° 1.
(11) PI. VII, fig. icj3 , n° 1.
(12) pi. ’v u , fig. 191, n° «4.
(13) PI. VI, fig. i 3 8 , n” 1. r