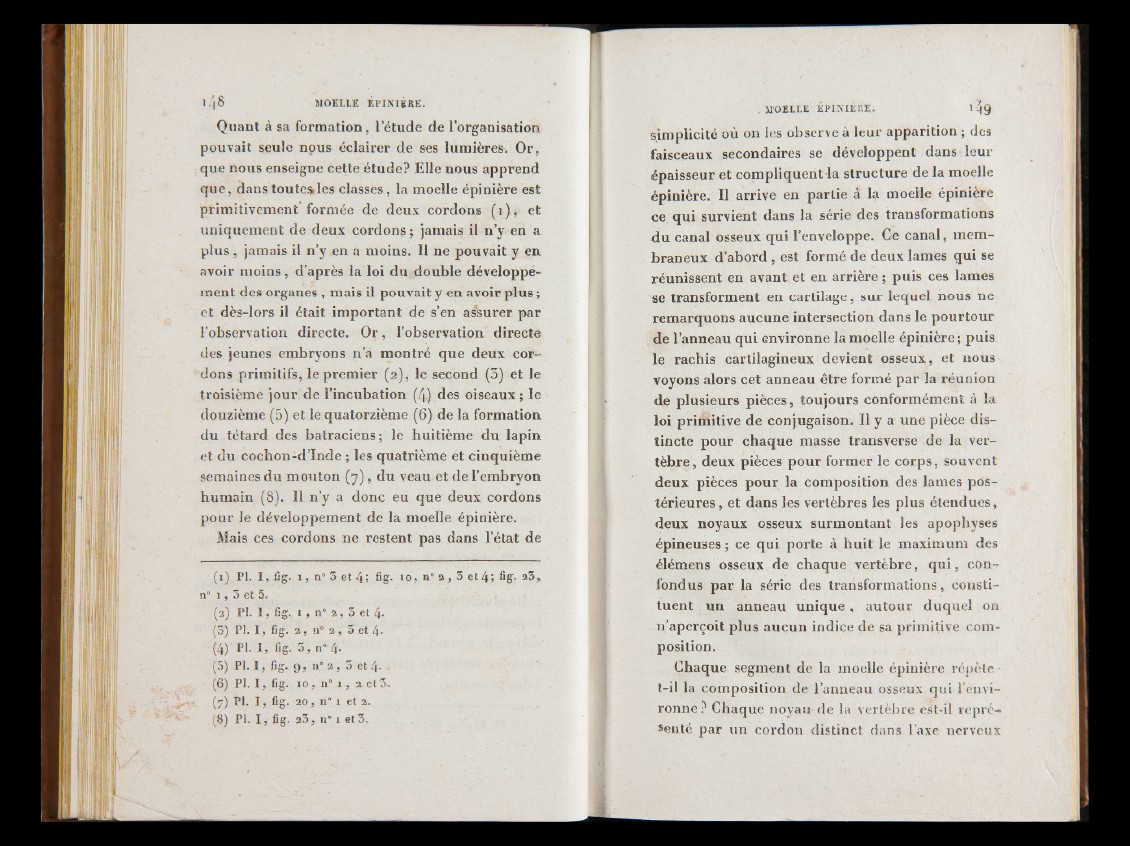
Quant à sa formation, l ’étude de l’organisation
pouvait seule nous éclairer de ses lumières*. Or,
que nous enseigne cette étude? Elle nous apprend
que, dans toutes les classes, la moelle épinière est
primitivement* formée de deux cordons (1), et
uniquement de deux cordon? ; jamais il n ’y en a
plus , jamais il n’y en a moins. Il ne pouvait y en
avoir moins, d’après la loi du double développement
des organes , mais il pouvait y en avoir plus ;
et dès-lors il était important de s’en as*surer par
l’observation directe. Or, l’observation directe
des jeunes embryons n ’a montré que deux cordons
primitifs, le premier (a), le second (3) et le
troisième jour de l’incubation (4) des oiseaux; le
douzième (5) et le quatorzième (6) de la formation
du têtard des batraciens; le huitième du lapin
et du cochon-d’Inde ; les quatrième et cinquième
semaines du mouton (7), du veau et de l’embryon
humain (8). Il n’y a donc eu que deux cordons
pour le développement de la moelle épinière.
Mais ces cordons ne restent pas dans l’état de
(0 PI. I, %• I 9 n° 3 et 4 ? fis-
3 et 5.
( 2 ) PI. 1, fis- • >n° 2, 3 et 4.
(3) PI. I, fig. 2? n° 2, 5 et 4-
(4) PI. I, fis- 3 , n° 4.
(5) P l.I , fis- 9 >n” 2 , 3 et 4- -
(6) PI. I, fis- , 10, n° î , 2 et 3-
(7) PI. I, fig. 20, n° 1 et 2.
(») P l.I , fig. 23 , il" 1 et 3.
simplicité où on les observe à leur apparition ; des
faisceaux secondaires se développent dans leur
épaisseur et compliquent la structure de la moelle
épinière. Il arrive en partie à la moelle épinière
ce qui survient dans la série des transformations
du canal osseux qui l’enveloppe. Ce canal, membraneux
d’abord , est formé de deux lames qui se
réunissent en avant et en arrière ; puis ces lames
se transforment en cartilage, sur lequel nous ne
remarquons aucune intersection dans le pourtour
de l’anneau qui environne la moelle épinière; puis
le rachis cartilagineux devient osseux, et nous
voyons alors cet anneau être formé par la réunion
de plusieurs pièces, toujours conformément à la
loi primitive de conjugaison. Il y a une pièce distincte
pour chaque masse transverse de la vertèbre
, deux pièces pour former le corps, souvent
deux pièces pour la composition des lames postérieures,
et dans les vertèbres les plus étendues,
deux noyaux osseux surmontant les apophyses
épineuses; ce qui porte à huit le maximum des
élémens osseux de chaque vertèbre, q u i, corn
fondus par la série des transformations, constituent
un anneau u n iq u e , autour duquel on
n’aperçoit plus aucun indice de sa primitive composition.
Chaque segment de la moelle épinière répète *
t-il la composition de l’anneau osseux qui l’environne
? Chaque noyau de la vertèbre est-il représenté
par un cordon distinct dans l ’axe nerveux