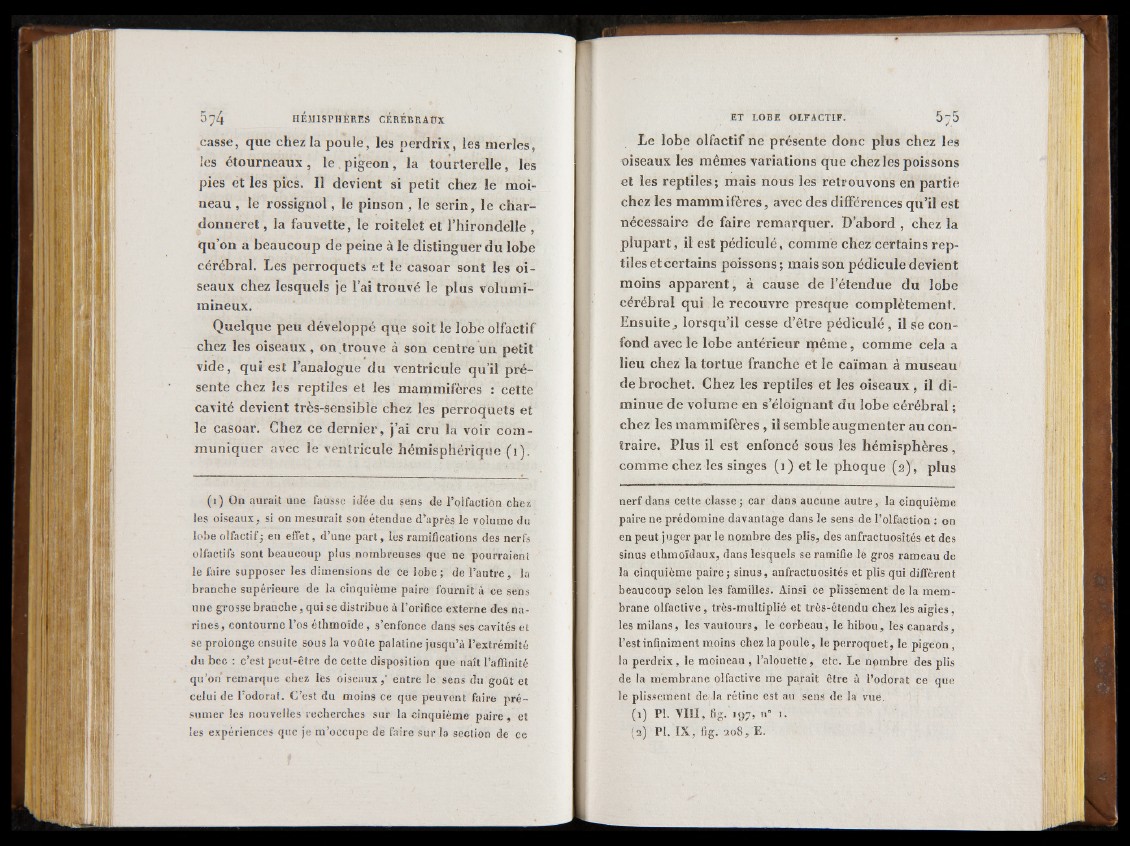
casse, que chez la poule, les perdrix, les merles,
les étourneaux, le.pigeon, la tourterelle, les
pies et les pics. Il devient si petit chez le moineau
, le rossignol, le pinson, le serin, le chardonneret
, la fauvette, le roitelet et l’hirondelle ,
qu’on a beaucoup de peine à le distinguer du lobe
cérébral. Les perroquets et le casoar sont les oiseaux
chez lesquels je l’ai trouvé le plus volumi-
mineux.
Quelque peu développé qqe soit le lobe olfactif
chez les oiseaux, on trouve à son centre un petit
vide, qui est l’analogue du ventricule qu’il présente
chez les reptiles et les mammifères : cette
cavité devient très-sensible chez les perroquets et
le casoar. Chez ce dernier, j’ai cru la voir communiquer
avec le ventricule hémisphérique (1).
(1) On aurait une fausse idée du sens de l’oifaction chez
les oiseaux, si on mesurait son étendue d’après le volume du
lobe olfactif ; en effet, d’une part, les ramifications des nerfs
olfactifs sont beaucoup plus nombreuses que ne pourraient
le faire supposer les dimensions de ce lobe; de l’autre, la
branche supérieure de la cinquième paire fournit à ce sens
une grosse branche , qui se distribue à l’orifice externe des narines,
contourne l’os éthmoïde, s’enfonce dans ses cavités et
se prolonge ensuite sous la voûte palatine jusqu’à l’extrémité
du bec : c’est peut-être de cette disposition que naît l’affinité
qu’on’ remarque chez les oiseaux,' entre le sens du goût et
celui de l’odorat. C’est du moins ce que peuvent faire présumer
les nouvelles recherches sur la cinquième paire, et
les expériences que je m’occupe de faire sur la section de ce
Le lobe olfactif ne présente donc plus chez les
oiseaux les mêmes variations que chez les poissons
et les reptiles; mais nous les retrouvons en partie
chez les mammifères, avec des différences qu’il est
nécessaire de faire remarquer. D’abord , chez la
plupart, il est pédiculé, comme chez certains reptiles
et certains poissons ; mais son pédicule devient
moins apparent, à cause de l’étendue du lobe
cérébral qui le recouvre presque complètement.
Ensuite., lorsqu’il cesse d’être pédiculé , il se confond
avec le lobe antérieur ipême | comme cela a
lieu chez la tortue franche et le caïman à museau
de brochet. Chez les reptiles et les oiseaux, il diminue
de volume en s’éloignant du lobe cérébral ;
chez les mammifères, il semble augmenter au contraire.
Plus il est enfoncé Sous les hémisphères,
comme chez les singes (i) et le phoque (2), plus
nerf dans cette classe ; car dans aucune autre, la cinquième
paire ne prédomine davantage dans le sens de l’olfaction : on
en peut juger par le nombre des plis, des anfractuosités et des
sinus ethmoïdaux, dans lesquels se ramifie lé gros rameau de
la cinquième paire; sinus, anfractuosités et plis qui diffèrent
beaucoup selon lès familles. Ainsi ce plissement de la membrane
olfactive, très-multiplié et très-étendu chez les aigles,
les milans, les vautours, le corbeau, le hibou, les canards,
l’est infiniment moins chez la poule, le perroquet, le pigeon,
la perdrix, le moineau , l’alouette, etc. Le npmbre des plis
de la membrane olfactive me parait être à l’odorat ce que
le plissement de. la rétine est au sens de la vue.
(x) PI. VIII, fig. 197, n° 1.