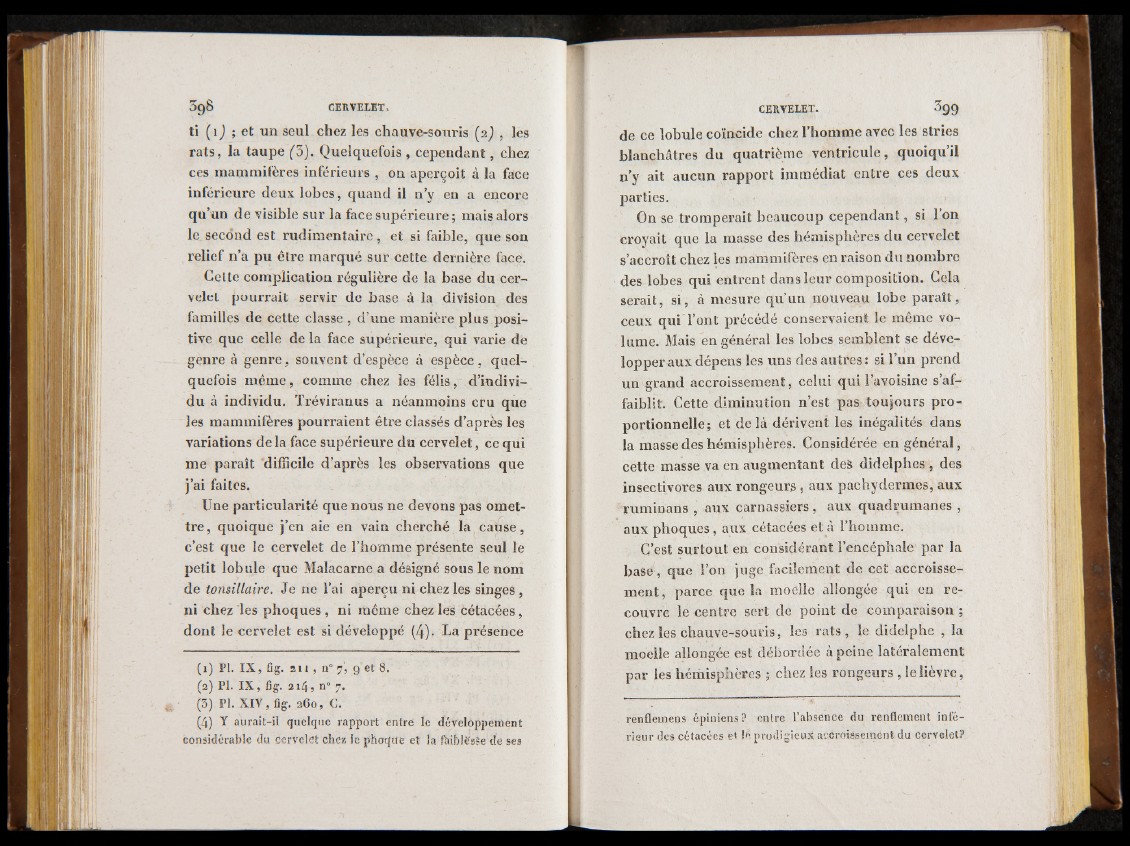
ti ( ij ; et un seul chez les chauve-souris {2) , les
rats, la taupe (3). Quelquefois , cependant, chez
ces mammifères inférieurs , on aperçoit à la face
inférieure deux lobes, quand il n’y en a encore
qu’un de visible sur la face supérieure; mais alors
le second est rudimentaire , et si faible, que son
relief n’a pu être marqué sur cette dernière face.
Celte complication régulière de la base du cervelet
pourrait servir de base à la division des
familles de cette classe , d’une manière plus positive
que celle de la face supérieure, qui varie de
genre à genre, souvent d’espèce à espèce, quelquefois
même, comme chez les félis, d’individu
à individu. Tréviranus a néanmoins cru que
les mammifères pourraient être classés d’après les
variations delà face supérieure du cervelet, ce qui
me paraît difficile d’après les observations que
j’ai faites.
Une particularité que nous ne devons pas omettre,
quoique j’en aie en vain cherché la caiise,
c’est que le cervelet de l’homme présente seul le
petit lobule que Malacarne a désigné sous le nom
de tonsillaire. Je ne l’ai aperçu ni chez les singes,
ni chez les phoques , ni même chez les cétacées,
dont le cervelet est si développé (4). La présence
(1) PI. IX, fiff. 211, n° 7, o et 8.
(a) PL IX ,fig. 214, n° 7.
(3) PL XIV, fîg. 260, C.
(4) Y aurait-il quelque rapport entre le développemént
considérable du cervelet chez le phoque et la fëiblésSe de ses
de ce lobule coïncide chez l’homme avec les stries
blanchâtres du quatrième ventricule, quoiqu’il
n’y ait aucun rapport immédiat entre ces deux
parties.
On se tromperait beaucoup cependant, si l’on
croyait que la masse des hémisphères du cervelet
s’accroît chez les mammifères en raison du nombre
des lobes qui entrent dans leur composition. Cela
serait, si, à mesure qu’un nouveau lobe paraît,
ceux qui l’ont précédé conservaient le même volume.
Mais en général les lobes semblent se développer
aux dépens les uns des autres : si l’un prend
un grand accroissement, celui qui l’avoisine s’affaiblit.
Cette diminution n’est pas toujours proportionnelle;
et de là dérivent les inégalités dans
la masse des hémisphères. Considérée en général,
cette masse va en augmentant de& didelphes , des
insectivores aux rongeurs , aux pachydermes, aux
ruminans I aux carnassiers, aux quadrumanes ,
aux phoques, aux cétacées et à l’homme.
C’est surtout en considérant l’encéphale par la
base, que l’on juge facilement de cet accroissement,
parce que la moelle allongée qui en recouvre
le centre sert de point de comparaison ;
chez les chauve-souris, les rats, le didelphe , la
moelle allongée est débordée à peine latéralement
par les hémisphères ; chez les rongeurs , le lièvre,
renflemens épiniens? entre l’absence du renflement inférieur
des cétacées et lé prodigieux accroissement du cervelet?