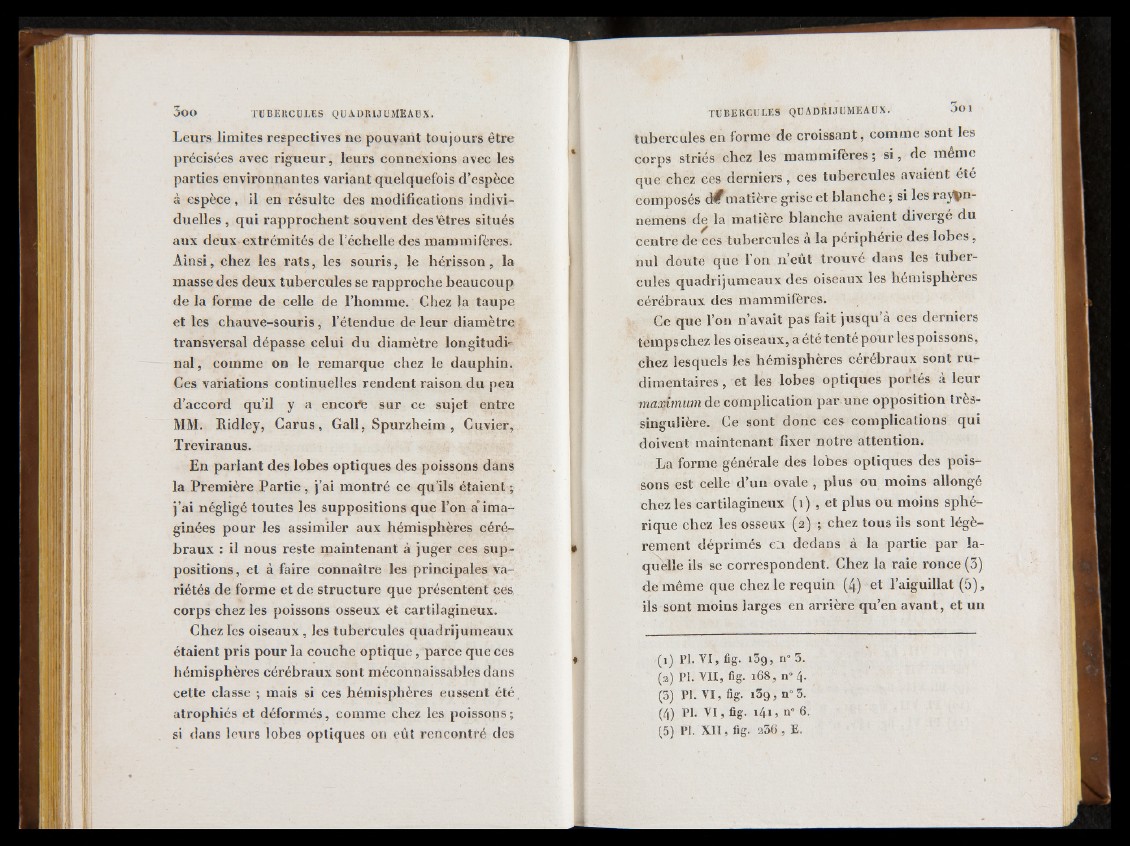
Leurs limites respectives ne pouvant toujours être
précisées avec rigueur, leurs connexions avec les
parties environnantes variant quelquefois d’espèce
à espèce, il en résulte des modifications individuelles
, qui rapprochent souvent des'êtres situés
aux deux extrémités de l’échelle des mammifères.
Ainsi, chez les rats, les souris, le hérisson, la
masse des deux tubercules se rapproche beaucoup
de la forme de celle de l’homme. Chez la taupe
et les chauve-souris, l’étendue de leur diamètre,
transversal dépasse celui du diamètre longitude
n a l, comme on le remarque chez le dauphin.
Ces variations continuelles rendent raison du peu
d’accord qu’il y a encorfe sur ce sujet entre
MM. Ridley, Carus, Gall, Spurzheim , Cuvier,
Treviranus.
En parlant des lobes optiques des poissons dans
la Première Partie, j’ai montré ce qu’ils étaient;
j’ai négligé toutes les suppositions que l’on a* imaginées
pour les assimiler aux hémisphères cérébraux
: il nous reste maintenant à juger ces suppositions,
et à faire connaître les principales variétés
de forme et de structure que présentent ces
corps chez les poissons osseux et cartilagineux.
Chez Tes oiseaux, les tubercules quadrijumeaux
étaient pris pour la couche optique, parce que ces
hémisphères cérébraux sont méconnaissables dans
cette classe ; mais si ces hémisphères eussent été,
atrophiés et déformés, comme chez les poissons;
si dans leurs lobes optiques on eût rencontré des
tubercules en forme de croissant, comme sont les
corps striés chez les mammifères ; s i, de même
que chez ces derniers, ces tubercules avaient été
composés cMf matière grise et blanche ; si les raj%>n-
nemens de la matière blanche avaient diverge du
centre de ces tubercules a la périphérie des lobes,
nul doute que l’on n’eût trouvé dans les tubercules
quadrijumeaux des oiseaux les hémisphères
cérébraux des mammifères.
Ce que l’on n’avait pas fait jusqu’à ces derniers
temps chez les oiseaux, a été tenté pour les poissons,
chez lesquels les hémisphères cérébraux sont ru dimentaires,
et les lobes optiques portés à leur
majaimum de complication par une opposition très-
singulière. Ce sont donc ces complications qui
doivent maintenant fixer notre attention.
La forme générale des lobes optiques des poissons
est celle d’un ovale , plus ou moins allongé
chez les cartilagineux (1) , et plus ou moins sphérique
chez les osseux (2) ; chez tous ils sont légè-
» rement déprimés en dedans à la partie par laquelle
ils se correspondent. Chez la raie ronce (3)
de même que chez le requin (4) et l’aiguillat (5),
ils sont moins larges en arrière qu’en avant, et un 1 * 3 4 5
(1) PI. VI, fig. i 3g , n° 3.
(a) Pi. VII, fig. 168, n°4.
(3) PL VI, fig. i 3g , n° 5.
(4) PI. VI, fig. i 4 »> n° 6.
(5) PI. XII, fig. a3 6 , E.
*