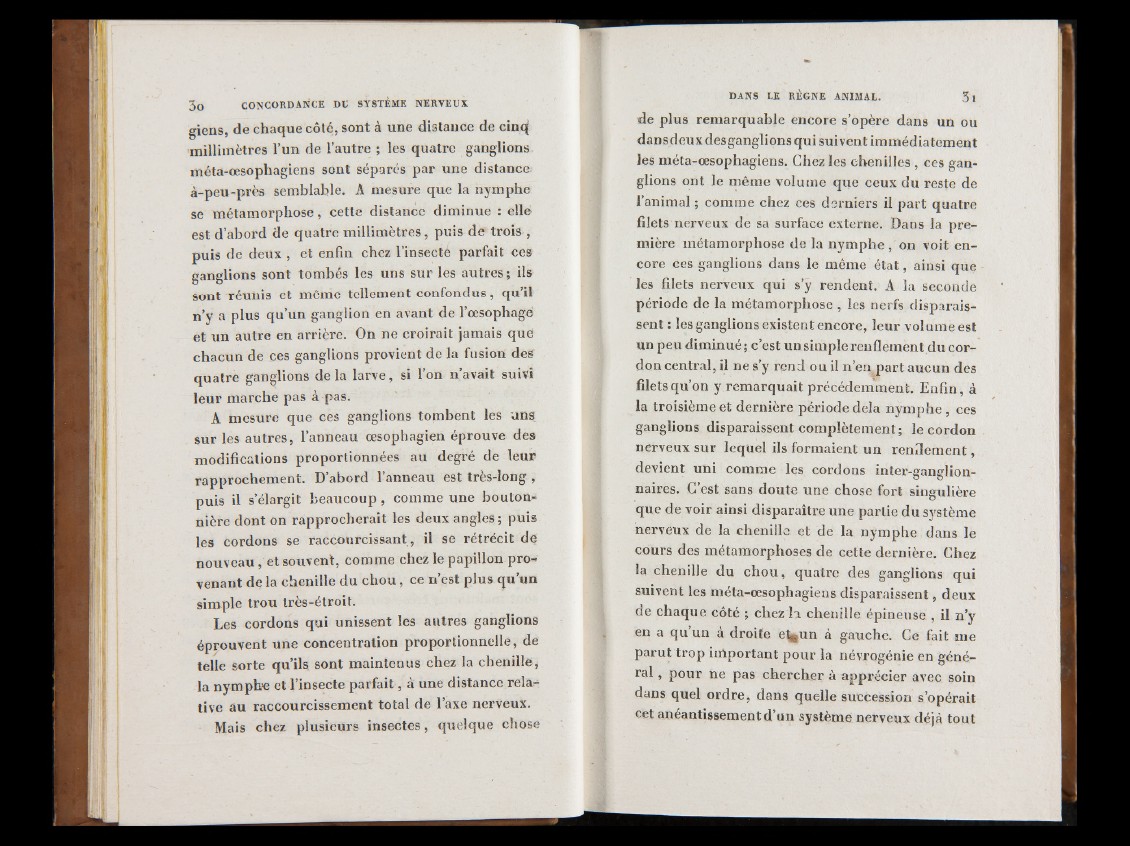
giens, de chaque côté, sont à une distance de cinq|
millimètres l’un de l’autre ; les quatre ganglions
méta-oesophagiens sont séparés par une distance
à-peu-près semblable. A mesure que la nymphe
se métamorphose, cette distance diminue : elle
est d’abord de quatre millimètres, puis de troi&,
puis de deux, et enfin chez l’insectè parfait ces
ganglions sont tombés les uns sur les autres; ils
sont réunis et même tellement confondus, qu’il
n’y a plus qu’un ganglion en avant de l’oesophage
et un autre en arrière. On ne croirait jamais qué
chacun de ces ganglions provient de la fusion des
quatre ganglions delà larve, si l’on navait suivi
leur marche pas à pas.
A mesure que ces ganglions tombent les uns
sur les autres, l’anneau oesophagien éprouve des
modifications proportionnées au degré de leur
rapprochement. D’abord l’anneau est très-long ,
puis il s’élargit beaucoup , comme une boutonnière
dont on rapprocherait les deux angles ; puis
les cordons se raccourcissant , il se rétrécit dé
nouveau, et souvent, comme chez le papillon pro^
venant de la chenille du chou, ce n’est plus qu’un
simple trou très-étroit.
Les cordons qui unissent les antres ganglions
éprouvent une concentration proportionnelle, de
telle sorte qu’ils sont maintenus chez la chenille*
la nymphe et l’insecte parfait, à une distance relâ^
tive au raccourcissement total de l’axe nerveux.
Mais chez plusieurs insectes, quelque chose
de plus remarquable encore s’opère dans un ou
dansdeux desganglions qui suivent immédiatement
les méta-oesophagiens. Chez les chenilles , ces ganglions
ont le même volume que ceux du reste de
l’animal ; comme chez ces derniers il part quatre
filets nerveux de sa surface externe. Dans la première
métamorphose de la nymphe, on voit encore
ces ganglions dans le même é ta t, ainsi que
les filets nerveux qui s’ÿ rendent. A la seconde
période de la métamorphose , les nerfs disparaissent
: les ganglions existent encore, leur volume est
un peu diminué ; c’est un simple renflement du cordon
central, il ne s’y rend ou il n ’en part aucun des
filets qu’on y remarquait précédemment. Enfin, à
la troisième et dernière période delà nymphe , ces
ganglions disparaissent complètement; le cordon
nerveux sur lequel ils formaient un rendement,
devient uni comme les cordons inter-ganglionnaires.
C’est sans doute une chose fort singulière
que de voir ainsi disparaître une partie du système
nerveux de la chenille et de la nymphe dans le
cours des métamorphoses de cette dernière. Chez
la chenille du ch o u , quatre des ganglions qui
suivent les méta-oesophagiens disparaissent, deux
de chaque côté ; chez la chenille épineuse , il n’y
en a qu’un à droite e j|u n à gauche. Ce fait me
parut trop important pour la névrogénie en général
, pour ne pas chercher à apprécier avec soin
dans quel ordre, dans quelle succession s’opérait
cet anéantissement d’un système nerveux déjà tout