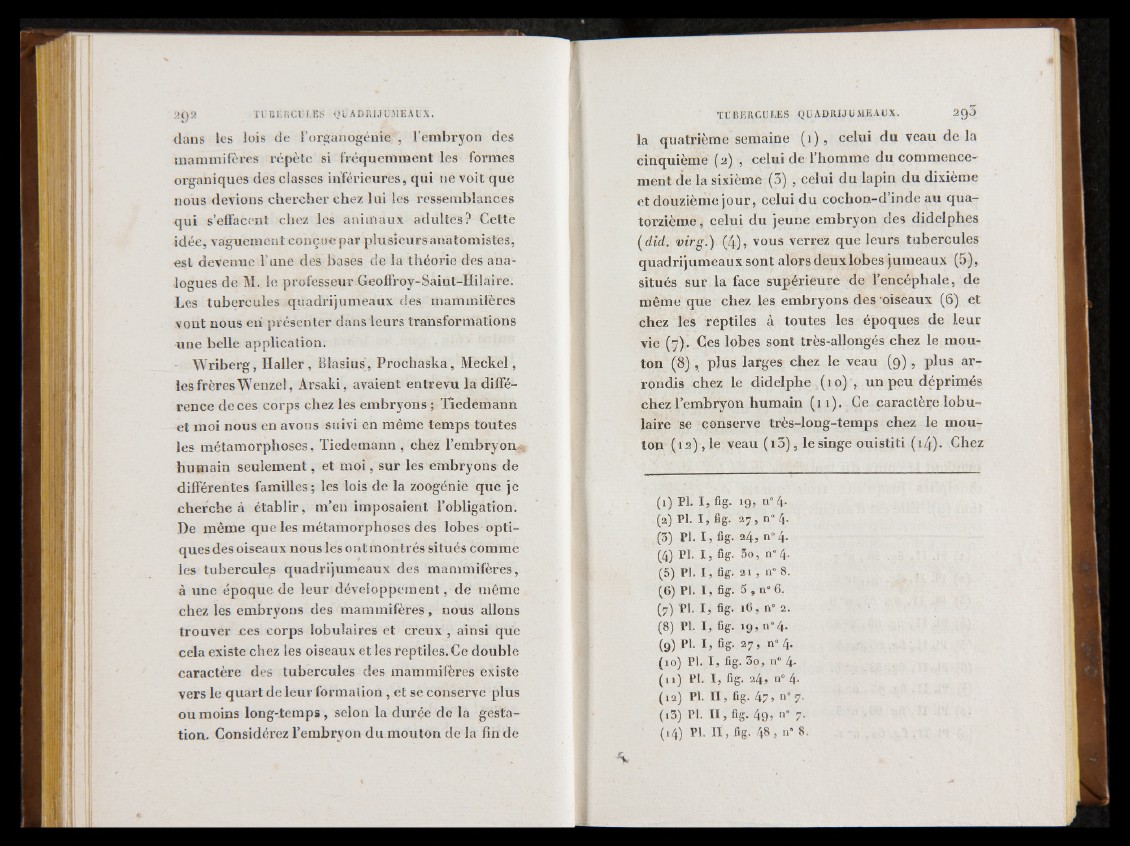
dans les lois de l’organogénie , l’embryon des
mammifères répète si fréquemment les formes
organiques des classes inférieures, qui ne voit que
nous devions chercher chez lui les ressemblances
qui s’effacent chez les animaux adultes? Cette
idée, vaguement conçue par plusieurs anatomistes,
est devenue l’une des bases de la théorie des analogues
de M. le professeur Geoffroy-Saint-Hilaire.
Les tubercules quadrijumeaux «es mammifères
vont nous eh présenter dans leurs transformations
une belle application.
Wriberg, Haller, Blasius, Prochaska, Meckel,
les frères Wenzel, Arsaki, avaient entrevu la différence
de ces corps chez les embryons ; Tiedemann
et moi nous en avons suivi en même temps toutes
les métamorphoses, Tiedemann, chez l’embryon.^
humain seulement, et moi, sur les embryons de
différentes familles; les lois de la zoogénie que je
cherche à établir, m’en imposaient l’obligation.
De même que les métamorphoses des lobes optiques
des oiseaux nous les ontmontrés situés comme
les tubercules quadrijumeaux des mammifères,
à une époque de leur développement, de même
chez les embryons des mammifères, nous allons
trouver ces corps lobulaires et creux , ainsi que
cela existe chez les oiseaux et les reptiles. Ce double
caractère des tubercules des mammifères existe
vers le quart de leur formation, et se conserve plus
ou moins long-temps, selon la durée de la gestation.
Considérez l’embryon du mouton de la fin de
la quatrième semaine (i) , celui du veau de la
cinquième (2) , celui de l’homme du commencement
de la sixième (3) , celui du lapin du dixième
et douzième jour, celui du cochon-d’inde au quatorzième,
celui du jeune embryon des didelphes
(did. virg.) (4), vous verrez que leurs tubercules
quadrijumeaux sont alors deux lobes jumeaux (5),
situés sur la face supérieure de l’encéphale, de
même que chez les embryons des oiseaux (6) et
chez les reptiles à toutes les époques de leur
vie (7) Ces lobes sont très-allongés chez le mouton
(8) , plus larges chez le veau (9) , plus arrondis
chez le didelphe (10) , un peu déprimés
chez Tembryon humain (11). Ce caractère lobulaire
se conserve très-long-temps chez le mouton
(12), le veau ( i3), le singe ouistiti ( i4)- Chez
(1) PI. I , fig. 19, n° 4.
(2) PI. I , fig. 27, n° 4.
(5) PI. I , fig. 24, n°4.
(4) PI. I , fig. 5 o , n° 4*
(5) PI. I , fig. 21 , n° 8.
( 6) PI. I , fig. 5 , n° 6.
(7) PI. I l fig. 16, n° 2.
(8) PI. I , fig. 19, n" 4*
(9) PI. I , fig. 27, n ” 4.
(10) PI. I , fig. 3 o , n° 4.
( 1 1 ) PI. I , fig. 24? n° 4.
(12) PI. I l , fig. 4ÿ> n° 7-
(13) PI. I I , fig. 49? n° 7-
( 14) PI. I I , fig. 4 8 , n“ 8