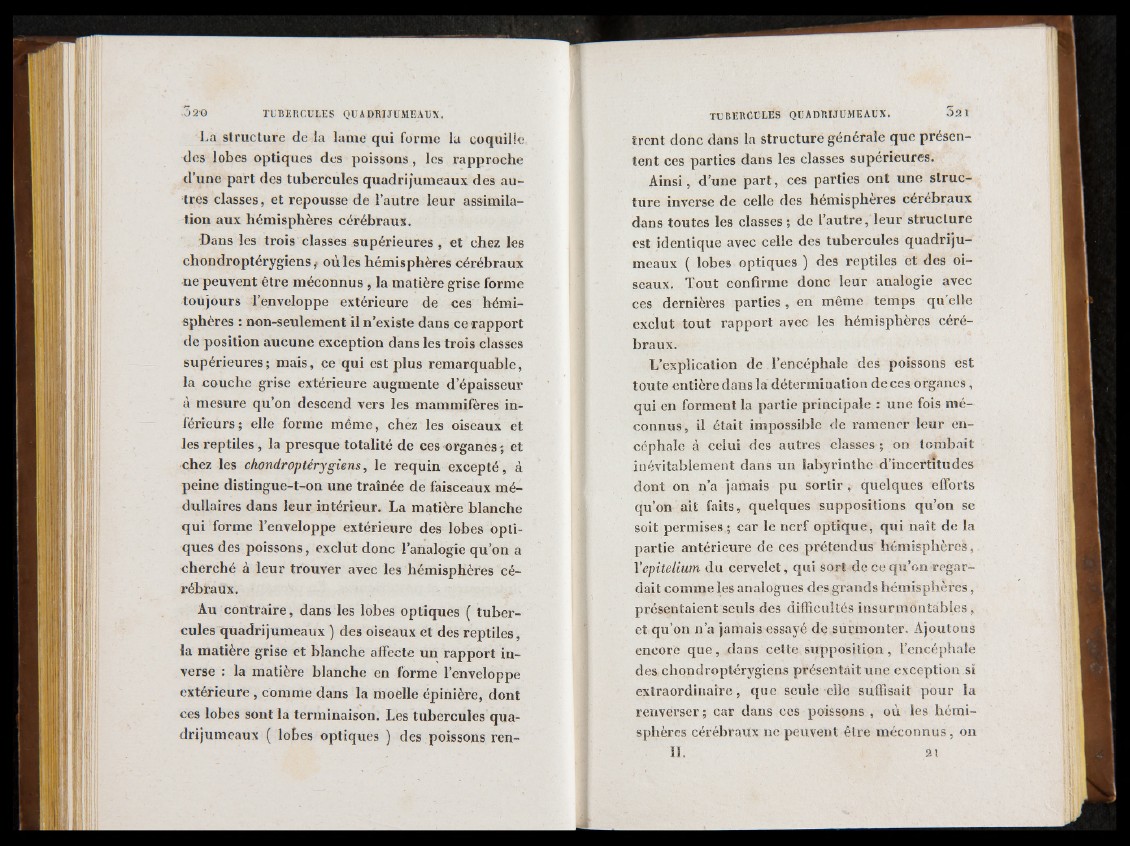
La structure de la lame qui forme la coquille
des lobes optiques des poissons, les rapproche
d’une part des tubercules quadrijumeaux des autres
classes, et repousse de l’autre leur assimilation
aux hémisphères cérébraux.
Dans les trois classes supérieures , et chez les
chondroptérygiens* où les hémisphères cérébraux
-ne peuvent être méconnus , la matière grise forme
toujours l’enveloppe extérieure de ces hémisphères
: non-seulement il n’existe dans ce rapport
de position aucune exception dans les trois classes
supérieures; mais, ce qui est plus remarquable,
la couche grise extérieure augmente d’épaisseur
à mesure qu’on descend vers les mammifères inférieurs;
elle forme même, chez les oiseaux et
les reptiles , la presque totalité de ces organes; et
chez les chondroptérygiens, le requin excepté, à
peine distingue-t-on une traînée de faisceaux médullaires
dans leur intérieur. La matière blanche
qui forme l ’enveloppe extérieure des lobes optiques
des poissons, exclut donc l’analogie q u ’on a
cherché à leur trouver avec les hémisphères cérébraux.
Au contraire, dans les lobes optiques ( tubercules
quadrijumeaux ) des oiseaux et des reptiles,
la matière grise et blanche affecte un rapport inverse
: la matière blanche en forme l’enveloppe
extérieure , comme dans la moelle épinière, dont
ces lobes sont la terminaison. Les tubercules quadrijumeaux
( lobes optiques ) des poissons rentrent
donc dans la structure générale que présentent
ces parties dans les classes supérieures.
Ainsi, d’une p a rt, ces parties ont une structure
inverse de celle des hémisphères cérébraux
dans toutes les classes; de l’autre, leur structure
est identique avec celle des tubercules quadrijumeaux
( lobes optiques ) des reptiles et des oiseaux.
Tout confirme donc leur analogie avec
ces dernières parties , en même temps qu’elle
exclut tout rapport avec les hémisphères cérébraux.
L’explication de l’encéphale des poissons est
toute entière dans la détermination de ces organes,
qui en forment la partie principale : une fois méconnus,
il était impossible de ramener leur encéphale
à celui des autres classes ; on tombait
inévitablement dans un labyrinthe d’incertitudes
dont on n’a jamais pu sortir, quelques efforts
qu’on ait faits, quelques suppositions qu’on se
soit permises ; car le nerf optique, qui naît de la
partie antérieure de ces prétendus hémisphères,
Yepitelium du cervelet, qui sort de ce qu’on regardait
comme les analogues des grands hémisphères,
présentaient seuls des difficultés insurmontables,
et qu’on n’a jamais essayé de surmonter. Ajoutons
encore que, dans cette supposition, l’encéphale
des chondroptérygiens présentait une exception si
extraordinaire , que seule elle suffisait pour la
renverser; car dans ces poissons , où les hémisphères
cérébraux ne peuvent être méconnus, on
II. 21