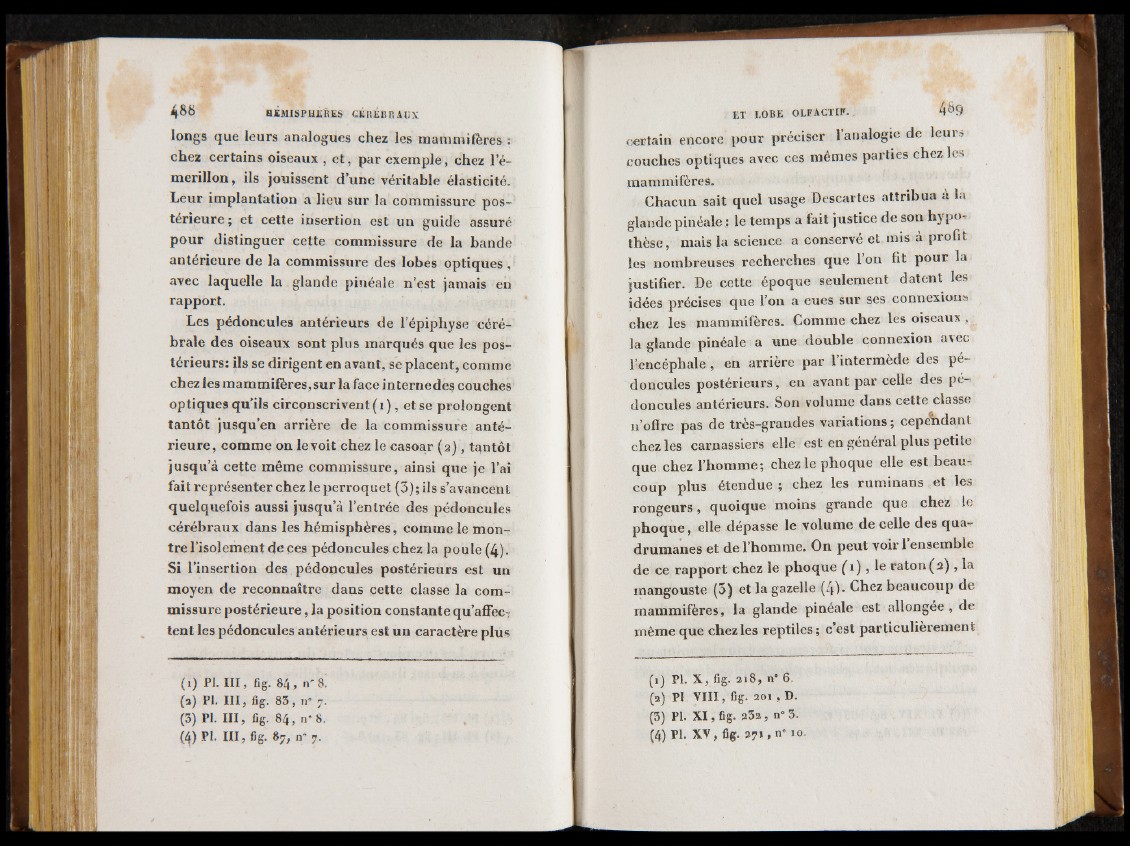
longs que leurs analogues chez les mammifères :
chez certains oiseaux , e t, par exemple, chez l’é-
merillon, ils jouissent d’une véritable élasticité.
Leur implantation a lieu sur la commissure postérieure;
et cette insertion est un guide assuré
pour distinguer cette commissure de la bande
antérieure de la commissure des lobes optiques $
avec laquelle la glande pinéale n’est jamais en
rapport.
Les pédoncules antérieurs de l’épiphyse cérébrale
des oiseaux sont plus marqués que les postérieurs:
ils se dirigent en avant, se placent, comme
chez les mammifères, sur la face internedes couches
optiques qu’ils circonscrivent {1 ), et se prolongent
tantôt jusqu’en arrière de la commissure antérieure,
comme on le voit chez le casoar (2) , tantôt
jusqu’à cette même commissure, ainsi que je l’ai
fait représenter chez le perroquet (3) ; ils s’avancent
quelquefois aussi jusqu’à l’entrée des pédoncules
cérébraux dans les hémisphères, comme le montre
l’isolement de ces pédoncules chez la poule (4) .
Si l’insertion des pédoncules postérieurs est un
moyen de reconnaître dans cette classe la commissure
postérieure, la position constante qu’affectent
les pédoncules antérieurs est un caractère plus
(1) PI. III, fig. 84) rr 8.
(a) PL III, fig. 83, n° 7.
(3) PI. III, fig. 84, n' 8.
(4) PL III, fig. 87, n” 7.
certain encore pour préciser l’analogie de leurs
couches optiques avec ces mêmes parties chez les
mammifères.
Chacun sait quel usage Descartes attribua à la
glande p in é a le le temps a fait justice de son hypothèse,
mais la science a conservé et mis à profit
les nombreuses recherches que l’on fit pour la
justifier. De cette époque seulement datent les
idées précises que l’on a eues sur ses connexions
chez les mammifères. Comme chez les oiseaux ,
la glande pinéale a une double connexion a\ec
l’encéphale, en arriéré par 1 intermède des pédoncules
postérieurs, en avant par celle des pédoncules
antérieurs. Son volume dans cette classe
n’ofire pas de très-grandes variations ; cependant
chez les carnassiers elle est en général plus petite
que chez l’homme; chez le phoque elle est beau-,
coup plus étendue; chez les ruminans et les
rongeurs, quoique moins grande que chez le
phoque, elle dépasse le volume de celle des quadrumanes
et de l’homme. On peut voir l’ensemble
de ce rapport chez le phoque (1) , le raton (2) , la
mangouste (5) et la gazelle (4V Chez beaucoup de
mammifères, la glande pinéale est allongée, de
même que chez les reptiles ; c est particulièrement
(1) PL X, fig. 218, n* 6.
(2) PI VIII, fig. 201 ,D.
(5) PL X I , fig. 232, n" 3.
(4) PL XV, fig. 271, n” 10.