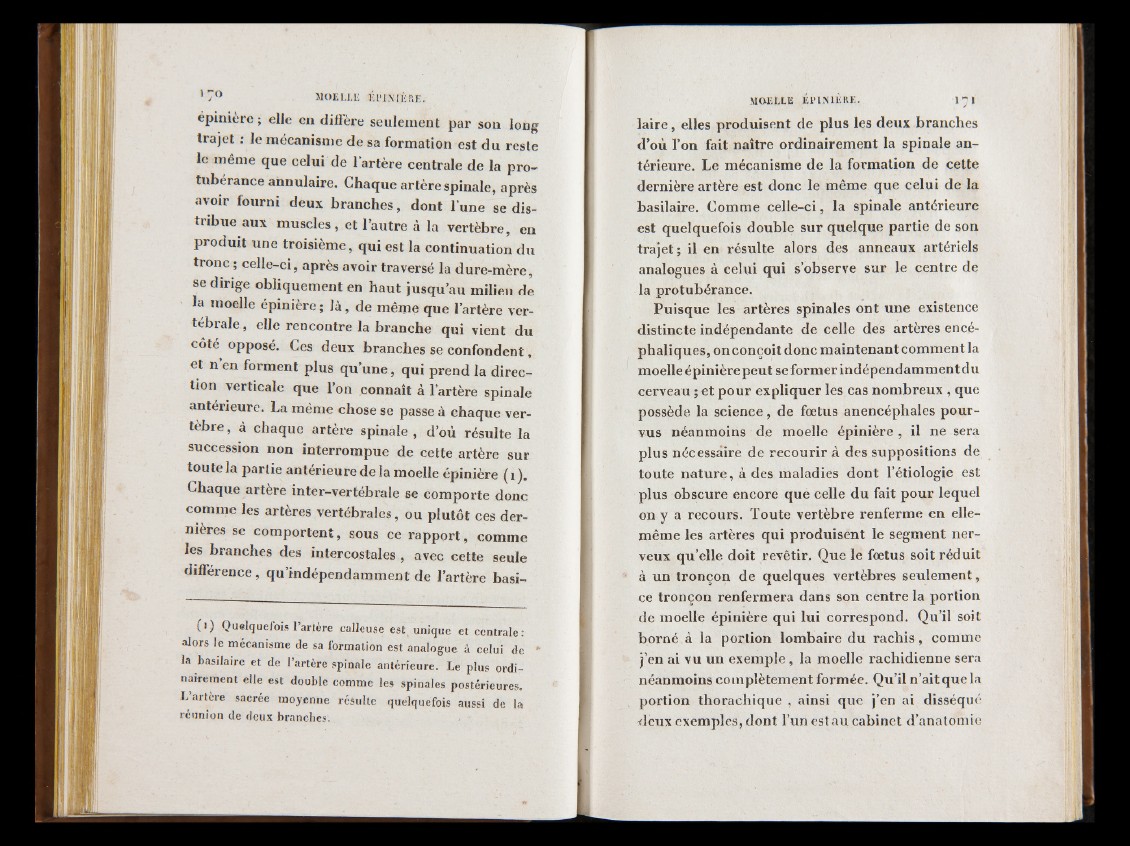
épinière ; elle en diffère seulement par son long
trajet : le mécanisme de sa formation est du reste
le même que celui de l ’artère centrale de la protubérance
annulaire. Chaque artère spinale, après
avoir fourni deux branches, dont l’une se distribue
aux muscles, et 1 autre à la vertèbre, en
produit une troisième, qui est la continuation du
tronc ; celle-ci, après avoir traversé la dure-mère,
se dirige obliquement en haut jusqu’au milieu de
la moelle épinière; là, de même que l’artère vertébrale
, elle rencontre la branche qui vient du
côté opposé. Ces deux branches se confondent,
et n’en forment plus qu’une, qui prend la direction
verticale que l’on connaît à l’artère spinale
antérieure. La même chose se passe à chaque vertèbre,
à chaque artère spinale, d’où résulte la
succession non interrompue de cette artère sur
toute la partie antérieure de la moelle épinière ( 1 ).
Chaque artère inter-vertébrale se comporte donc
comme les artères vertébrales, ou plutôt ces dernières
se comportent, sous ce rapport, comme
les branches des intercostales , avec cette seule
différence, qu’indépendamment de l’artère basi-
(«) Quelquefois l’artère calleuse est unique et centrale:
alors le mécanisme de sa formation est analogue à celui de
la basilaire et de l’artère spinale antérieure. Le plus ordinairement
elle est double comme les spinales postérieures.
L’artère sacrée moyenne résulte quelquefois aussi de la
réunion de deux branches.
laire, elles produisent de plus les deux branches
d’où l’on fait naître ordinairement la spinale antérieure.
Le mécanisme de la formation de cette
dernière artère est donc le même que celui de la
basilaire. Comme celle-ci, la spinale antérieure
est quelquefois double sur quelque partie de son
trajet; il en résulte alors des anneaux artériels
analogues à celui qui s’observe sur le centre de
la protubérance.
Puisque les artères spinales ont une existence
distincte indépendante de celle des artères encéphaliques,
on conçoit donc maintenant comment la
moelle épinière peu t se former indépendamment du
cerveau ; et pour expliquer les cas nombreux , que
possède la science, de foetus anencéphales pourvus
néanmoins de moelle épinière , il ne sera
plus nécessaire de recourir à des suppositions de
toute nature, à des maladies dont l’étiologie est
plus obscure encore que celle du fait pour lequel
on y a recours. Toute vertèbre renferme en elle-
même les artères qui produisent le segment nerveux
qu’elle doit revêtir. Que le foetus soit réduit
à un tronçon de quelques vertèbres seulement,
ce tronçon renfermera dans son centre la portion
de moelle épinière qui lui correspond. Qu’il soit
borné à la portion lombaire du rachis, comme
j’en ai vu un exemple , la moelle rachidienne sera
néanmoins complètement formée. Qu’il n’ait que la
portion thorachique , ainsi que j’en ai disséqué
«leux exemples, dont l’un est au cabinet d’anatomie